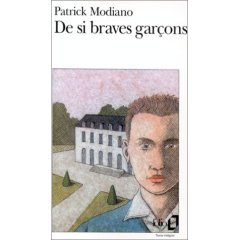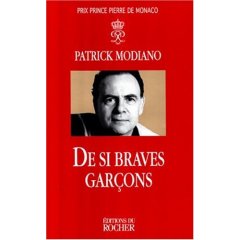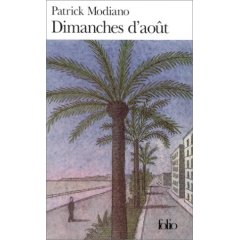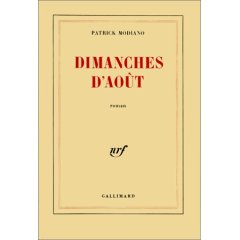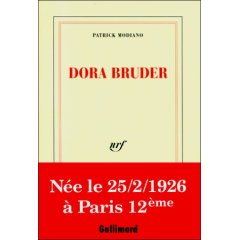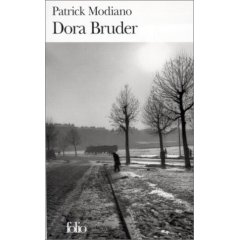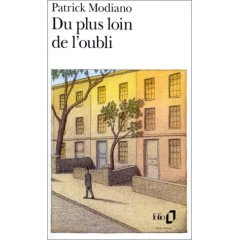Déambulations /
itinéraires*
<< (...) le récit s’organise autour du seul
point de vue, ambulatoire, du personnage central, le narrateur,
qui
assume
ainsi la totale subjectivité du narré. Sa démarche
est instinctive : il s’agit de se laisser imprégner
des lieux, la mémoire et l’imagination feront le
reste. Aussi le narrateur, au fur et à mesure que le style
de l’auteur se définit, devient-il un véritable
acteur témoin d’un monde vers lequel l’attire
sa propre sensibilité. Le hasard laisse ainsi la place à l’inconscient,
car il s’agit de faire confiance à ses pas, et le
récit prend tantôt la forme de l’itinéraire
d’une quête, tantôt celui d’un pèlerinage
sur des lieux de mémoire. Aussi c’est la carte de
la ville qui organise le récit qui est conduit par la
déambulation de l’instance narrative.>> Carine
Duvillé Errance et Mémoire : Paris et sa topographie
chez Patrick Modiano Mémoirede maitrise, juillet 2000.
Paris IV, Sorbone.
Déblayer
/ Repartir sur quelque chose
"A chaque fois que je finissais un livre, j'avais l'impression
que je pourrais repartir sur quelque chose de nouveau. J'ai
d'ailleurs la même impression avec ce nouveau livre, L'horizon.
L'impression d'avoir déblayé. D'avoir suffisamment
déblayé pour pouvoir repartir. Mais tout cela
n'est qu'une fuite en avant... Après chaque livre, j'ai
donc cette impression d'avoir suffisamment déblayé
ce qui est devant moi - ou derrière moi - pour pouvoir
enfin aborder quelque chose de nouveau. Mais cette impression
est illusoire. C'est donc une sensation assez désagréable.
C'est comme si vous vouliez dégager quelque chose pour
pouvoir enfin traiter une autre chose, comme si vous vouliez
vous débarrasser de certaines choses de votre passé,
de votre vie, pour pouvoir enfin partir d'un nouveau pied et
avoir le champ libre, mais, finalement, cela ne marche jamais
comme ça. Ce sentiment est une illusion." "Mon
Paris n'est pas un Paris de nostalgie mais un Paris rêvé"
entretien avec François Busnel (Lire), 04/03/2010
Dans
le café de la jeunesse perdue [2007]

Entretien à l'occasion de la sortie de l'ouvrage.
Site des édtions Gallimard
Extrait de l'oeuvre
Résumé
publié par les éditions Gallimard
« Au
début des années 1960, aux balbutiements du futur
situationnisme, la bohème littéraire et étudiante
se retrouve au « Condé », un café de
l’Odéon. Parmi les habitués, les quatre
narrateurs du roman : un étudiant des Mines, un ancien
des RG, une certaine Louki, alias Jacqueline Delanque, et Roland,
jeune apprenti écrivain. Dans la première séquence,
l’étudiant des Mines se souvient de la vie au « Condé » et
décrit minutieusement les apparitions de Louki, jeune
femme de 22 ans apparemment sans attache, qui lui donne l’impression
de vouloir faire « peau neuve ».
Dans
la deuxième, Caisley, l’ancien des RG, mène
l’enquête : le mari de Louki, Jean-Pierre Choureau,
l’a chargé de la retrouver. Il découvre
son enfance, aux abords du Moulin-Rouge où travaillait
sa mère.
Troisième
partie : Louki prend la parole et se souvient de son enfance,
de ses fugues, des bars interlopes du XVIIIe… Elle évoque
les hommes qui l’ont aimée : Jean-Pierre Choureau,
Roland, Guy de Vere l’ésotériste qui lui
a fait connaître la figure de « Louise du Néant » à laquelle
elle s’identifie.
Dernière
partie : Roland se rappelle sa rencontre avec Louki et leur
amour. Jeune homme passionné par l’«éternel
retour » et qui écrit un essai sur les « zones
neutres », il flotte, comme Louki, et croit pouvoir la
rejoindre dans ses pensées. Mais elle lui échappe
comme à tous les autres… Jusqu’au jour où il
apprend, au «Condé», que Louki s’est
défenestrée…
À travers
le passionnant portrait kaléidoscopique d’une
jeune femme à l’enfance déchirée
et la peinture précise du Paris des années 1960,
Dans le café de la jeunesse perdue laisse une impression
tenace de poésie autant que d’insituable malaise.
Une sensation étrange, qui prend le lecteur à la
gorge. »
une citation
"A
part mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout
ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur. J'écris
ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum
vitae, à titre documentaire, et sans doute pour en finir
avec une vie qui n'était pas
la mienne."
Extrait
" Encore aujourd'hui, il m'arrive d'entendre, le soir,
une voix qui m'appelle par mon prénom, dans la rue. Une
voix rauque. Elle traîne un peu sur les syllabes et je
la reconnais tout de suite : la voix de Louki. Je me retourne,
mais il n'y a personne. Pas seulement le soir, mais au creux
de ces après-midi d'été où vous
ne savez plus très bien en quelle année vous êtes.
Tout va recommencer comme avant. Les mêmes jours, les
mêmes nuits, les mêmes lieux, les mêmes rencontres.
L'Éternel Retour."
Guy
Debord : «A la moitié du chemin de la
vraie vie, nous étions environnés d’une
sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant
de mots railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse
perdue. » En fait, on peut situer l’origine de cette
citation dans les premiers vers de la Divine Comédie
de Dante : « Au milieu du chemin de notre vie,
je me trouvai dans une forêt sombre, la juste direction
étant perdue. »
Dans
le café de la jeunesse perdue (Bernard
Pivot à propos de)
<< Nul ne sait mieux que lui exprimer le désir
d'autre chose, mais quoi ? L'envie d'être ailleurs, mais
où ? L'espoir d'une autre vie, mais quand ? Il a souffert
de la solitude, et si une autre solitude, celle de l'écrivain,
en a pris le relais, il a si peu oublié la première
qu'il la restitue avec une sensibilité à vif depuis
cinquante ans. Ne jamais confondre chez Modiano la mélancolie
avec la nostalgie. Ni l'errance avec la flânerie. >>
(...)
<< Autre particularité de la manière Modiano:
une extrême précision des lieux, une incertitude
chronique des dates. Tandis que le romancier entraîne
ses personnages et ses lecteurs de l'Odéon à Neuilly,
de Pigalle au square Lowendal (15e), de la rive gauche à
la rive droite et inversement - la Seine est pour Louki «
une ligne de démarcation », un « rideau de
fer » -, l'auteur de La place de l'étoile, des
Boulevards de ceinture, de Rue des Boutiques Obscures, de Quartier
perdu, de Dans le café de la jeunesse perdue laisse au
temps la bride sur le cou. Un peu de météorologie,
jamais de calendrier. Le charme poétique de Modiano repose
sur une géographie rigoureuse et une chronologie chahutée.
Ce n'est pas lui qui commencerait une fiction par « en
ce temps-là ». Il préférera «
en ce lieu-là ». Puis le temps envahira la scène
de son obscure clarté. >> Bernard
Pivot, Mélancolie Modiano in La chronique livres de Bernard
Pivot, mise à jour le 29 juillet 2009.
Entretien
de P Modiano "Dans le café de la jeunesse
perdue" sur le site des éditions Gallimard, octobre
2007
1.
Le titre "Dans
le café de la jeunesse perdue"
«Ce titre évoque une jeunesse égarée,
une jeunesse erratique qui s'est consumée trop vite et
que pourrait incarner la génération de Guy Debord,
née dans les années 1930», rectifie Patrick
Modiano. C'est précisément un mot du philosophe,
en exergue du livre, qui lui a inspiré ce titre. Modiano
renchérit en citant un vers de Rimbaud: «Oisive
jeunesse/ A tout asservie/ Par délicatesse/ J'ai perdu
ma vie.» On lui fait remarquer qu'après Quartier
perdu, son roman paru en 1984, ça fait tout de même
deux de «perdus»... Etonnement non feint: «Je
ne l'ai pas fait exprès, je n'y avais même pas pensé.» Là encore,
rien de nostalgique: «Pour moi, il s'agissait d'un quartier
lointain, perdu dans la ville...»
Entretien avec Delphine PERAS, L'Express du 5 octobre 2007
2.
Dans le café de la jeunesse perdue,Critique
par Patrick Kéchichian
Patrick Modiano : la rumeur du temps évanoui
Ce n'est pas dans l'excès ou les profondeurs du rêve
que Patrick Modiano, en chacun de ses livres, nous entraîne.
Ce qu'il cherche à approcher n'est séparé de
la vie réelle que par une mince pellicule temporelle.
On dirait qu'il suffit d'avancer pour la déchirer, pour
abolir la distance, et se retrouver dans la réalité perdue.
Et pourtant non. Invisible, la frontière est infranchissable.
On s'y heurte d'autant plus que ce qui est au-delà semble à portée
de main.
Alors, en suivant les êtres de papier dont Modiano fait
ses ambassadeurs, on se met à l'écoute d'une rumeur,
celle du temps évanoui. La nostalgie, cet ardent désir
voué à ne jamais recouvrer son objet, installe
pour toujours cette rumeur dans notre esprit.
Tout écrivain doit d'abord nommer les choses, les lieux,
les personnes. Trouver les noms adéquats est sa première
tâche. Qu'ils soient inventés ou tirés
de nos souvenirs n'importe pas. Il lui revient ensuite d'animer
tous ces noms, de leur insuffler assez d'existence plausible.
Chez Patrick Modiano, le travail de nomination est essentiel.
Précis, scrupuleux, comme exhaustif, il regarde les êtres
vivants ou les objets, et puis les lieux, surtout les lieux.
Tout semble procéder de là. Une topographie se
dessine. Elle est particulière à chaque livre.
Avec sa poésie propre, elle fait vivre et respirer le
roman mieux qu'une lourde machinerie narrative. Les histoires
que raconte Modiano sont toujours brèves, et cela aussi
est essentiel : échapper à la pesanteur, ne pas
souligner d'un trait épais, suggérer plus qu'asséner.
Comme dans le récent Accident nocturne, comme auparavant
dans Dora Bruder (Gallimard, 2003, et 1997), le point de fuite
du livre, et en même temps de butée, est une jeune
femme. Elle se nomme ici Jacqueline Delanque, dite Louki. Un
jour - nous sommes à Paris, à la fin des années
1950, bien que cela ne soit pas précisé - elle
est entrée au Condé, "dans les parages du
carrefour de l'Odéon", par "la porte de l'ombre" :
elle en ressortira quelques années plus tard, pour ne
plus revenir. Cette porte et le café n'existent plus.
A l'image de tout le quartier, le Condé est devenu un
commerce de luxe, déplore Modiano. Ses souvenirs, ses
regrets sont ceux d'un homme à qui l'on a imposé le
deuil de son monde.
Un jour donc, Louki est venue s'attabler là, avec la "bohème", étudiants
un peu amateurs ou artistes en perpétuelle gestation avec "souvent
un livre à la main (...) Les Chants de Maldoror. Les Illuminations.
Les Barricades mystérieuses". Quelques photographies
la montrent "assise à la table de Zacharias, de Jean-Michel,
de Fred, de Tarzan et de la Houpa...". La légende
d'une autre, tirée du même album imaginaire, précise
: "Au premier plan, assise au comptoir : Louki. Derrière
elle, Annet, Don Carlos, Mireille, Adamov et le docteur Vala." Ils
ont "entre dix-neuf et vingt-cinq ans, sauf quelques clients
comme Babilée, Adamov et le docteur Vala qui atteignaient
peu à peu la cinquantaine, mais on oubliait leur âge."
Dans la même salle se croisent donc créatures de
fiction et personnes bien réelles, vérifiables,
comme Arthur Adamov, (Jean) Babilée, Olivier Larronde
ou Maurice Raphaël. Ce dernier fréquentait aussi
un autre café, le Canter, rue La Rochefoucauld, l'un des
lieux de la première vie de Jacqueline, à peine
adolescente ; c'était avant l'époque du Condé,
rive droite, "comme si la Seine était une ligne de
démarcation qui séparait deux villes étrangères
l'une à l'autre...".
" NO MAN'S LAND"
Tour à tour, des témoins, dont Roland, avec qui
elle a partagé un peu de sa vie, vont prendre la voix
du narrateur et évoquer la jeune femme. Louki, va raconter
d'autres instants, d'autres possibles, l'enfance près
de la place de Clichy, un triste mariage à Neuilly, le
miroitement d'une expérience spirituelle square Lowendal,
quelques hôtels ou meublés... "J'avançais,
dit-elle, avec ce sentiment de légèreté qui
vous prend quelquefois dans les rêves. Vous ne craignez
plus rien, tous les dangers sont dérisoires. Si cela tourne
vraiment mal, il suffit de vous réveiller. Vous êtes
invincible. Je marchais, impatiente d'arriver au bout, là où il
n'y avait plus que le bleu du ciel et le vide."
"
J'ai toujours cru que certains endroits sont des aimants..." Autour
de la figure intense et émouvante de Louki, "au milieu
de toutes les lignes de fuite et des horizons perdus", Modiano
recrée une admirable géographie parisienne. Elle
est sienne comme le furent celles de Simenon, Jean Follain, Jacques
Yonnet... Ou encore celle de Guy Debord qui écrivait,
dans Panégyrique : "Entre la rue du Four et la rue
de Buci, où notre jeunesse s'est si complètement
perdue (...) on pouvait sentir avec certitude que nous ne ferions
jamais rien de mieux..."
Cette géographie a ses "points fixes", ses "zones
intermédiaires" ou "neutres", ses "no
man's land où l'on était à la lisière
de tout, en transit, ou même en suspens". Quand tout
s'achève de cette jeunesse, que ses noms se perdent, que
ses visages se brouillent, il ne reste que la mélancolie
sans remède d'un songe... "Tout va recommencer comme
avant. Les mêmes jours, les mêmes nuits, les mêmes
lieux, les mêmes rencontres...".
Certains livres nous endurcissent. Catalogue de solides pensées,
manuel d'inflexibilité, traité pour dominer le
monde - ou son monde. D'autres, bien plus précieux et
nécessaires, nous fragilisent, nous désarment.
Ainsi de ce bouleversant portrait d'une femme si proche et si
perdue, peint par Modiano, exactement à la lisière
de l'ombre et de la lumière. Patrick
Kéchichian,
Le Monde des Livres du 04.octobre 2007
3.
Modiano La ronde de nuit (Dans le café de
la jeunesse perdue) Par Philippe Lançon. Une
nouvelle héroïne de Modiano meurt dans Paris entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés. Promenade.
<<
Parlons des morts, puisqu'ils nous aident à vivre. Dans
le nouveau roman de Patrick Modiano, quatre voix réveillent
une ambiance, certains quartiers de Paris, les années
soixante, une femme qui va mourir. La première est celle
d'un étudiant qui veut quitter l'école des Mines
; la deuxième, d'un détective privé qui
pourrait être celui d'un autre roman, par exemple Rue des
boutiques obscures ; la troisième, de la jeune femme qui
va se tuer ; la quatrième, de son ami écrivain.
Elles ont toutes en elles quelque chose de Modiano. Fermant le
livre, c'est la voix du détective qui revient : l'enquête
restitue la jeunesse et sauve de l'oubli. L'exergue de Livret
de famille , publié en 1977, résume ce roman de
Modiano comme les autres : «Vivre, c'est s'obstiner à achever
un souvenir.» Vivre, autrement dit : écrire. La
phrase est de René Char. Et la mémoire de Modiano
dégage une solitude qui console le lecteur de la sienne.
La jeune femme qui va se tuer, Jacqueline Delanque, épouse
Choureau, est le centre de gravité du livre. Elle entre
par une porte de café à la première page
; elle en sort par une fenêtre à la dernière.
Sa mère était ouvreuse au Moulin Rouge. Modiano
marchait beaucoup par-là, naguère, sur les pentes
d'avant Montmartre. Parfois, se souvient-il, «je croisais
la silhouette bizarre de Marcel Aymé, complètement
aphasique.» Quand elle rompt avec quelqu'un, Jacqueline
change de quartier. Elle transporte son malaise et sa grâce
dans ce que son ami appelle des «zones neutres» :
rues aux identités diaphanes, paraissant ne jamais être à leur
place. Quand on est un personnage de Modiano, c'est là qu'on
se fait oublier, qu'on se souvient, qu'on vit. La neutralité de
ses territoires rappelle la neutralité de la langue que
Roland Barthes rêve avant de mourir. Là où rien
ne se passe, tout arrive -mais en nuances. Barthes y voit une
forme de délicatesse. Elle «touche à une
sorte d'errance sociale, assume la marge excessive». Elle
va vers la douceur et un «refus non violent» . Ainsi
vont les personnages de Modiano.
C'est de la jeune femme surtout que les autres parlent. Parfois,
elle rejoint son ami dans un hôtel de la rue d'Argentine.
C'est une petite rue un peu morte, derrière l'avenue de
la Grande Armée. L'hôtel du roman existe. Il s'est
appelé Hôtel Argentina. Le nouveau propriétaire, âgé de
trente ans, l'a rebaptisé : Mon hôtel. Il s'appelle
Monsieur Aymé. Le bar attenant était celui de Madame
Claude. Des prostituées rejoignaient l'hôtel avec
leurs clients. Les flics surveillaient sans interdire. Patrick
Modiano se souvient d'y avoir loué une chambre quand il
avait vingt ans : «Je n'allais pas très bien, je
cherchais des endroits comme ça pour avoir la paix. Je
voyais passer des couples dans les escaliers...» Il n'y
est pas retourné.
Jacqueline Delanque a un surnom, Louki. Les habitués le
lui ont donné, un soir, au café Le Condé : «Et à mesure
que l'heure passait et que chacun d'eux l'appelait Louki, dit
l'étudiant à l'école des Mines, je crois
bien qu'elle se sentait soulagée de porter ce nouveau
prénom. Oui, soulagée. En effet, plus j'y réfléchis,
plus je retrouve mon impression du début : elle se réfugiait
ici, au Condé, comme si elle voulait fuir quelque chose, échapper à un
danger.» Comme en amour, le surnom est un faux passeport
qui permet de croire en la tendresse clandestine des frontières.
Louki lit certains livres teintés de mystique, parfois
célèbres en ces années-là. Horizon
perdu , de James Hilton ; Cristal qui songe , de Theodor Sturgeon
; Louise du Néant , de Jean Maillard. Des histoires d'enfants
ou d'adultes qui, d'une manière ou d'une autre, cherchent
ou trouvent un monde idéal. Modiano cite les titres, jamais
les auteurs : il restitue, avec une précision vague, non
pas des informations, mais les signes d'une intimité,
les ondes d'une fréquence sentimentale. Les titres sont
comme les noms : des échos symboliques et sonores.
L'exergue du roman est une phrase de Guy Debord, tirée
du texte du film In girum imus nocte et consumimur igni (Nous
tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés
par le feu) : «A la moitié du chemin de la vraie
vie, nous étions environnés d'une sombre mélancolie,
qu'ont exprimée tant de mots railleurs et tristes, dans
le café de la jeunesse perdue.» Modiano n'a pas
connu Guy Debord, sinon par ricochet : «Quand j'avais huit
ou neuf ans, il y avait une fille dans mon immeuble, une étudiante
aux Beaux-Arts américaine, qui me gardait et m'amenait
dans des cafés du quartier, à Saint-Germain-des-Prés.
Elle avait deux amis, Patrick et Henri. A vingt ans, Debord les
avait fréquentés. Je les écoutais parler
de lui. Je l'ai lu assez tardivement, et seulement ses textes
autobiographiques, comme Panégyrique... Les textes politiques
ne m'intéressent pas.»
D'autres écrivains traversent les cafés du roman.
Modiano les a croisés, ici ou là, dans sa jeunesse
un peu à la dérive. Comme pour les livres, il restitue
leur silhouette, leur présence, en quelques phrases, sans
jamais informer. Voici le dramaturge Arthur Adamov, qui fit partie
du cénacle d'Antonin Artaud dans ses deux dernières
années ; ou l'écrivain Maurice Raphaël, de
son vrai nom Victor-Marie Lepage, qui avait été collaborateur
actif et tortionnaire sous Vichy. Il écrivit plus tard,
entre autres, des polars sous le nom d'Ange Bastiani. Ou encore
le poète Olivier Larronde, «une sorte d'archange» alcoolique
et déchu que Genet et Cocteau avaient fait connaître
lorsqu'il publia, à 17 ans, les Barricades mystérieuses
. Son second livre, Rien voilà l'ordre , est l'anagramme
de son nom. Pour soigner son épilepsie, Larronde devint
opiomane. Modiano évoque au passage une vieille voisine,
toujours vivante, qui l'a connu et fume encore de l'opium. Il
a rencontré le poète à la fin de sa vie,
au début des années soixante. Lui-même avait
17 ans. Larronde, dit-il, portait «un manteau lourd, à col
relevé, de prince qui serait un clochard.»
Escortée par ces fantômes, Louki entre dans la nuit à travers
une sorte de tragédie murmurée. Louki, c'est presque
Youki, le prénom de la femme du poète Robert Desnos,
et c'est bien à elle que Modiano a songé. Mais,
précise-t-il, «comme j'ai aussi pensé à deux
autres femmes que j'ai connues, dont l'une s'est tuée,
je ne me suis pas senti le droit de prendre ce nom et je l'ai
un peu changé.» Modiano aime Robert Desnos, mort
en déportation du typhus en 1945, l'année même
où il est né. Son premier livre, publié en
1968, s'appelle : la Place de l'étoile . C'est le titre
de l'un des derniers textes de Desnos. Quand Modiano a écrit
le sien, il l'ignorait. Il n'allait pas bien et devait partir à l'armée.
Un soir, dans un dîner familial, on lui présente
le docteur Ferdière, qui a été l'étrange
psychiatre d'Artaud et reste proche de nombreux écrivains. «Ferdière
a vu que j'allais mal , se souvient Modiano, et il s'est inquiété lorsqu'il
a su que je devais faire mon service militaire.»
Le jeune homme rend visite au psychiatre et lui apporte son roman.
Ferdière sort de sa bibliothèque le livre de Desnos
et le lui montre : c'est lui qui l'a édité, à l'automne
1945. A la femme de Desnos, il écrivait : «C'est
toi qui devrais signer le bon à tirer, Youki, admirable
compagne de Robert. Je songe aux soirées de la rue Mazarine
; je songe au soleil de l'Apothicairerie...» «J'étais
défait , se souvient Modiano. J'avais l'impression d'avoir
volé ce titre à Desnos, à cet homme qui était
mort l'année de ma naissance, dans les conditions qu'on
sait, des conditions qui ont été si importantes
pour ma génération et qui marquent tellement mon
travail.» Ferdière lui explique que ce n'est pas
grave, qu'il s'agit d'un hasard objectif.
Modiano met longtemps à raconter cette histoire. Il ne
parle, comme on sait depuis l'«Apostrophes» qui le
fit connaître, que par repentirs. Le mot juste est toujours
celui d'après ; en général, il ne vient
pas. Sauf à la page : les mots sont des truites que Modiano
pêche dans ses trous. Mais ces réponses inachevées,
perpétuellement reprisées, sont également
la marque subtile d'une éducation : elles lui permettent
de raccompagner toute question inerte ou mal venue vers la sortie,
en souriant, avec courtoisie, en faisant croire à celui
qui l'a posée qu'il n'est responsable de rien.
Après Louki, le personnage le plus important du livre
est peut-être un spirite : comme le romancier, il éveille
les voix des morts. Il s'appelle Guy de Vere. Modiano ne précise
pas que ce nom vient d'un poème d'Edgar Poe, Lénore
. Guy de Vere est, dans Lénore , le mari survivant d'une
morte. Il refuse de pleurer, elle lui dit : «Et toi, Guy
de Vere, où sont tes larmes ?» On ne sait pas où Poe
a trouvé ce nom. Modiano a cherché, comme tous
ceux qui connaissent ce texte. Poe l'a sans doute, comme d'habitude,
inventé pour des raisons sonores. «Un nom qui m'a
hanté longtemps» dit Modiano. Un mystère
auquel il a donné une identité possible.
Guy de Vere habite au 5, square Lowendal, dans le quinzième
arrondissement parisien. C'est une impasse assez chic et absolument
déplacée, près du métro Cambronne
: de hauts immeubles de briques et pierre de taille autour d'une
cour privative dans laquelle on a mis des palmiers. Le roman
précise que l'une des fenêtres de l'appartement
du spirite, troisième étage, deuxième immeuble à gauche,
est couverte de lierre. Aujourd'hui, il y a bien du lierre, mais
autour d'une fenêtre située au troisième étage,
troisième bâtiment à droite. Modiano n'a
pas mis les pieds ici depuis vingt ans. Ses souvenirs ont la
précision et la bizarrerie d'un rêve. Ce sont des
amers : «Mais oui, dit un personnage , je comprenais. Dans
cette vie qui vous apparaît quelquefois comme un grand
terrain vague sans poteau indicateur, au milieu de toutes les
lignes de fuite et les horizons perdus, on aimerait trouver des
points de repère, dresser une sorte de cadastre pour avoir
l'impression de ne plus naviguer au hasard.» C'est un art
du roman et un art de vivre. Apparemment, il n'y a pas de spirite
au 5, square Lowendal. Mais, si l'on reste assez longtemps, on
voit passer de temps à autre une femme qui pleure. Elle
sort de chez l'analyste.>> Par
Philippe Lançon, Libération du 4 octobre 2007
4.
La poésie des « zones
neutres » par Jean-Claude Lebrun, L'Humanité
Les critiques, qui depuis bientôt quatre décennies
en tiennent pour une prétendue « petite musique » de
Patrick Modiano, en seront pour leurs frais : Dans le café de
la jeunesse perdue ne leur offre aucune prise leur permettant
de recycler leur formule rebattue. Le romancier procède
en effet à une importante variation narrative, en faisant
aujourd’hui circuler la parole entre quatre personnages
successifs. Déplaçant ainsi les points de vue et
modulant la tonalité du propos. Si le livre se présente à la
façon d’une enquête sur une figure disparue,
ainsi que ce fut déjà le cas en 1997 avec Dora
Bruder, il rompt clairement avec la linéarité d’une
investigation classique. Et, par sa forme éclatée,
restitue le mélange d’absolue netteté et
de flou qui constitue la texture particulière du souvenir.
Modiano se renouvelle, en fidélité à soi-même.
En épigraphe, une citation de Guy Debord, dans laquelle
il est question d’une « sombre mélancolie » exprimée
dans des mots « railleurs et tristes ». Cela se passait
au début des années soixante. Une part hétéroclite
d’humanité peinait à trouver sa place. Le
tourbillon de l’après-guerre s’était
atténué, les prodromes de l’ennui s’avançaient,
dans l’un de ces entre-deux qu’affectionne
d’explorer Patrick
Modiano. Quelques années auparavant, en 1954, Françoise
Sagan avait fait paraître Bonjour tristesse. Voici donc
les habitués du Condé, un café du carrefour
de l’Odéon dans lequel a coutume de se retrouver
un univers bohème et interlope. Il y a là un étudiant
de l’École des Mines sur le point de démissionner,
un ancien membre des Renseignements généraux, une
très jeune femme en perte de repères, un garçon
porté par le désir d’écriture. Ensemble,
ils forment le quatuor des narrateurs dont la parole va se relayer
en séquences successives. Tandis que passent en arrière-plan
certaines des figures de la vie littéraire du temps. Le
dramaturge Arthur Adamov, l’auteur de romans policiers
Maurice Raphaël, considéré comme le « styliste
du gluant », ou encore Olivier Larronde, le « dernier
des poètes maudits ». Tous familiers des « zones
neutres » dans la grande ville. Ces lieux d’échouage
et de rencontres de hasard, d’activités souterraines
et d’attente d’un futur incertain. En somme, une
sorte de concentré de l’univers romanesque
de Patrick Modiano. Au centre de cette mosaïque se tient
une figure de femme, une certaine Jacqueline qui
se fait appeler Louki et tient le rôle du troisième
narrateur. Aux yeux de chacun, elle incarne le flou et les attaches
rompues. Très
exactement ce vers quoi tous se sentent aimantés. L’étudiant
des Mines comme l’ancien enquêteur des RG. Et cet écrivain
qui, par bien des traits, ressemble à Modiano lui-même.
Ils reviennent maintenant, avec le recul du temps, sur la fugitive
apparition tôt partie. Parce qu’elle incarnait cette époque
flottante. Parce qu’elle fut aussi pour eux une énigme.
Parce que son souvenir n’avait plus cessé de les
habiter. Une nouvelle fois le romancier tourne autour d’un
personnage obscur, au rayonnement quelque peu vénéneux.
Sorti de rien, figurant seulement sur deux mains courantes de
commissariats du côté de Pigalle, et retournant
au néant. En l’espèce il répète,
en le transposant, son travail de toujours sur la figure ambiguë et
douteuse de son propre père. S’attachant également à parcourir
un Paris oublié, victime d’un véritable blanc
mémoriel entre l’immédiat après-guerre
et la fin des années soixante. Pas de petite musique dans
tout cela, mais l’orchestration de première force
d’une palette sonore complexe, dans les graves, en accord
avec la « sombre mélancolie » de Guy Debord.
Et donc en rupture avec l’austérité narrative,
style rapport de police, d’Un Pedigree, le roman précédent
paru en 2005. Jean-Claude LEBRUN, l'Humanité,
4 octobre 2007.
5.
Modiano, chapitre 23 par Pierre Assouline, La république des
Livres, Blog
" Non, Patrick Modiano n’écrit pas toujours le même
livre :
son œuvre est un seul livre dont il publie un nouveau chapitre tous les
trois ou quatre ans. Que l’opus relève du roman ou du récit
autobiographique, c’est tout un. Le dernier en date Dans le café de
la jeunesse perdue (149 pages, 14,50 euros, Gallimard) n’y fait pas exception.
On y entend sa voix, cette sonorité si particulière qui fait sa
touche depuis La Place de l’étoile même si ce premier roman
contenait une violence et une ironie subversives qui ne se retrouveront pas par
la suite. Normal : cette force du premier cri est le propre du genre et on n’écrit
qu’un seul premier roman. La touche Modiano est un alliage léger
et délicat fait de murmures imperceptibles, d’impressions inachevées,
de sentiments fugaces. On est en permanence dans le presque et le pas tout à fait.
Chez lui, et c’est encore le cas ici, un personnage surgit de l’ombre
vers minuit, il est nimbé d’étrangeté et tout y est
nécessairement bizarre. Modiano croit au génie des lieux. Ce roman
s’articule autour du Condé, un café parisien où se
retrouve une bande d’habitués âgés de 19 ans à 25
ans. C’est un aimant, un bistro au pouvoir magnétique. Mme Chadly
y sert des Izarra vertes. S’y retrouvent des bohèmes, Tarzan, Zacharias,
Don Carlos, Fred, Mireille, la Houpa, Jean-Michel Ali Chérif, Jean Babilée,
Jacqueline Delanque, Arthur Adamov et Louki. Ils lisent Les Chants de Maldoror,
Horizons perdus et les Illuminations mais aussi l’un des leurs, le poète
Olivier Larronde en ses Barricades mystérieuses et, plus intriguant, Cristal
qui songe et Louise du néant. Le romancier y apparaît à travers
Bowing dit le Capitaine, un type hanté par les points fixes, qui a la
manie de tenir registre stricto sensu des entrées et des sorties des clients
du café. Nom, prénom, date, heure…Le livre d’or d’un
obsessionnel de la taxinomie. « Au fond, Bowing cherchait à sauver
de l’oubli les papillons qui tournent quelques instants autour d’une
lampe ». Modiano même. Ca se passe à Paris dans un temps où les
numéros de téléphone ressemblaient à Auteuil 15-28.
On y entend des phrases dont la gentillesse n’entame pas le mystère,
des phrases telles que : « Alors, vous trouvez votre bonheur ? ».
Quelqu’un y avoue « En fait, je suis mariée » comme
on confesserait un crime.
On navigue dans des zones neutres et indistinctes, dans un univers rétif
aux définitions parmi des personnages aux identités cosmopolites,
souvent des gens morts pour l’état-civil. Ce monde là est
un jardin suspendu au-dessus d’un no man’s land. Ses personnages
en fugue ont tous une double issue, comme l’immeuble de la rue Lord Byron
où son père avait son bureau. Si Georges Simenon a un héritier
en langue française, c’est bien Modiano –sauf à croire
que Simenon était un auteur de romans policiers mais qui le croit encore
? L’un et l’autre compulsent des annuaires et, ivres de noms, savourent
d’en aligner un certain nombre en guise de plan à leur roman à venir,
heureux de se soumettre à la magie des patronymes et confiants dans sa
capacité à secrètement bousculer l’ordre des choses
; l’un et l’autre ont le génie de ressusciter un monde avec
une économie de moyens qui pousserait au suicide tant de nos romanciers
imbus des bavardages de leurs héros.
En écrivant cette méditation sur des silhouettes en ligne de fuite
dans le temps, Modiano n’avait pas le pavé proustien sur sa table
de chevet mais un vieux plan Taride de Paris déchiré vers les bords.
Il n’y a que lui pour trouver des rues qui ne correspondent pas à l’arrondissement
auquel elles appartiennent. Les soirs de printemps, il attend la nuit profonde
pour marcher sur les Champs Elysées, bercé par l’illusion
qu’ils ressemblent alors à ce qu’ils furent. Dans le café de
la jeunesse perdue est un rêve enveloppant d’où émane
une musique splendide. Il a la rare vertu de nous expliquer ce qui nous arrive
mieux que nous ne saurions le faire. Le réveil est ouaté puis douloureux.
Il y a bien une histoire, une recherche, un enquête sur une personne mais
qu’importe. Une phrase cueillie à la page 50 devrait anéantir
toute tentative de résumé : « Et il fallait chercher un sens à tout
cela… »
(Cette photo de Gilbert Nencioli mérite une petite explication. Il y a
une quinzaine d’années, j’avais fait une enquête sur
les lieux de mémoire de Patrick Modiano avec sa complicité. Nous
nous étions donc transportés notamment à Jouy-en-Josas,
où il avait retrouvé l’une des maisons de son enfance. A
la propriétaire qui nous avait très aimablement reçus, il
avait montré la planche d’un album de Blake et Mortimer (était-ce
Le Secret de l’espadon ?) dans laquelle une case reproduit très
exactement la façade de cette maison, jusqu’à la fenêtre
de la chambre que Patrick partageait avec son frère Rudy. L’identification était
d’autant plus facile que le dessinateur donnait même l’adresse
: rue du Docteur Kurzenne, si ma mémoire est bonne…)"
Pierre Assouline,
La
république des Livres, Blog
6.
L'art de la fugue selon Patrick Modiano par Eléonore Sulser
" Un peu à la manière d'un astronome, l'écrivain, fidèle à sa
voie, suit le parcours d'une certaine Louki, étoile filante d'une jeunesse
en perdition dans le Paris des années 1960. Apparitions, révolution
et points d'impact.
«Quel bonheur de flotter dans l'air et de connaître enfin cette sensation
d'apesanteur que je recherche depuis toujours.» Louki, alias Jacqueline
Choureau née Delanque ou encore «Jacqueline du Néant» est
un être aux noms multiples, aux attaches hésitantes. Adresses successives
dans Paris, amis dispersés, amours passantes, elle est l'héroïne
de Dans le Café de la jeunesse perdue, dernier livre de Patrick Modiano
qui s'inscrit avec grâce et cohérence dans cette ?uvre littéraire
si fidèle à elle-même.
Comme un ballon d'enfant gonflé à l'hélium,
Louki tente constamment d'échapper à la gravité terrestre,
celle des choses et des êtres - désireux de créer
des liens -, celle des histoires et des destins qui vous saisissent,
vous «charpentent» dirait peut-être sa mère,
vous enracinent et vous condamnent ainsi à l'infinie répétition
des mêmes gestes, des mêmes itinéraires. Elle
n'a de cesse que de se dérober et de se perdre.
C'est
cet art de la fugue, cette trajectoire d'étoile
filante que, Patrick Modiano, tente - à sa manière
poétiquement incertaine - de reconstituer dans ce roman à quatre
voix. L'étudiant de l'Ecole des mines, le privé qui
enquête «à contre-courant», Jacqueline
elle-même, puis ce Roland qui se souvient qu'il a connu
avec elle un bref instant d'éternité, tous livrent,
tour à tour, des bribes de l'existence de la jeune femme
sans jamais parvenir à fixer tout à fait son image
en pleine lumière.
Elle entre par «la porte de l'ombre», note l'étudiant,
ses apparitions sont irrégulières - parfois éblouissantes
- et ses disparitions chroniques, rapporte le détective.
Etrange étoile dont Patrick Modiano étudie les
révolutions un peu à la manière d'un astronome.
L'écrivain observe, comme il le ferait à travers
une lentille grossissante, les trajectoires de ses personnages
et leurs points d'impact dans Paris. Vision détaillée
mais partielle, d'où l'on tente de déduire les
lois mystérieuses auxquelles répondent les personnages.
Le paradigme astronomique revient de proche en proche dans le
roman: l'expression «trous noirs» s'insinue à plusieurs
reprises et un personnage Roland est dit «très intéressé par
l'astronomie», avec une prédilection pour «la
matière sombre» qui menace, semble-t-il, d'aspirer
le réel. Dans ce monde mouvant d'apparitions et de disparitions,
dans le cosmos qu'est ce Paris des années 1960, Patrick
Modiano imagine des forces d'attraction. «Il me semble
que Le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique
- dit-il du café où apparaît Louki - et que
si l'on faisait un calcul de probabilités le résultat
l'aurait confirmé: dans un périmètre assez étendu,
il était inévitable de dériver vers lui.»
Y
a-t-il dès lors quoi que ce soit d'assez fort pour
empêcher la dérive des êtres? Comment faire
durer les liens entre humains «dans ce flot qui vous emporte»?
Les personnages y répondent à leur manière,
inventant des registres, arpentant, notant, tentant de poser
quelques jalons: Bowing, un client du Condé, est «hanté» par
ce qu'il appelle «les points fixes». Pierre Caisley,
le privé, dresse des listes même s'il sait «que
tous ces détails» ne lui serviront «à rien».
Roland, lui, à l'image de Modiano jeune, veut inventorier
les «zones neutres» de Paris, ces lieux «où l'on était à la
lisière de tout, en transit, ou même en suspens»,
où l'on «jouit d'une certaine immunité» et
où il rencontrera Louki.
Chacun de ces arpenteurs du réel semble mener le lecteur
au plus près du projet littéraire de Patrick Modiano: «Dans
cette vie qui vous apparaît quelques fois comme un grand
terrain vague sans poteau indicateur, au milieu de toutes les
lignes de fuite et les horizons perdus, on aimerait trouver des
points de repère, dresser une sorte de cadastre pour n'avoir
plus l'impression de naviguer au hasard.»
Et pourtant,
toute tentative de recensement, de clarification semble vouée à l'incomplétude et à la
perte. Est-elle d'ailleurs vraiment souhaitable? Puisque chez
Patrick Modiano, comme dans certaines sociétés
primitives, livrer son adresse véritable paraît
parfois aussi dangereux que de révéler son nom
caché. «Je ne voulais pas qu'il sache où j'habitais
exactement de crainte qu'il ne me pose des questions»,
dit l'étudiant de l'Ecole des mines. Ne pas trop en dire
est de règle. Tout le livre s'inscrit entre le dévoilement
et la conservation jalouse de la part de mystère des êtres.
Dans le Café de la jeunesse perdue résonne aussi
l'écho assourdi de Pedigree (Folio, 2006), récit
autobiographique de l'enfance et de la jeunesse flottante et
dure de Patrick Modiano. Pedigree, dont la lecture ou la relecture,
peut éclairer, un peu à la manière d'un
guide de voyage, l'itinéraire de cette jeunesse perdue.
Eléonore
Sulser, Le Temps, 13 octobre 2007
7.
Modiano plonge dans une jeunesse perdue par Pascale Gavillet,
" L'auteur retrouve ses thèmes favoris «Dans
le café de la jeunesse perdue».
Les écrivains font toujours le même livre. Toute
leur vie. A quelques variantes près. Le titre du dernier
Modiano est déjà en soi un condensé de l'oeuvre.
Dans le café de la jeunesse perdue. Il y a ce temps du
souvenir derrière lequel court l'auteur sans jamais le
rattraper. Ce goût pour des lieux cristallisant ceux qui
y séjournent, ici le café. Et puis cette angoisse
face au sentiment de la perte, celle de la mémoire, celle
des repères, aussi.
De quoi parle-t-il, cette fois? Ou plutôt, qu'évoque-t-il?
Une personne disparue, bien sûr. Une jeune femme qu'on
surnommait Louki et qui était une habituée du café donnant
son titre au roman. De ces habituées dont on ne sait rien.
Presque rien. A peine qui elle fréquentait. «On
finit souvent par identifier quelqu'un grâce à une
photo. On la publie dans un journal en lançant un appel à témoin.» (page
24)
Inventer une vie neuve
Les problèmes d'identification, de quête, sont au
cœur du livre. Qu'est-elle devenue? Qui était-elle?
On a tous expérimenté pareilles obsessions à partir
d'un infime souvenir loti dans des mémoires qui le broient.
Patrick Modiano, lui, les couche par écrit. Même
s'il n'est pas le narrateur, comme c'est le cas ici. On peut
supposer - et on connaît assez son aptitude à créer
des effets de réel, du moins dans la plupart de ses autres
romans - qu'il en est proche, par l'âge et le statut en
tout cas. Des indices? En voici un, page 32: «C'est l'avantage
d'avoir vingt ans de plus que les autres: ils ignorent votre
passé. Et même s'ils vous posent quelques questions
distraites sur ce qu'a été votre vie jusque-là,
vous pouvez tout inventer. Une vie neuve. Ils n'iront pas vérifier.»
Avec Dans le café de la jeunesse perdue, il marque néanmoins
sa différence. A la moitié du roman environ, il
donne la parole à l'inconnue, à cette femme évanescente,
fantomatique, dont le lecteur parvient à peine à esquisser
les contours. Un chapitre entier du livre suggère son
point de vue, à la première personne. Brisant ainsi
le mystère supposé l'entourer. Ou le renforçant.
La conclusion du livre - on peut s'en douter sans la révéler
ici - ne va en effet rien résoudre. Pire, Modiano, via
son narrateur, bute à nouveau sur l'énigme constituant
sa pierre d'achoppement. «On dit tant de choses... Et puis
les gens disparaissent un jour et on s'aperçoit qu'on
ne savait rien d'eux, même pas leur véritable identité.» (page
139)
Au bord de la falaise
Telle est bien la thématique commune à Rue des
boutiques obscures, Villa triste, Une jeunesse, Vestiaire de
l'enfance, Memory Lane. Et aujourd'hui Dans le café de
la jeunesse perdue. L'unité décelable entre tous
ces livres nous autorise à parler d'oeuvre cohérente,
entière, une et indivisible. Avec une constante émotive
qu'il faut bien signaler une fois encore. Chacun des romans de
Modiano, à la fin, nous laisse légèrement
au bord d'une falaise, face au vide, avec un étrange sentiment
au fond de la gorge. Le dernier n'y fait pas exception."
Pascale Gavillet, 1 octobre 2007 ,© Hachette
8. Patrick Modiano, par Delphine
Peras
" Dans le Café de la jeunesse perdue revisite le
Paris des années
1960 de l'écrivain. Une capitale où il a donné rendez-vous à L'Express
pour évoquer ce passé qui le hante. Mais que son imaginaire rend
intemporel...
Et s'il y avait un malentendu persistant avec Patrick Modiano? Et si on se méprenait
sur cet écrivain qui, de livre en livre, une trentaine à ce jour,
passe pour le chantre d'une époque révolue dont il serait éternellement
nostalgique? Son nouveau roman, Dans le café de la jeunesse perdue, en
librairie ce 4 octobre, pourrait bien entretenir la confusion. Tenez, rien que
le titre: on pense spontanément à sa jeunesse enfuie, à ce
qui était et ce qui ne sera jamais plus. Fausse route.
«
Ce titre évoque une jeunesse égarée, une jeunesse erratique
qui s'est consumée trop vite et que pourrait incarner la génération
de Guy Debord, née dans les années 1930», rectifie Patrick
Modiano. C'est précisément un mot du philosophe, en exergue du
livre, qui lui a inspiré ce titre. Modiano renchérit en citant
un vers de Rimbaud: «Oisive jeunesse/ A tout asservie/ Par délicatesse/
J'ai perdu ma vie.» On lui fait remarquer qu'après Quartier perdu,
son roman paru en 1984, ça fait tout de même deux de «perdus»...
Etonnement non feint: «Je ne l'ai pas fait exprès, je n'y avais
même pas pensé.» Là encore, rien de nostalgique: «Pour
moi, il s'agissait d'un quartier lointain, perdu dans la ville...»
Vraiment très grand - entre 1,95 et 1,98 mètre selon les sources,
on n'osera pas lui demander - Patrick Modiano est aussi un grand timide. Ses
pantalons un peu courts, sa façon mécanique de se mouvoir, comme
pour s'excuser d'occuper l'espace: on dirait un cousin éloigné du
M. Hulot de Jacques Tati. Derrière une inquiétude contenue, l'écrivain
a l'air, lui aussi, d'être parfois absent au monde. Ce qui ne l'empêche
pas de se montrer très attentif. On sent vite que cette gloire des lettres
françaises préfère s'intéresser aux autres plutôt
que de parler de lui. Fidèle à sa réputation, il peine toujours à finir
ses phrases, les ponctuant régulièrement de longs soupirs, après
avoir lâché «comment dire..., c'est difficile à expliquer...,
c'est très compliqué...». Mais il suffit d'aborder un autre
sujet que «sa vie son oeuvre» pour que ces hésitations s'évanouissent.
D'une prévenance inattendue, l'auteur de Rue des boutiques obscures, prix
Goncourt en 1978, reçoit sans façon dans son bel appartement du
VIe arrondissement parisien, qu'abrite un imposant immeuble du xviiie siècle.
Il vit là depuis 1991, avec Dominique, son épouse, sa complice
- près de quarante ans de mariage - petit bout de femme expansive et volubile.
L'exact contraire du grand écrivain, en somme. Plutôt son parfait
complément, avec qui il a eu deux filles - Zina, 33 ans, lancée
dans le cinéma, et Marie, 29 ans, chanteuse.
Parisien de longue date, passé du XIIIe au XIVe, du XVe au XVIIe arrondissement,
puis établi à Montmartre pendant de nombreuses années, Patrick
Modiano se retrouve donc à équidistance de la place Saint-Sulpice
et du jardin du Luxembourg, en plein Quartier latin. Le café de la jeunesse
perdue se trouve non loin, du côté de l'Odéon. Ce café imaginaire,
mélange de plusieurs établissements ayant réellement existé,
s'appelle le Condé, rendez-vous, dans les années 1960, d'une clientèle
bizarre, «bohème», des habitués qui avaient entre 19
et 25 ans. Parmi ces «chiens perdus» - dixit la patronne - la discrète
Louki, 22 ans, laisse planer un parfum de mystère, comme si elle voulait
fuir quelque chose. De son vrai nom Jacqueline Delanque, elle fascine le premier
narrateur, un garçon discret, étudiant à l'Ecole des mines,
qui n'a d'yeux que pour cette jolie brune aux yeux clairs et au profil si pur.
Caisley, faux éditeur d'art et véritable détective, ancien
des RG, prend ensuite la parole: il est chargé de retrouver Louki, pour
le compte de son mari, qu'elle a brusquement quitté et laissé sans
nouvelles depuis plusieurs mois. Louki elle-même s'exprime dans la troisième
partie du livre, levant un peu plus le voile sur son enfance tumultueuse, aux
abords du Moulin-Rouge, où frayait sa mère. Puis c'est au tour
de Roland de raconter son idylle avec la jeune femme, avant qu'elle ne lui échappe
pour toujours. Modiano signe là une fascinante partition à quatre
voix, procédé inédit chez lui. En revanche, on y retrouve
son style, épuré au possible, et tout ce qui fait aussi sa marque:
ces vestiges délicieux d'un temps où l'on téléphonait à «Auteuil
15-28», où l'on se guidait avec un vieux plan Taride, mais surtout
une atmosphère mystérieuse, pesante; une faune interlope, des personnages à la
dérive, en quête d'une nouvelle identité. A leurs errances
correspond à nouveau, comme dans la plupart des romans de Modiano, une
topographie parisienne très précise, qui entraîne le lecteur
de part en part de la capitale, de Mabillon à Pigalle, de Denfert-Rochereau à Neuilly,
de cafés louches en hôtels meublés, dont la plupart ont disparu.
A défaut de pèlerinage au Condé, va pour une petite promenade
jusqu'au café Fleurus, dans la rue du même nom, où l'écrivain
a ses habitudes et qu'il suggère lui-même comme décor pour
la photo. «Il ne faut pas croire que le Quartier latin a toujours été si
riche, si cher. Celui que j'ai connu dans les années 1950 avait un côté louche,
malfamé, les immeubles étaient délabrés, il y avait
beaucoup d'artisans.» Qu'on ne s'y trompe pas: Modiano se défend
de vouloir ressusciter ce Paris d'antan. «J'ai l'impression que le Paris
de mes livres est complètement intérieur, imaginaire. Les lieux
réels, ceux d'aujourd'hui, sont vides de ce que je leur prête dans
mes romans. Ils sont devenus des lieux uniquement liés à des choses
très précises dans mon esprit. Mes souvenirs se sont détachés,
ils sont autonomes. Je ne cherche pas du tout à préserver des images
du passé, je ne suis pas du tout un Robert Doisneau de la littérature.» Malentendu,
on vous dit... Depuis son Place de l'Etoile, en 1968, premier roman français à exorciser
la période taboue de l'Occupation, l'écrivain traque surtout un
passé qui le dépasse, qui le tourmente. La faute à l'histoire
de ses parents, si pleine de zones d'ombre: Albert Modiano, juif aux lointaines
origines italiennes, et Luisa Colpeyn, une Flamande apprentie comédienne.
Ils se sont connus dans le Paris occupé, évoluant dans une semi-clandestinité.
Né le 30 juillet 1945, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
le jeune Patrick vit longtemps dans l'incertitude des activités troubles
de son père, homme d'affaires étrange, pas très recommandable.
Arrêté en 1943 par la Gestapo, il fut interné au camp de
Drancy avant d'être libéré, contre toute attente, par un
membre de la Rue Lauriston. Pourquoi? Comment? Des questions qui n'auront jamais
de réponse.
Pourquoi ses parents furent-ils si peu aimants, délaissant leurs enfants
au gré de leurs occupations mystérieuses, abandonnant régulièrement «Patoche» à des
pensionnats de province? Comment surmonter la mort de son jeune frère,
Rudy, emporté par une maladie du sang à l'âge de 9 ans, en
1957? Des questions qui tournent à l'obsession, des fêlures au coeur
de l'oeuvre modianesque. «Quand on a des souvenirs énigmatiques,
on a besoin de les comprendre», souligne Modiano. Dans le café de
la jeunesse perdue renoue avec ces thèmes de la disparition et de la perte,
sur fond de grande mélancolie. «Je ne suis pas du tout nostalgique.
Mon enfance me fait horreur. Mais je suis habité par des images qui m'ont
frappé et se sont incrustées dans ma mémoire.» Image
de cette jeune voisine qui venait garder les enfants Modiano, quand la famille
habitait alors quai de Conti. «J'avais 8 ou 9 ans, mes parents nous confiaient
souvent à cette voisine très gentille. Il lui arrivait parfois
de me faire sauter l'école, la communale de la rue du Pont-de-Lodi, et
de m'entraîner avec elle dans les cafés. J'ai compris un jour que
son amie s'était suicidée.» Comme Louki... Image d'un Pigalle
illuminé, quand sa mère le laissait livré à lui-même
pendant qu'elle jouait au théâtre, rue Fontaine. «Je me souviens
de tous ces bars avec des filles devant. J'avais peur qu'on me demande ce que
je faisais ainsi, tout seul, à 14 ans.» Comme Louki... «Je
garde de tout cela des sensations très fortes, des impressions qui constituent
désormais une sorte d'intemporalité. Peut-être que, dans
la réalité, c'était plus banal. Peut-être que je rends
les choses plus intenses qu'elles n'étaient...» Ici est l'art singulier
de Modiano, cette intensité envoûtante du clair-obscur, cette densité du
non-dit qui ouvre la porte à toutes les interprétations. «Mes
romans sont comme un mille-feuille, avec des temps différents qui se chevauchent.
De même que mes personnages sont des amalgames.»
Pause. Son regard s'échappe à nouveau. Modiano touille les glaçons
de son Coca light, qu'il a mis tant de temps à choisir, qu'il ne touchera
pas, finalement... «Quelquefois, je me demande si mes livres sont vraiment
des romans, s'ils ne sont pas plutôt une romance, une sorte de musique
qui se poursuit de l'un à l'autre.» Une musique au-delà des
temps et des modes, que l'on ne se lasse pas d'écouter."
Delphine Peras, EXPRESS du 5-10-07
9.
La fugueuse par Annick Maître (Dans le Café de la
jeunesse perdue)
".Quatre voix narratives vont
tenter de cerner le personnage aux contours flous qui échappe à toute
analyse raisonnable malgré l’abondance de détails
concrets comme toujours chez Modiano. Il y a d’abord l’Etudiant
des Mines, prêt à abandonner ses études,
fasciné par les habitués qui l’entourent
. Il nous apprend que Louki n’est qu’un nom d’emprunt
donné par l’un des consommateurs habituels du Condé.
La jeune femme présente à heures fixes, accepte
les rituels du groupe sans vraiment y participer, ses lectures
ne sont pas celles des autres , si elle consomme alcool et peut-être
d’autres substances illicites, elles , rien ne le laisse
deviner. « Tout ce qui la rendait invisible au regard de
Bowing m’avait frappé. Sa timidité, ses gestes
lents, son sourire, et surtout son silence. » D’une
curiosité moins naïve que celle de l’étudiant,
Caisley , détective privé revenu de tout, s’interroge
aussi sur Louki mais dans un but bien précis : il est
chargé par le mari de celle -ci de la retrouver. « Sa
femme avait disparu depuis deux mois à la suite d’une
dispute banale. » Louki s’appelle donc Jacqueline
Delanque. Avec son époux puis seule, elle assistait avec
intérêt aux réunions d‘un ésotériste
parisien Guy de Vere qui la conseillait sur ses lectures. Caisley
apprend aussi que Louki n’a plus de famille et qu’elle
a commencé à fuguer très jeune. Sa mère
travaillait comme ouvreuse au Moulin Rouge et plutôt que
rester seule à l’attendre, elle a pris très
tôt l’habitude d’arpenter les rues du XVIII
e t leurs bars. Le vieux privé , décide de laisser
Jacqueline décider de sa vie ; l’enquête est
terminée pour lui. « De quel droit entrons-nous
par effraction dans la vie des gens et quelle outrecuidance de
sonder leurs reins e t leurs cœurs – et de leur demander
des comptes… » Une silhouette en marche passée
de Montmartre à Neuilly qui s’arrête quelquefois
au Condé, des silences, un passé occulté,
une totale solitude il n’en faut pas plus pour intéresser
Roland, apprenti écrivain passionné par l’Eternel
Retour et qui rédige un essai sur les « Zones neutres » .
Les deux jeunes promeneurs, sans attaches n’en finissent
pas d’arpenter Paris avant de se retrouver dans une chambre
d’hôtel impersonnelle. Pas de projets sinon immédiats,
peu de confidences, Jacqueline était aussi une inconnue
pour son dernier amant. C’est par hasard qu’il a
appris le nom d’une de ses anciennes amies. « Plus
tard, Jeannette Gaul lui rendait visite à l’hôtel
de la rue Cels et j’aurais dû me poser des questions
le jour où je les ai surprises dans la chambre où il
flottait une odeur d’éther. » C’est
par hasard également qu’il surprend la peur de Jacqueline
devant un inconnu « Je lui ai demandé son nom. Mocelli.
Et pourquoi elle voulait l’éviter. Elle ne m’a
pas répondu d’une manière claire. Simplement
ce type lui rappelait de mauvais souvenirs. » Le troisième
narrateur est Jacqueline elle-même qui se penche sur son
passé à l’occasion d’une promenade à Montmartre.
Les silences de sa mère « Nous ne sommes pas bavardes » ,
l’absence de toute autre famille, la résignation
, « Nous n’avons plus de charpente » , ses
fugues pour éviter l’angoisse, les postes de police,
les rencontres dans les bars puis son mari Jean-Pierre Choureau
et l’inquiétude que ses anciennes relations ne retrouvent
sa trace. « C’est vrai, j’avais peur même à Neuilly,
de tomber sur Accad. Je m’étonnais qu’il n’ait
pas trouvé ma trace quand j’habitais l’hôtel
rue de l’Etoile puis rue d’Armaillé. (…)
je suppose que tu n’as pas parlé à ton mari
des parties à Cabassud. » Pour conjurer les moments
qu’elle voudrait oublier , une seule issue s’offre à Jacqueline
: la fuite. « Mes seuls bons souvenirs sont des souvenirs
de fuite ou de fugue. Mais la vie reprenait toujours le dessus. » Des
personnages évanescents, un passé aux zones d’ombre,
quelques dates s’opposent comme toujours à une topographie
d’une précision extrême : les quartiers, les
rues, les bars. Modiano n’en finit pas de nous donner sa
carte de ce Paris-là." par
Annick Maître, CLICANOO.COM, 18
novembre 2007
10.
L'abonné absence (Dans
le café de la jeunesse perdue)
"Dans
le café de la jeunesse perdue situé au
coeur du Paris mythique de la fin des années 50, Patrick
Modiano réussit une nouvelle fois ce qu'il fait mieux
que personne : dresser des tables somptueuses pour des convives
absents. Dans le café de la jeunesse perdue, son dernier
roman au titre superbe, en est une nouvelle illustration.
Les grands thèmes qui marquent son oeuvre sont en place,
légèrement déformés par le livre,
mais toujours aussi solidement ancrés dans le style de
l'écrivain. L'idée que l'histoire est indéchiffrable,
que les personnages n'en comprendront jamais la signification
ou le sens. L'idée que les êtres fuient mais que,
dans cette fuite, des traces sont laissées et ne s'effaceront
pas. L'idée que le travail de l'écrivain passe
par le pistage de ces traces et leur mise en forme, leur emballement
pour la lecture, l'idée aussi que Paris (si possible à deux
pas de la Seconde Guerre mondiale) est un champ topographique
parfait pour que la chasse ait lieu et qu'elle ne se termine
jamais.
Dans le café de la jeunesse perdue vit Louki ou Jacqueline
Delanque, qui a fui son ancienne vie (un mari dans les assurances,
sa mère), comme elle fuira, d'une certaine façon,
la nouvelle. Louki se réfugie dans un bistrot parisien
au coeur du Quartier Latin des années 60 et tisse, avec
les clients, les habitués, les hommes, ce qu'on appellerait
aujourd'hui, un réseau.
L'originalité du projet de Modiano tient à l'époque à laquelle
il situe son intrigue (Louki évolue dans un Paris de carte
postale, d'intellectuels, d'étudiants, d'artistes), vive
et pétillante, mais aussi à la méthode retenue.
Le tempérament fugueur de la jeune femme (une autre caractéristique
de Modiano, l'art de la fugue) est traduit par une recomposition
fragmentaire obtenue par le croisement de plusieurs narrations.
Les narrateurs se succèdent : la fille, un flic/détective
qui enquête sur la disparition de la jeune femme, puis
un ancien amant.
Dans l'absence, le vrai portrait se dessine à la croisée
des différents récits, en creux, à la fois
présence et manque absolu. L'art de Modiano réside
dans cette manière de dresser des tables pour des convives
absents.
Le récit du Paris mythique de la fin des années
50 et du début des années 60 est savoureux, précis.
On y retrouve d'ailleurs quelques figures connues, quelques fantômes
de la Collaboration. Mais cela constitue, pour nous les lecteurs
modernes, aussi une sorte de talon d'Achille. Il n'est, en effet,
pas certain que le passé de Modiano ne soit juste qu'un
fantasme d'ancien monde, une sorte de mausolée un rien
enfariné qu'il nous ressert à chaque fois. Comme
les évocations d'un Audiard (en mieux évidemment),
son espace narratif est terriblement séduisant. Cependant,
en raison de ses choix topographiques, ce n'est pas toujours
représentatif d'une totalité du temps. Bien sûr,
là n'est pas l'ambition d'un roman qui, comme les autres,
est bien plus métaphysique ou philosophique que documentaire
ou historique. Toutefois, on peut, comme on le ferait chez Michel
Rio, trouver que les qualités d'écriture de Modiano
enlèvent parfois un peu de carne et de corps à son
récit.
La chute de Louki, au demeurant, et la chute du livre sont déchirantes
et superbement écrites. Modiano, roman après roman,
cultive une économie de moyens qui mène à une
débauche d'émotions. Sa phrase est une phrase ligne
claire, par sa syntaxe et son rythme, une petite route de province
qui permet d'atteindre en ligne droite des vitesses saisissantes.
De l'analyse, du fluide, du flou pour du vrai. Ou 150 pages d'artisanat
traditionnel." Par Benjamin
Berton, Fluctuat.net. octobre 2007.
11.
Dans le café de la jeunesse perdue par Nathalie
Crom
"
Il
est plus que temps d'arracher à Patrick
Modiano, à ses livres, l'étiquette « nostalgique » dont
si souvent on les affuble. L'obsession passéiste, ce n'est
vraiment pas l'affaire de l'écrivain. Et si le passé revient
en ses pages, d'entêtante façon, ce n'est jamais
nimbé de l'aura doucereuse du regret. Le passé -
le Paris des années 50 et 60 où il a grandi, les êtres
côtoyés puis perdus de vue, les patronymes un jour
entendus... -, Patrick Modiano en a certes fait son matériau
poétique, mais l'agencement de ces fragments de mémoire,
patiemment recommencé à chacun de ses livres, n'est
pas une recherche du temps perdu, plutôt une authentique
et saisissante entreprise métaphysique - une tentative
de déchiffrement de l'énigme humaine dont la profondeur
et l'acuité hissent Patrick Modiano au rang des poètes,
et des plus grands parmi ceux-là.
Ainsi
de ce nouvel opus, dont le titre, Dans le café de
la jeunesse perdue, est emprunté à Guy Debord,
et dont l'intrigue trouve des échos dans l'oeuvre antérieure
de l'écrivain, hantée par l'obsession de la disparition,
de l'évanescence de toute chose, de l'absence. L'enquête
- appelons ainsi cette très belle construction romanesque
- porte sur une jeune femme : Louki, la surnomme-t-on, parmi
les habitués du café de Condé où elle
a coutume de venir s'asseoir, entrant toujours par « la
porte la plus étroite, celle qu'on appelait la porte de
l'ombre ». Au café de Condé, au coeur du
VIe arrondissement, en ce début des années 60,
se réunit une bande hétéroclite et bohème
: des intellectuels, des poètes - il y a là notamment
Olivier Larronde, Arthur Adamov -, des artistes ou se prétendant
tels, des étudiants plus ou moins en rupture de l'université.
Chacun, dans cette assemblée informelle, a le droit de
s'inventer une identité, une existence rêvée
- « A mesure que vous la racontez, cette vie imaginaire,
de grandes bouffées d'air frais traversent un lieu clos
où vous étouffiez depuis longtemps. [...] Vous
avez, de nouveau, l'avenir devant vous », note l'un des
personnages.
Louki,
comme chacun ici, a son secret : un autre nom, une autre vie,
une enfance dont elle s'est évadée - et, plus
secret encore que tout cela, une fragilité intime, un
désarroi dont elle ne dit rien et auquel elle n'a de cesse
de tenter d'échapper par la fuite. Quatre voix se succèdent,
au fil du roman, pour dire chacune une partie de l'histoire de
la jeune femme, y apporter des éléments neufs.
Louki elle-même est l'une de ces voix. On entend également
celle d'un jeune étudiant qu'elle a côtoyé au
café de Condé. Celle encore d'un mystérieux
détective privé. Celle enfin de Roland, l'amant
de Louki, apprenti écrivain cherchant dans la ville ce
qu'il appelle les « zones neutres » : des lieux « intermédiaires »,
des « no man's land où l'on était à la
lisière de tout, en transit, ou même en suspens ».
Louki
et Roland forment un couple comme on en a déjà croisé souvent
chez Modiano, jeunes gens sans attaches, errant dans les rues
de la ville et semblant, au fil de leurs itinéraires aléatoires,
en dessiner une topographie clandestine, comme un message codé.
Des indices énigmatiques, Modiano en sème à tout
ins¬tant dans ce roman qui, en d'intouchables profondeurs,
semble irrigué par la mystique, la gnose, une fréquentation
intime et vagabonde des poètes, de Yeats à Cendrars
via Mallarmé ou Nietzsche, auquel Roland tente d'emprunter
la conviction de l'Eternel Retour - le temps non pas linéaire,
entraînant irrésistiblement l'individu vers sa fin,
mais susceptible d'être surmonté, vaincu, transcendé par
la volonté ou le désir. Mais tous ces indices,
on se perdrait assurément à vouloir un à un
les décrypter, faisant de ce Café de la jeunesse
perdue le roman à clés qu'il n'est pas - car il
est, à l'évidence, une variation nouvelle, poignante,
lumineuse et tragique, de cet admirable poème dont Patrick
Modiano a entrepris la composition il y a tout juste quarante
ans. Nathalie Crom, Telerama
n° 3012 - 06 octobre 2007
12.
Modianissimo (Dans le café de
la jeunesse perdue) par Jean-Paul Enthoven
"C'est en (déjà) vieux routier de l'évanescent,
en éternel archéologue du sfumato urbain et des
destins brumeux que Modiano revisite, cet automne, son « Café de
la jeunesse perdue ». Au comptoir, figées dans une
mélancolie très sixties , on retrouve donc la plupart
des créatures qui font l'ordinaire de sa zoologie : brouillons
d'humains, silhouettes, flics en filature, affairistes au patronyme
prometteur, esquisses d'individus flottants avec, au fond de
la salle, Arthur Adamov ou Olivier Larronde. L'intrigue, cette
fois, se noue au carrefour de l'Odéon et autour d'une
femme, Louki, alias Jacqueline : une évaporée peinte
au pochoir, une disparue dont le narrateur suit la trace à travers
tout un entrelacs de rues, de quartiers, d'hôtels, d'impasses
- avec la Seine comme ligne de démarcation. La disparue était
une femme sans qualités , elle fréquentait des
cercles ésotériques et des maquerelles de la place
Blanche - ce qui suffit amplement à enclencher la mémoire
modianesque. Impossible, on s'en doute, de résumer cette
histoire contée, à tour de rôle, par les
témoins qui croisèrent jadis la jolie Louki. Seul
importe ici, comme d'habitude, la recension des lieux qui ne
sont plus, des horizons défunts, des zones de brouillard,
des êtres qui s'y sont engloutis. Signalons encore aux
vrais toxicos de Modiano que son opus mentionne quatre-vingt-trois
rues ou squares parisiens ; que le mot « étrange » -
ce mot-modiano qui sert d'enseigne à sa boutique spécialisée
dans la vente d'articles flous - apparaît dès la
seizième ligne : n'est-ce pas par ce genre de comptabilité qu'on
distingue désormais un nouveau Modiano du précédent
ou du suivant ? Mais cette obsession topographique n'est pas
gratuite, tant le romancier et ses antihéros ont besoin
de repères, d'itinéraires, d'adresses précises,
afin de mimer quelque appartenance à une réalité que
tout, en eux, congédie par ailleurs. L'ensemble est parfait.
C'est une version épurée et humide des registres
de mains courantes qu'on trouve dans les commissariats. C'est
un galet compact qui ricoche sur l'eau trouble d'un lac rempli
de passé et de questions auxquelles nul ne répond."
par Jean-Paul Enthoven
27/09/2007,
- © Le Point N°1828-
12.
Mélancolie Modiano par
Bernard Pivot
"Plus on lit et relit Patrick Modiano, plus on est frappé par
la cohérence - de rares imbéciles disent uniformité -
de son œuvre. La campagne, les toits de chaume et les petits
oiseaux étant absents de ses romans, on ne saurait dire
qu'il laboure son champ en profondeur. On choisira plutôt
comme métaphore le chauffeur de taxi qui sillonne Paris
en tous sens en emportant des femmes et des hommes chaque fois
différents. Mais il a ses préférés:
les humbles, les taiseux, les égarés, les voyageurs énigmatiques.
Dans les années 1960, au Condé, café proche
du carrefour de l'Odéon, l'une des habitués, la
jeune Louki, était particulièrement mystérieuse.
Elle accrochait bien la lumière, mais elle entrait toujours
par la porte étroite, celle de l'ombre, et, somme toute,
silencieuse, y restait.
Dans le café de la jeunesse perdue, le nouveau roman
de Patrick Modiano, est l'un de ses plus poignants. Mais, comme
toujours, sans trémolos. Enquête et filature. Souvenirs
et témoignages. Questions sans réponses. "Alors,
vous trouvez votre bonheur ?" Où Louki le trouverait-elle,
son bonheur ? Dans les cafés ? Dans les livres ? Dans
un vagabondage piétonnier ? Dans le mariage ? Dans la
fuite ? Elle aura tout essayé, y compris la drogue et
l'ésotérisme, mais, comme tant d'autres, elle sera
balayée par le temps.
Au collège du Montcel, à Jouy-en-Josas, dont il était
l'un des pensionnaires, Patrick Modiano a rencontré des "enfants
mal-aimés, des bâtards, des enfants perdus [...]
La plupart de ces braves garçons n'auraient pas d'avenir" (Un
pedigree). L'un de ses romans s'intitule d'ailleurs De si braves
garçons et commence par une évocation de ces "enfants
du hasard et de nulle part". Il a été l'un
d'eux, et probablement aurait-il eu comme eux un destin médiocre
s'il n'avait été saisi très tôt par
la lecture et l'écriture. Patrick Modiano est resté,
comment dire ? affectueusement proche de ses camarades sans avenir.
Si proche qu'on les retrouve dans ses romans, en particulier
celui-ci où Louki, qui se prénommait en vérité Jacqueline,
ne cesse de nous séduire, de nous intriguer, de nous déconcerter
et de nous émouvoir.
Insaisissable, elle fuit parce que
tout ce qui pourrait la retenir se dérobe peu à peu sous son mal de vivre. L'un
des habitués du Condé notait sur un cahier les
noms des clients, avec la date et l'heure exacte de leur passage.
Il appelait cela des "points fixes". Ce travail bizarre
lui était mentalement nécessaire. Tel autre personnage,
un policier privé chargé par son mari de retrouver
Louki, comprend que l'on ait besoin d'un ancrage. « Dans
cette vie qui vous apparaît quelquefois comme un grand
terrain vague sans poteau indicateur, au milieu de toutes les
lignes de fuite et les horizons perdus, on aimerait trouver des
points de repère, dresser une sorte de cadastre pour n'avoir
plus l'impression de naviguer au hasard. » Mais Paris est
une ville rebelle à la possession. Il y a des frontières,
des zones neutres et même des trous noirs. Meublés,
cafés, hôtels. Quels points fixes ? Quels points
de repère ? Louki n'a pas emporté la clé du
domicile conjugal. Elle ne reviendra jamais.
Ce qui est une nouvelle
fois fascinant dans ce roman, c'est l'habileté de Patrick Modiano à disperser son autobiographie
dans ses principaux personnages. Chacun n'est évidemment
pas lui et chacun est tout naturellement un peu lui. Il se rappelle,
il évoque, il adapte, il transpose. Des phrases de Modiano,
si simples et si travaillées, vibrent d'une tension douloureuse
qui remonte à son enfance. Nul ne sait mieux que lui exprimer
le désir d'autre chose, mais quoi ? L'envie d'être
ailleurs, mais où ? L'espoir d'une autre vie, mais quand
? Il a souffert de la solitude, et si une autre solitude, celle
de l'écrivain, en a pris le relais, il a si peu oublié la
première qu'il la restitue avec une sensibilité à vif
depuis cinquante ans. Ne jamais confondre chez Modiano la mélancolie
avec la nostalgie. Ni l'errance avec la flânerie.
Autre
particularité de la manière Modiano: une
extrême précision des lieux, une incertitude chronique
des dates. Tandis que le romancier entraîne ses personnages
et ses lecteurs de l'Odéon à Neuilly, de Pigalle
au square Lowendal (15e), de la rive gauche à la rive
droite et inversement - la Seine est pour Louki "une ligne
de démarcation", un "rideau de fer" -,
l'auteur de La place de l'étoile, des Boulevards de ceinture,
de Rue des Boutiques Obscures, de Quartier perdu, de Dans le
café de la jeunesse perdue laisse au temps la bride sur
le cou. Un peu de météorologie, jamais de calendrier.
Le charme poétique de Modiano repose sur une géographie
rigoureuse et une chronologie chahutée. Ce n'est pas lui
qui commencerait une fiction par "en ce temps-là".
Il préférera "en ce lieu-là".
Puis le temps envahira la scène de son obscure clarté." par
Bernard Pivot, Le Journal du dimanche, 09 Octobre 2007.
13. Le Paris fugace de Patrick Modiano
par Colette Khalaf
<< Sur les banquettes du café Condé, lieu
de rencontre de bohèmes, d’étudiants et de
personnes en marge de la vie, Patrick Modiano, en topographe
de la Ville
Lumière, suit le tracé d’un nombre de personnages
et entraîne le lecteur avec lui dans une douce mélancolie. « Dans
le café de la jeunesse perdue », son dernier roman, édité chez
Gallimard, c’est l’atmosphère des années
soixante qui est restituée avec tout ce qu’elle
illustre comme naissance d’idéologies et éclosion
d’espoirs et d’illusions.
Le
lieu où se déroule l’action est un café imaginaire
baptisé Le Condé qui charrie avec lui des parfums
d’autres cafés célèbres de la ville
de Paris. C’est là où se rencontrent certains
habitués, dont les quatre narrateurs du roman. : un étudiant
des Mines, un ancien des RG, Youki alias Jacqueline Delanque
et Roland, jeune apprenti écrivain.
L’histoire est donc narrée par ces quatre personnages.
Quatre regards différents jetés sur une seule et
unique vie, celle de Youki.
Mais qui est cette femme qui, « des deux entrées
du café, empruntait toujours la plus étroite, celle
qu’on appelait la porte de l’ombre » ? Qui
est cette Jacqueline Delanque qui intrigue les trois autres personnages
aux vies qui s’entrecroisent dans ce Café de la
jeunesse perdue ?
La réponse, c’est l’héroïne elle-même
qui la donnera dans la dernière partie du roman, lorsqu’elle
racontera son enfance, ses fugues, ses rencontres et ses amours.
Dans ce café imaginé par Patrick Modiano, on a
surtout rendez-vous avec la poésie. Une poésie
en filigrane, sous-tendue par une ambiance que tissent les personnages égarés.
Dans ces « zones neutres » que seul le romancier
sait dessiner.
«
Dans cette vie qui vous apparaît quelquefois comme un grand
terrain vague sans poteau indicateur, au milieu de toutes les
lignes de fuite et les horizons perdus, on aimerait trouver des
points de repère, dresser une sorte de cadastre pour n’avoir
plus l’impression de naviguer au hasard. Alors on tisse
des liens, on essaye de rendre plus stables des rencontres hasardeuses »,
confie Modiano.
Des images restituées au passé ? Le romancier s’en
défend. C’est plutôt un Paris imaginaire,
non ressuscité parce qu’intérieur, que livre
l’auteur. En flash-back reconstitués, voire apprivoisés,
Modiano confie ses errances et ses fêlures de cœur,
ses faiblesses et ses questionnements.
Le non-dit succède au dit et le clair à l’obscur.
Comme des strates de vie, qu’il attribue à ses personnages,
particuliers et multiples. « Mes romans sont comme un mille-feuille,
a-t-il dit un jour, avec des temps différents qui se chevauchent.
De même que mes
personnages sont des
amalgames. » >> © l'Orient, le jour du 3 décembre
2008.
~~~~~~~~~~
Darnand (Joseph)
<<
Joseph Darnand, 47ans, chef de la Milice, secrétaire d’Etat
au Maintien de l’Ordre, est l’homme fort de la
période
qui s’ouvre. Il siège au gouvernement, tandis que
ses miliciens, uniformes noirs, bérets noirs, terrorisent
villes et campagnes, traquant les résistants, assassinant
les juifs, torturant au gré de leurs haines. Avec l’arrivée
de la guerre sur le sol français, la rage des miliciens,
eux-mêmes pourchassés par la Résistance,
atteint son paroxysme. Et le pouvoir de Darnand, dans un pays
où l’Etat se délite, où l’occupant
recherche des supplétifs sans états d’âme,
s’accroît encore.
La guerre est l’élément de Darnand. Elle
a permis à ce fils d’employés des chemins
de fer d’échapper à un destin ordinaire.
La Grande Guerre l’a vu finir adjudant, décoré,
héros. La campagne de 39-40 lui a permis de se distinguer à la
tête d’un corps franc, petite unité mobile,
qui a sauvé l’honneur français... Entre ces
deux guerres, il a rongé son frein. Refusé à l’école
d’officiers pour cause d’insuffisance sociale et
intellectuelle, il a cumulé les métiers... et réchauffé sa
bile dans les mouvements nationalistes: royaliste à l’Action
française, puis terroriste à la Cagoule, une organisation
clandestine qui voulait renverser la République par la
violence. La défaite de juin 1940 a ouvert au déménageur
niçois les chemins de la politique. Régénérer,
nettoyer, redresser la France? Il en rêve. Responsable
local de la Légion des Combattants, une troupe paramilitaire
alors pro-Pétain à Nice, il en gravit les échelons.
Il accompagne la transformation de la Légion en Milice.
Il passe de l’admiration de Pétain à l’orbite
de Laval. Lui, l’anti-boche de 14 et de 40, devient l’auxiliaire
et l’allié des SS. La simple évocation de
son nom suffit à semer la terreur. Philippe Henriot semble être
le contraire de Darnand. Un lettré, une voix mâle,
superbe, un vocabulaire d’une précision infaillible
alors que Darnand n’est qu’un soudard au langage
simpliste et à la voix de fillette. Les deux hommes pourtant,
entrés ensemble au gouvernement sous l’influence
conjointe de Laval et des Allemands, sont en parfait accord.
Né en 1889 dans une famille droitière, catholique
et antisémite, député en 1932 et 1936, Philippe
Henriot a rejoint la Milice de Darnand, dont il est le chantre
attitré. Deux fois par jour sur Radio-Paris, il pourfend «les
ploutocrates de la City et les judéo-bolcheviques de l’Est
européen», insulte les résistants, défie
ses adversaires de la radio anglaise. Même les pro-résistants écoutent
ses philippiques. Henriot est haï, menacé de mort.
Il affecte de s’en moquer.>> Claude
Askolovitch Nouvel Observateur, 3 juin 2004 - n°2065_2
- Dossier
D
Day 6 juin 1944
Ce site est remarquablement riche en photos d’archive. Il est également
fourni en détails historiques, en cartes et en liens.
Débarquement
de Normandie
Ces pages déclinent le Débarquement par
thèmes: le récit historique, de nombreuses photos,
une bibliographie, une filmographie, des forums, etc. La navigation
est facile. Le site est également en anglais.
Débarquement.
Dossier du quotidien Ouest-France
Des récits individuels de témoins, soldats ou civils, du 6 juin
1944 : que faisaient-ils ? Comment ont-ils vécu ce moment d’Histoire
? Qu’ont-ils ressenti ? etc. Un regard humain simple, sensible et sans
fioritures.
Guy
Debord
1. «Quand j'avais huit ou neuf ans, il y avait une fille
dans mon immeuble, une étudiante aux Beaux-Arts américaine,
qui me gardait et m'amenait dans des cafés du quartier, à Saint-Germain-des-Prés.
Elle avait deux amis, Patrick et Henri. A vingt ans, Debord
les avait fréquentés. Je les écoutais
parler de lui. Je l'ai lu assez tardivement, et seulement ses
textes autobiographiques, comme Panégyrique... Les textes
politiques ne m'intéressent pas.» Cité
Par Philippe Lançon dans Libération, le 4 octobre
2007.
2. N.O.- Vous empruntez le titre, «Dans le café de
la jeunesse perdue», à Guy Debord. On ne vous
imagine pourtant pas lire l'auteur de «La société du
spectacle»...
P. Modiano. - Debord qui, lui-même, a emprunté à Dante
le début de sa phrase: «A la moitié du
chemin de la vraie vie, nous étions environnés
d'une sombre mélancolie....» De Debord, je n'ai
vraiment lu que les textes les plus personnels, comme «Panégyrique», «In
girum...» ou «Cette mauvaise réputation.» Mais
il est lié à mon enfance de manière inexplicable.
Peut-être est seulement l'idée que je me faisais
des quartiers que lui et les situationnistes fréquentaient...
Entretien
avec Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur",
27 septembre 2007
De
si braves garçons
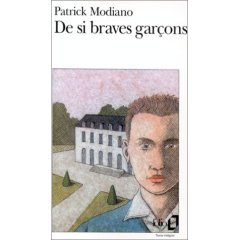 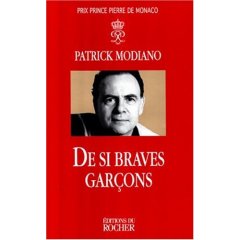
De
si braves garçons [1982] Collection blanche, Gallimard
et Collection Folio (No 1811) (1987)
Quatrième de couverture : Aux environs de Paris, le collège
de Valvert, surnommé le Château en raison de son
parc, de ses pavillons et de ses bois, a pour pensionnaires de
«braves garçons» plus ou moins abandonnés
par leurs familles - des gens riches ou ruinés, instables,
cosmopolites, suspects. Ils y poursuivent leurs études
en nouant des amitiés, soit entre eux, soit avec leurs
professeurs tout aussi pittoresques. Puis la vie les disperse.
Vingt ans passent. Grâce à sa mémoire en pointe
sèche et à sa curiosité, le narrateur - qui
est peut-être Modiano lui-même - recompose l'atmosphère
ancienne tout en menant une sorte d'enquête sur ce
que le temps a pu faire de ses anciens camarades.
Ces souvenirs rejoignent sans cesse le présent, au fil
d'une réalité faite de rêve et de nostalgie.
De
si braves garçons,
premières pages
Découragement
/ Fausse route*
"Quand j'écris un roman, c'est comme si je
conduisais une voiture sans visibilité. Il y a parfois
du découragement. Je me demande si je n'ai pas fait fausse
route". Entretien avec Myriam CHAPLAIN-RIOU,
AFP, à l'occasion d la publication de l'Horizon, février
2010
Décrire
" Il est plus facile de décrire sans raconter que
de raconter sans décrire"
Gérard Genette, Figures II, Collection Poétique
Éditions du Seuil, Paris, 1969, p. 57.
Dédicaces
Rudy Modiano, le frère mort d'une maladie du sang, à 10 ans,
en 1957.
Dominique Zerfuss, l'épouse ; à Zina et Marie, les enfants, à Douglas le chien,
à queqlues exceptions près, le père et la mère et à Robert
Gallimard, l'éditeur.
Dédicaces
(fausses)
"A propos de vos débuts, est-il exact que vous faisiez
de fausses dédicaces sur des livres ?
Oui, quand j'avais 19 ou 20 ans, je vendais des livres et certaines
écritures étaient faciles à imiter, comme
celles de Paul Valéry ou de Malraux. J'ai fait ça
trois ou quatre fois pour gagner de l'argent, ça ne pouvait
pas être systématique. Après, c'est devenu
un jeu : quand je voyais une bibliothèque, chez les gens,
je m'amusais à composer des dédicaces fantaisistes,
de Simone de Beauvoir à Luis Mariano, par exemple. Les
gens y croyaient vraiment... Un jour, dans la vitrine d'une librairie,
rue de Vaugirard, j'ai vu un livre de Robbe-Grillet, dédicacé
à je ne sais plus qui, et j'ai reconnu ma signature ! Parfois
la réalité rattrape la fiction : je me rappelle
avoir imité une dédicace de Beckett pour un chansonnier
des années 1960, Pierre-Jean Vaillard, je crois. En fait,
ils se connaissaient, je l'ignorais..." Entretien
avec Marianne Payot, Delphine Peras, "Je suis devenu comme
un bruit de fond", l’Express, 04/03/2010
Déformé
<< Il faut déformer, concentrer[...]. Les gens, lorsqu’ils
se reconnaissent dans mes livres, me disent « c’est
scandaleux, c’est un mensonge ». En un sens, ils ont
raison. Mais en même temps, c’est la vérité
poussée jusqu’à ses ultimes conséquences.>>
Le Monde, 24 mai 1973.
Catherine
Deneuve : "Je lui ai proposé son seul rôle au
cinéma", témoignage.
La comédienne aurait bien voulu adapter ses textes sur
écran.
« JE SAVAIS qu'il avait connu ma soeur, et qu'il écrivait
un texte sur elle (*). Je l'ai rencontré à plusieurs
reprises. Avec lui, il y a des choses dont on ne parle pas. C'est
quelqu'un de délicat. Je l'admire beaucoup. Et l'homme,
et l'écrivain. Il a créé un monde un peu
à part, son univers.
Un jour, je lui avais demandé de jouer un petit rôle,
celui d'un écrivain, dans le film où je tournais
(Généalogies d'un crime, réalisé par
Raoul Ruiz, sorti en 1997). Et à ma surprise et à
mon grand bonheur, il avait accepté.
En tant qu'écrivain, je trouve qu'il inspire beaucoup de
choses. De la nostalgie, bien sûr, mais pas que cela.
À chaque fois que je le lis, je me dis que ce roman ferait
un très beau film. Puis on se heurte à la difficulté
de l'adapter sur écran. Pourtant, ses récits me
parlent : je vois les personnages, les lieux, les descriptions...
C'est très concret. Mais à chaque fois que j'ai
essayé de les transposer sous forme de scène, il
y a quelque chose qui m'échappe ; et qui, je crois, échappe
à tous ceux qui ont eu envie de monter des films avec ses
livres. Ses mots sont particuliers ; ses évocations sont
fortes, visuelles même, mais elles restent - sans que l'on
sache trop pourquoi - difficiles à enfermer dans un écran.
Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire ? Vous savez, il ne parle
pas beaucoup. J'aurais plutôt envie de lui envoyer une carte
postale, ce que je ne manque pas de faire de temps à autre.»
(*) Le titre en est « Elle s'appelait Françoise...
» (Éditions Albin Michel-Canal +). Dans ce livre,
publié en novembre 1996, se trouve également un
entretien de Catherine Deneuve par Anne Andreu. Le
Figaro du 27 septembre 2007
Annie
Demeyère, Portraits de l'artiste dans l'oeuvre de Patrick
Modiano Editions L'Harmattan, 2002 - 271 pages (Google
book)
Déportation
continue (la)
Avant comme après le débarquement allié en
Normandie, les arrestations et déportations de juifs se
poursuivent. Au cours du seul mois de mai, le camp de Drancy
a enregistré 2604 entrées. Et encore 178 dans les
six premiers jours de juin. Au 6 juin, on y dénombre 932
prisonniers en attente d’être déportés.
Le 15 mai, 878 hommes ont été emmenés à Kaunas
(Lituanie) et Reval (Estonie). Deux trains ont quitté Drancy
pour Auschwitz les 20 mai (1200 personnes, dont 191 enfants)
et 30 mai (1004 personnes, dont 104 enfants). A l’arrivée
de ce convoi (n° 75), le 2 juin, 624 personnes ont été immédiatement
gazées. Le poète Benjamin Vecsler, né en
Roumanie en 1898, faisait partie de ce convoi du 30 mai. Sous
le nom de Benjamin Fondane*, il laisse une oeuvre
importante, dont ce poème-testament, écrit en 1942:
Sur les fleuves de Babylone"
C’est à vous que je parle, homme des antipodes,
je parle d’homme à homme
avec le peu en moi qui demeure de l’homme,
avec le peu de voix qui me reste au gosier;
mon sang est sur les routes, puisse-t-il, puisse-t-il,
ne pas crier vengeance (...)
Un jour viendra, c’est sûr, de la soif apaisée,
nous serons au-delà du souvenir, la mort
aura parachevé les travaux de la haine,
je serai un bouquet d’orties sous vos pieds;
alors, eh bien, sachez que j’avais un visage
comme vous, une bouche qui priait comme vous.
(...) Tout comme vous, j’étais méchant et
angoissé,
solide dans la paix, ivre dans la victoire
et titubant, hagard, à l’heure de l’échec...
Et pourtant, non.
Je n’étais pas un homme comme vous.
Vous n’êtes pas nés sur les routes,
personne n’a jeté à l’égout
vos petits
comme des chats encore sans yeux,
vous n’avez pas erré de cité en cité
traqués par les polices,
vous n’avez pas connu les désastres, à l’aube
les wagons à bestiaux
et le sanglot amer de l’humiliation,
accusé d’un délit que vous n’avez pas
fait,
du crime d’exister,
changeant de nom et de visage
pour ne pas emporter un nom qu’on a hué,
un visage qui avait servi à tout le monde
de crachoir!
Un jour viendra sans doute, quand ce poème lu
se trouvera devant vos yeux.
Il ne demande rien! Oubliez-le, oubliez-le! (...)
Mais quand vous foulerez ce bouquet d’orties
qui avait été moi, dans un autre siècle,
en une histoire qui vous semblera périmée,
souvenez-vous seulement que j’étais innocent
et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là,
j’avais eu, moi aussi, un visage marqué
par la colère, par la pitié et la joie,
un visage d’homme, tout simplement.
détails* (Négliger
les petits)
<< Un soir, dans l'escalier, mon père m'a dit une phrase que je
n'ai pas très bien comprise sur le moment - l'une des rares confidences
qu'il m'ait faites : "On ne doit jamais négliger les petits détails.
Moi, malheureusement, j'ai toujours négligé les petits détails." Ephéméride,
2002, Mercure
de
France, ed.
La
description
" La description servait à situer les grandes lignes
d'un décor, puis à en éclairer quelques éléments
particulièrement révélateurs; elle ne parle
plus que d'objets insignifiants ou qu'elle s'attache à
rendre tels. Elle prétendait reproduire une réalité
préexistante; elle affirme à présent sa fonction
créatrice. Enfin, elle faisait voir la chose et voilà
qu'elle semble maintenant les détruire, comme si son acharnement
à en discourir ne visait qu'à en brouiller les lignes,
à les rendre incompréhensibles, à les faire
disparaître totalement."
Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Editions
de Minuit (Gallimard) Collection Idées, Paris, 1963, pp.
159 et 160.
La
destruction d'une famille, 1940-1945 par Jean-Louis
Steinberg
La
2e division blindée
(2e DB)
est l'unité chargée
de libérer la capitale. Son commandant, le général
Leclerc, est l'un des chefs les plus illustres de la France libre.
Rattachée à la 3e armée américaine
du général Patton et forte de 14 500 hommes, la
division débarque le 1er août 1944 sur les plages
de Normandie.
Déportation
des juifs de France (la), "La tragédie juive
de 1942 en France : ombres et lumière"
par Serge Klarsfeld
<< Un nombre important de Justes (environ 1 700) de France ont été individuellement
honorés, et un dictionnaire ( Dictionnaire des Justes
de France, Fayard) vient d'exposer quel fut l'engagement de chacun
d'entre eux pour sauver des vies juives. Il y eut certainement
en France beaucoup plus de Justes que ceux que l'on reconnaîtra
comme tels.J'ai toujours affirmé que la quasi-totalité des
juifs qui ont survécu dans notre pays ont bénéficié à un
moment ou à un autre d'un acte de solidarité de
la part de la population non juive. Individuellement toutefois,
il faut insister là-dessus, les Justes n'auraient pu obtenir
ce qui a été obtenu : c'est-à-dire la survie
de trois quarts des juifs de France : 80 000 victimes (76 000
déportés, 3 000 morts dans les camps en France,
un millier d'exécutés ou d'abattus sommairement)
et 240 000 survivants ; statistiquement le moins terrible bilan
de toutes les grandes communautés juives d'Europe.Dès
1983, dans Vichy-Auschwitz, j'ai mis en lumière
l'agent principal de cette survie : la réaction collective
et spontanée de la majorité de ces Français
qui ont exprimé leurs points de vue quand ils ont été confrontés
en zone libre à l'arrestation de familles juives par la
police française et à leur livraison aux Allemands
en zone occupée pour être déportés. Très
peu ont approuvé ; beaucoup ont critiqué ou
condamné ces mesures prises dans un territoire où il
n'y avait ni Gestapo ni troupes allemandes d'occupation. Leur
influence sur le gouvernement de Vichy, maître tout- puissant
de la vie de 300 000 juifs parfaitement recensés et facilement
arrêtables, a été déterminante dans
le bon sens.Pour le constater, il est important de revenir sur
l'enchaînement
des événements qui ont conduit le régime
de Vichy à s'associer à la criminelle « solution
finale » et à se déshonorer à jamais.
Il le faut afin de montrer comment la réaction de l'opinion
publique en zone libre, là où elle pouvait s'exprimer
avec moins de risques qu'en zone occupée, a entraîné d'exceptionnelles
conséquences. Le
6 mai 1942, à Paris, Reinhardt Heydrich, chef de la
police du IIIe Reich, rencontre René Bousquet, chef de
la police de Vichy. Il l'informe qu'il disposera de trains pour
déporter, en 1942, 5 000 juifs internés en zone
occupée. En réponse, Bousquet lui propose, pour
la déportation, les juifs étrangers internés
en zone libre.Cette ouverture inattendue est retenue par les
Allemands, qui, à la
demande de Bousquet, éliminent Louis Darquier de Pellepoix
et sa police aux questions juives du rôle de rafleurs des
juifs pour confier cette mission à la police nationale
de Bousquet, jugée plus digne de leur confiance. Le
11 juillet 1942, à Berlin, la mise en oeuvre de la « solution
finale » dans les pays de l'Ouest européen est programmée
: rapidement est fixé pour la France un contingent de
40 000 juifs à déporter dans un premier temps.Le
16 juin, les chefs SS Karl Oberg et Helmut Knochen (ce dernier
vient de mourir en Allemagne) obtiennent l'accord de Bousquet
pour la livraison de 10 000 juifs étrangers en zone libre.Cet
accord va sceller le destin de ceux qui feront partie des 80
000 victimes : en effet, si la police française se
prépare à arrêter les juifs en zone libre,
comment le gouvernement français pourrait-il s'opposer
aux mêmes persécutions en zone occupée ?
Pierre Laval n'a certainement pas été informé par
Bousquet de ce scabreux accord policier du 16 juin puisque, au
cours du conseil des ministres du 27 juin, il est noté : « Ce
matin, visite de M. Bousquet qui a apporté un télégramme.
M. Leguay [délégué de Bousquet en zone occupée]
a été prié par le capitaine Dannecker [chef
du service des affaires juives de la Gestapo] de venir le voir.
Aux termes de l'accord on devrait interner 10 000 juifs en zone
libre. M. Pierre Laval déclare qu'il n'a jamais donné aucun
accord. Erreur fondamentale. » Mis
au courant de cet accord sur lequel il ne revient pas, Laval proposera
aux Allemands que les enfants
des parents qui leur
seront livrés de zone libre soient également déportés
avec eux. Probablement ne veut-il pas qu'en ce pays où la
famille est plus que jamais à l'honneur on l'accuse de
séparer les uns des autres. Pour les enfants des juifs
arrêtés en zone occupée, Laval déclarera à la
Gestapo que c'est aux Allemands de décider de leur sort.
Entre-temps, Bousquet l'a poussé à accepter que
les arrestations de juifs à Paris et en province soient
opérées par la police française, qui arrêtera
le nombre voulu de juifs à condition que ces juifs soient
exclusivement des étrangers. Le nombre voulu n'ayant pas été atteint,
les autorités
françaises insisteront pour le compléter en y joignant
les enfants arrêtés, pourtant français pour
la plupart, et en usant du même prétexte « humanitaire » que
celui invoqué par Laval. Rafle du Vélodrome d'Hiver à Paris,
rafles en province de zone occupée, livraisons de milliers
de juifs jusque-là internés dans les camps de Vichy
en zone libre, la coopération policière est massive
: entre le 17 juillet et le 26 août, jour de la grande
rafle en zone libre ; soit en quarante jours, 19 000 juifs seront
déportés
de France, dont plus de 3 900 enfants. Rendue optimiste par l'importance
de ces livraisons, la Gestapo de Paris obtient de Berlin, le
28 août, la mise à disposition
d'un train quotidien de déportation de 1 000 juifs pour
la période allant du 15 septembre au 15 octobre. La Gestapo
sait, en effet, que Vichy est en mesure d'arrêter
et de livrer des dizaines de milliers de juifs : partout les
juifs sont recensés et sous le contrôle de l'administration
préfectorale et des forces de police, qui feront ce que
leur gouvernement leur ordonnera. Le 26 août 1942, dans
les 40 départements de la
zone libre, s'effectue l'arrestation de milliers de juifs prévue
pour atteindre le contingent promis aux Allemands de 10 000 têtes.
C'est en fonction de ce nombre de 10 000 à ne pas dépasser
que des critères ont été établis
par la police nationale, qui suit attentivement à Vichy
les résultats de la rafle, laquelle se révèle
décevante : de nombreux juifs visés par la rafle
ont été prévenus et ont trouvé refuge
chez des non-juifs compatissants. L'opinion publique en zone
libre admet difficilement que son gouvernement, son administration
préfectorale et sa police
remplissent à la demande des Allemands une mission aussi
discutable, alors que le gouvernement Pétain-Laval dispose
encore de l'Empire, de la flotte et de l'appui économique
que la France apporte au IIIe Reich dans une collaboration où l'ordre
règne sur tout le territoire à la satisfaction
des Allemands, qui n'ont besoin que d'une faible couverture militaire
et policière, concentrant leurs forces à leurs
offensives à l'Est et en Libye. Les Français ne
sont pas seulement critiques du lâche
comportement de leur gouvernement, ils sont sensibles aussi aux
souffrances des victimes et ne se font pas d'illusions sur leur
sort. Les victimes ne sont pas des adultes jeunes ou dans la
force de l'âge, dont on peut croire qu'ils partent pour
le travail forcé ; ce sont des parents, des vieillards,
des enfants, des malades, des impotents transportés dans
des conditions inhumaines, entassés dans des wagons à bestiaux
et dirigés vers Drancy, camp de transit en vue de la déportation.
Les préfets répercutent immédiatement sur
Laval les réactions défavorables de la population
et des Eglises. Certains des prélats les plus influents,
parce que pétainistes, ont pris parti contre ces mesures
et, parmi eux, le plus en vue, le cardinal Gerlier, primat des
Gaules, qui couvre le sauvetage à Lyon d'une centaine
d'enfants juifs par les Amitiés chrétiennes L'effet
sur Vichy de cette oppo- sition soudaine et inattendue est immédiat : le 2 septembre, à Paris, Laval prévient
les chefs SS qu'en raison de « la résistance sans
pareille de la part de l'Eglise » il ne pourra remplir
le programme qui vient de lui être communiqué par
la Gestapo de 50 000 juifs pour 50 trains. Il remplira, déclare-t-il,
le programme initialement demandé. Et, effectivement,
le 11 novembre 1942, l'ultime convoi de l'année sera mis
en route pour Auschwitz ; 41 000 juifs auront été déportés,
dont 33 000 en onze semaines entre le 17 juillet et le 30 septembre.
Conscients des difficultés que rencontre Laval, les chefs
SS (Knochen, Oberg, Herbert Martin Hagen) refuseront au service
des affaires juives de la Gestapo d'exiger de la préfecture
de police de très grandes rafles qui nécessitent
l'accord du gouvernement de Vichy (à l'exception des rafles
visant les juifs roumains et les juifs grecs). Le 25 septembre,
Knochen télexera à Adolf Eichmann
un message extrêmement important où il lui fait
savoir que Heinrich Himmler lui-même a admis qu'en raison
de la situation politique et de la position de Pétain
et de Laval la déportation des juifs français ne
peut être envisagée pour l'instant et qu'en conséquence « il
ne sera pas possible de faire évacuer des contingents élevés
de juifs ». Certains historiens qui ne veulent pas prendre
en considéra-
tion le rôle collectif bienfaisant et efficace exercé par
les Français auprès de leur gouvernement ont prétendu
que les trains nécessaires à ces transports quotidiens
n'étaient pas disponibles à l'automne 1942. Aucun
document ne confirme leur point de vue. Par contre, il suffit
de lire une note du 16 septembre 1942 du diplomate chargé des
questions juives à l'ambassade d'Allemagne à Paris,
Carltheo Zeitschel, pour se rendre compte du désappointement
allemand : « Il aurait été possible qu'un
train par jour soit mis à disposition pour octobre, soit
31 trains ; malheureusement, le SD de Paris n'a pas pu profiter
de cette complaisance, parce que les mesures françaises
en zone non occupée - en particulier depuis les lettres
pastorales bien connues et les sermons dits en différentes
chaires, ainsi que l'ingérence de la représentation
américaine à Paris et de la radio anglaise à Londres
- n'ont plus été exécutées que de
façon lamentable, de sorte que le nombre de juifs sur
lequel on comptait primitivement n'est pas disponible. » Par
ailleurs, il est évident que les trains ne manquent
pas à l'Ouest en octobre 1942, puisque de Belgique furent
déportés 4 365 juifs entre le 10 octobre et le
1er novembre et des Pays-Bas 12 919 juifs entre le 1er octobre
et le 2 novembre. Les réticences de Vichy, sermonné et
surveillé par
les Eglises et par la population, ne vont pas cesser d'agacer
les autorités allemandes pendant le reste de l'Occupation.
Après l'invasion, en novembre 1942, de la zone libre,
devenue zone sud pour les Français et zone nouvellement
occupée pour les Allemands, Vichy n'y a plus donné de
directives à ses forces de police pour arrêter les
juifs en vue de leur déportation, à l'exception
de deux opérations spéciales : la rafle de 800
juifs à Marseille en janvier 1943 et celle de 2 000 hommes
juifs en février 1943 en représailles à un
attentat antiallemand. Désormais, les juifs ont été essentiellement
arrêtés dans cette zone par les Allemands eux-mêmes
et par leurs séides fran-çais dépendant
directement de la Gestapo. Quant aux opérations massives
qui auraient pu être
menées par la police française, telles l'arrestation
des juifs dans la zone d'occupation italienne ou la dénaturalisation
généralisée des juifs naturalisés
après le 10 août 1927, elles ont été empêchées,
l'une en raison de la protection accordée par les militaires
et les diploma-tes italiens à ces juifs placés
sous leur autorité, l'autre en raison de l'opposition
de l'Eglise catholique officiellement communiquée à Pétain.
En outre, Vichy, constatant l'évolution de la situation
militaire en défaveur des Allemands, a poursuivi sa ligne
d'action antisémite xénophobe : les importantes
rafles de février 1943 et de février 1944 à Paris
ont visé, comme en juillet 1942, des cibles juives étrangères
et « apatrides ». Laval n'a lâché les
juifs français qu'en janvier 1944, quand leur arrestation à Bordeaux
fut opérée par la police française.
En conclusion, la tragédie juive en France, avec ses
ombres et sa lumière, repose sur les données suivantes
:
1. - Le gouvernement antisémite et xénophobe de
Vichy ne voulait pas la déportation et la mise à mort
des juifs. Il s'agissait d'un antisémitisme d'exclusion.
2. - Confronté aux demandes allemandes, dont le but final était
clair, Vichy s'est rendu complice du IIIe Reich en arrêtant
pendant l'été 1942 plus de 30 000 juifs étrangers
et leurs enfants français et en les livrant à la
Gestapo pour qu'ils soient déportés.
3. - Vichy aurait poursuivi sa coopération policière
massive si la population française en zone libre et ses élites
spirituelles ne l'avaient puissamment incité à freiner
cette collaboration criminelle.
Par la suite, le sort des armes défavorable au IIIe Reich
et la sympathie agissante de la majorité des Français
en faveur des juifs persécutés ont maintenu Vichy
dans le cadre d'une collaboration policière antijuive
correspondant à la nature de son antisémitisme
et non à celui fanatisé de la Gestapo.
Comptable de toutes les vies des citoyens français et
des étrangers dont il avait la charge, le gouvernement
de l'Etat français, en persécutant et en livrant
aux nazis une partie des juifs vivant dans notre pays, s'est
rendu coupable d'un crime dont il ne se relèvera jamais
et qui à jamais restera gravé dans la mémoire
collective des Français.>>
Serge Klarsfeld, Le Monde du
23 -08-03
Détails
"Tout se joue sur des petits détails. Des choses très
concrètes que je place dans mes livres et dont je pense
que, une fois ces choses écrites, je n'aurais plus à
y retourner. Or j'y retourne toujours. C'est ce qui est horrible
! Je m'aperçois ainsi que je répète parfois
certaines choses de livre en livre, sans m'en rendre compte, mais
ces détails sont des leitmotivs." "Mon
Paris n'est pas un Paris de nostalgie mais un Paris rêvé"
entretien avec François Busnel (Lire), 04/03/2010
Dimanches
d'août
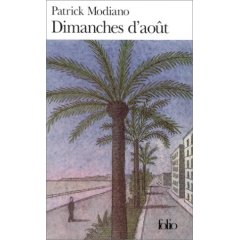 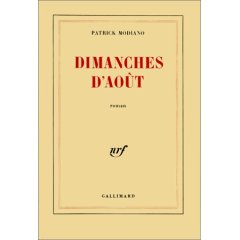
Dimanches
d'août [1986]Collection blanche, Gallimard
et Collection Folio (No 2042) (1989)
Résumé de l'éditeur
Pourquoi le narrateur a-t-il fui les bords de la Marne avec Sylvia
pour se cacher à Nice ? D'où vient le diamant la
Croix du Sud, la seule chose dure et consistante de leur vie et
qui, peut-être, leur porte malheur ? De quoi est mort l'acteur
populaire Aimos ? Qui sont les Neal, et pourquoi, de leur villa
délabrée, s'intéressent-ils de si près
à Sylvia, au narrateur, à la Croix du Sud ? Et Sylvia
? A-t-elle été l'épouse de Villecourt ? Et
Villecourt ? Que vient-il faire à Nice, lui aussi, à
l'heure de sa déchéance ?...
À travers toutes ces énigmes qui s'entrecroisent,
un roman d'amour se dessine, empreint d'un charme qui hante le
lecteur pendant longtemps.
Dimanches
d'août, premières pages
Dimanches
d'août,
une lecture de Leatita JEAN et Barbara Miret dans le cadre
d'un cours sur Patrick Modiano à l'Université
de Provence,
AIX-MARSEILLE I, Centre d'Aix.
19 août 1944
Le 19 août 1944, en se réveillant, les Parisiens
découvrent un spectacle imprévu qui les abasourdit
: le drapeau tricolore flotte sur la préfecture de police
de Paris, près du pont Saint-Michel, dans le 4e arrondissement.
On devine quel symbole vient d'être hissé au-dessus
de la capitale : une police qui s'insurge, c'est le signe que
le pouvoir est vraiment sur le point de changer de camp.
Les
Diplômes*, Paulo Guérin
<< Un autre dimanche, mon père m'emmène, je me demande bien
pourquoi, au Salon nautique, du côté du quai Branly. Nous rencontrons
l'un de ses amis d'avant-guerre, "Paulo" Guérin. Un vieux jeune
homme en blazer. Je ne sais plus s'il visitait lui aussi le Salon ou s'il y tenait
un stand. Mon père m'explique que "Paulo" Guérin n'a
jamais rien fait sinon monter à cheval, piloter de belles voitures, et
séduire des filles. Que cela me serve de leçon : oui, dans la vie,
il faut des diplômes.
Cette fin d'après-midi-là, mon père avait l'air rêveur
comme s'il venait de croiser un fantôme. Chaque fois que je me suis retrouvé sur
le quai Branly, j'ai pensé à la silhouette un peu épaisse,
au visage qui m'avait paru empâté sous les cheveux bruns ramenés
en arrière, de ce "Paulo" Guérin. Et la question demeurera à jamais
en suspens : que pouvait-il bien faire, ce dimanche-là, sans diplômes,
au Salon nautique ?>> Ephéméride, 2002, Mercure
de
France, ed.
Disparaître
définitivement
"Sur ces registres étaient portés l’identité
du «Juif», son numéro de carte d’identité,
son domicile, et une colonne réservée à l’émargement
devait être signée par lui après qu’on
lui eut remis ses étoiles. (page 76.) "Et il n’y
a aucun recours. Ceux-là même qui sont chargés
de vous chercher et de vous retrouver établissent des fiches
pour mieux vous faire disparaître ensuite – définitivement."
Dora Bruder, 1997, p 82.
me
dissoudre dans la pénombre
« Le métro s’est arrêté sur
le pont de Passy. Je souhaitais que personne ne vienne m’arracher à ce
no man’s land d’entre les deux rives. Plus un geste.
Plus un bruit. Le calme enfin. Me dissoudre dans la pénombre.
J’oubliais leurs éclats de voix, les grandes bourrades
qu’ils me donnais, leur acharnement à me tirailler
de tous côtés. Ma peur faisait place à une
sorte d’engourdissement. J’accompagnais du regard
le faisceau lumineux. Il tournait, tournait comme un veilleur
poursuivant sa ronde de nuit. Avec lassitude. Sa clarté s’affaiblissait à mesure.
Bientôt il ne resterait qu’un filet de lumière
presque imperceptible. Et moi aussi, après des rondes
et des rondes, milles et milles allées et venues je
finirais par me perdre dans les ténèbres. » La
Ronde de nuit, 1969.
DORA
BRUDER (1997)
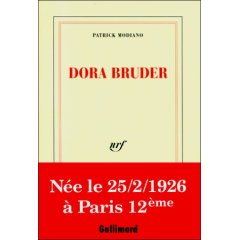 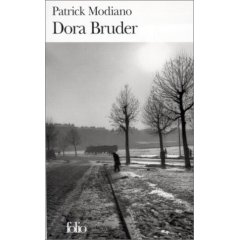
Dora
Bruder [1997] Collection blanche, Gallimard essai et
Collection Folio (No 3181) (1999)
4ème de couverture : «J'ignorerai toujours à
quoi elle passait ses journées, où elle se cachait,
en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver
de sa première fugue et au cours des quelques semaines
de printemps où elle s'est échappée à
nouveau. C'est là son secret. Un pauvre et précieux
secret que les bourreaux, les ordonnances, les autorités
dites d'occupation, le Dépôt, les casernes, les camps,
l'Histoire, le temps - tout ce qui vous souille et vous détruit
- n'auront pas pu lui voler.»
Dora
Bruder, premières pages
Dora
Bruder 1
" Fin 1988, Patrick Modiano lit dans le Paris-Soir du 31
décembre 1941 l'avis de recherche d'une jeune fille, Dora
Bruder, «1,55 m, visage ovale, yeux gris-marron, manteau
sport gris...». Ces lignes hantent l'auteur de La place
de l'Étoile qui engage alors une enquête minutieuse,
obsessionnelle. Il met quatre ans avant de découvrir sa
date de naissance (25 février 1926), puis deux ans pour
retrouver son lieu de naissance. Inlassablement, il arpente le
quartier de Clignancourt, où les parents de Dora, des réfugiés
juifs d'Europe de l'Est, se sont installés. Des heures
durant, il s'interroge sur la fugue de Dora, pensionnaire dans
un établissement religieux de la rue Picpus. Le nez dans
les archives, à l'écoute des témoins éventuels,
il reconstitue au gré des rafles allemandes le parcours
de la jeune juive. Petit à petit, elle entre dans sa famille,
telle une petite sœur, et les époques se chevauchent,
les sentiments se mêlent: Dora n'aurait-elle pas été
dans le même panier à salade que son père,
en février 1942? A-t-elle vécu comme le jeune Modiano
en fugue «un jour de froid et grisaille qui vous rend encore
plus vive la solitude et vous fait sentir encore plus fort qu'un
étau se resserre»? Des zones d'ombre demeurent, Patrick
Modiano, dépositaire de la mémoire de l'Occupation,
«lance des appels, comme des signaux de phare». Une
chose est sûre, Dora Bruder faisait partie du convoi du
18 septembre 1942 pour Auschwitz, comme son père, comme
mille autres."
Dora
Bruder 2
<< - Vous dites dans cet article que vous avez
voulu suivre l'exemple de Klarsfeld. Ce que vous avez fait en
écrivant Dora Bruder.
La motivation, la pulsion à écrire, c'est pour moi
toujours de partir d'une disparition, de construire une quête
à partir de là. Au départ de Dora Bruder,
il y avait cet avis de recherche qui m'avait attiré. Je
l'avais trouvé en feuilletant un vieux journal de l'époque.
Un tel avis de recherche m'avait frappé, dans cette période
où les gens disparaissaient si facilement... Dans la fugue
de cette jeune fille, il y avait aussi quelque chose qui était
proche de moi. J'ai eu une sorte d'intuition, j'ai tout de suite
regardé dans le Mémorial de Klarsfeld et j'ai vu
son nom, simplement son nom, sans aucune autre indication. Il
fallait alors que je retrouve qui était cette fille...
J'ai mené des recherches, mais des années après
avoir découvert l'avis de recherche, que j'avais lu en
1987. Cela me hantait, mais j'ai mis sept ou huit ans avant de
m'y atteler vraiment. Une autre chose m'avait frappé :
quand j'ai regardé dans le Mémorial de Klarsfeld
pour voir si j'y trouvais la trace des parents de Dora Bruder,
je me suis aperçu que sa mère s'était retrouvée
dans le même convoi que la mère de Perec. Elle n'avait
pas été déportée en même temps
que sa fille, car elle était de nationalité hongroise
et, à l'époque, les Hongrois n'ont dans un premier
temps pas été déportés. Ils n'ont
été déportés que plus tard. Cette
coïncidence m'a fait un choc terrible, ça m'a beaucoup
troublé.>> Entretien
avec Maryline Heck, Magazine Littéraire, n° 490, octobre
2009
Dora
Bruber. 3
<<
En écrivant Dora Bruder et en me promenant dans le quartier
de Picpus, je pensais à des destins sacrifiés de
manière absurde au XVIIIe siècle [...] Ainsi le
destin d’une certaine Marie-Anne Leroy dont j’avais
trouvé le nom dans une liste de victimes de la Terreur.
Elle avait dix-neuf ans, elle était vaguement « actrice
au Théâtre Feydeau » et elle avait été
guillotinée sans raison précise. >> Irène
Frain, Patrick Modiano, l’éternel préoccupé
de l’Occupation, Paris-Match, 17 avril 1997.
Dora
Bruder La disparition par Michel Braudeau
<< Contre les gardiens de l'oubli,
Patrick Modiano se veut un gardien de la mémoire.
Il fait exister ce que l'amnésie volontaire voudrait effacer
Hier ist kein Warum » : Ici, il n'y a pas de pourquoi.
Primo Levi raconte qu'un gardien SS, dès son arrivée à Auschwitz,
lui enseigna ainsi la loi du camp. Il n'y a pas davantage de « pourquoi » pensable,
rappelle Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah, à la destruction
de six millions de juifs. Il y a des explications multiples,
sociologiques, économiques, psychanalytiques, religieuses
qui, séparément ou croisées, ne suffisent
jamais à déduire le fait de l'extermination. La
raison bute. Il arrive même qu'elle se fasse une raison
de son incapacité à comprendre : elle affirme alors
que le génocide est aberration pure, anomalie historique,
instant de démence unique dans le déroulement explicable
du temps. Ce qui a entre autres avantages celui de débarrasser
les bourreaux et leurs complices du poids de leur responsabilité.
Entre les deux écueils, la rationalisation et l'irrationalisation,
la voie est étroite.
Les Temps Modernes, la revue fondée par Sartre et que
dirige aujourd'hui Lanzmann, s'efforce de l'emprunter en analysant
le succès remporté partout dans le monde et notamment
en Allemagne par le (mauvais) livre de Daniel Goldhagen, Les
Bourreaux volontaires de Hitler (1). On y rappelle la formule
de Raul Hilberg qui résume de manière terrible
la logique historique de l'antisémitisme occidental : « Les
missionnaires de la Chrétienté avaient dit : vous
n'avez pas le droit de vivre parmi nous en tant que Juifs. Les
chefs séculiers qui suivirent avaient proclamé :
Vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous. Les Nazis allemands à la
fin décrétèrent : Vous n'avez pas le droit
de vivre (2). » Lanzmann y souligne aussi que la compassion
et l'anathème, si largement pratiqués aujourd'hui,
ne sont peut-être encore qu'une ruse de l'histoire pour
brouiller les pistes et les enfouir sous l'émotion.
Mais comment écrire sur l'extermination en faisant l'économie
de la colère et de la pitié, ces mauvaises conseillères
? C'est la question qui hante toute l'oeuvre de Georges Perec,
ce mur fragile de signes édifié autour de l'absence.
Perec, en 1963, écrivait, à propos de Robert Antelme
: « Dans tous les cas, monotone ou spectaculaire, l'horreur
anesthésiait. Les témoignages étaient inefficaces
; l'hébétude, la stupeur ou la colère devenaient
les modes normaux de lecture. Mais ce n'était pas cela
qu'il s'agissait d'atteindre. Nul ne désirait, en écrivant,
susciter la pitié, la tendresse ou la révolte.
Il s'agissait de faire comprendre ce que l'on ne pouvait pas
comprendre ; il s'agissait d'exprimer ce qui était inexprimable. » Ce « programme » d'écriture
est aussi celui de Patrick Modiano.
On a trop écrit sur le charme des livres de Modiano, sur
sa trop fameuse « petite musique », sur son art du
flou et du trompe-l'oeil et sur les fausses perspectives savamment
tracées par ses errances et ses déambulations.
Non que ces qualités ornementales et rêveuses, ces
délicieux et troublants entrelacs de la fiction soient
négligeables, mais parce qu'ils sont l'expression manifeste,
l'effet de surface d'un projet beaucoup plus ambitieux : dire
l'absence, la rendre présente. Il est nécessaire
d'inverser les termes du « cas Modiano ». Il n'a
pas choisi pour époque privilégiée de nombre
de ses livres la période de l'occupation allemande qu'il
n'a pas connue en raison du caractère trouble, ambigu,
romanesque de ces temps mêlés. C'est au contraire à cause
du trou noir creusé par ce morceau d'histoire que tout,
ensuite, devient mystérieux, incomplet, irréel,
inexplicable, absurde, insaisissable, fictif. Comme si une pièce
de la machine avait disparu et que le monde continuait à tourner,
de travers, en s'efforçant de l'oublier.
Dans certains de ses romans, Modiano décrit ce monde d'après.
Ses mensonges qui en sont à peine, faute de vérité ;
sa mémoire toujours trompeuse, son identité trouée,
sa morale à géométrie variable. Il peut
même entrer de l'humour et de l'indulgence dans ce tableau
: un amnésique n'est jamais complètement responsable
de ses actes, et il est permis de sourire de certains de ses
comportements. Plus à plaindre qu'à blâmer.
Dans d'autres, La Place de l'étoile, La Ronde de nuit,
Les Boulevards de ceinture, mais aussi dans Emmanuel Berl, interrogatoire
ou dans le scénario et les dialogues de Lacombe Lucien,
Modiano retourne au centre du mystère, au coeur même
de ce qu'on pourrait appeler, avec beaucoup de légèreté,
son obsession et qui est sa raison d'être écrivain
: à ces années qui précédèrent
immédiatement sa naissance en 1945.
Jamais il ne l'a fait de manière aussi explicite que dans
Dora Bruder ; sans doute parce qu'il ose se défaire des
maquillages de la fiction. Dora Bruder est le récit d'une
enquête ; Modiano s'y revendique pour ce qu'il est : un
gardien de la mémoire . « Si je n'étais pas
là pour l'écrire, il n'y aurait plus aucune trace
de cette inconnue », dit-il d'une jeune femme dont l'identité reste
incertaine mais dont il sait qu'elle fut raflée le 18
février 1942 et internée aux Tourelles. Elle était
une ombre ; elle devient, par lui, une trace, une inscription,
le début d'une présence.
Pour réussir, le gardien de la mémoire se doit
de vaincre un colosse collectif : les gardiens de l'oubli. Dora
Bruder est aussi le récit, parfois hallucinant, d'un combat
inégal : celui d'un homme seul, d'un écrivain,
contre la bureaucratie de l'amnésie. Il y eut, bien sûr,
les policiers des Questions juives qui détruisirent leurs
fichiers et les procès-verbaux de leurs interpellations
au cours des rafles ou lors des arrestations individuelles, dans
la rue. Il y eut ceux qui ne se souvenaient de rien ou qui n'avaient
rien vu, rien su et qui désiraient qu'après la
mort de l'homme la vie continue, comme si de rien n'était.
Mais il y a encore, aujourd'hui, une cohorte de sentinelles chargées
d'interdire l'accès de la mémoire à ceux
qui la cherchent enfouie dans la poussière des documents
et des registres, enfermée dans des caves dont les clefs
semblent inaccessibles ou égarées.
Par bribes, morceau après morceau, Modiano leur a arraché des
fragments d'existence d'une jeune fille. Elle s'appelle Dora
Bruder. Elle est née dans le douzième arrondissement
de Paris le 25 février 1926. Modiano a fait sa connaissance
il y a huit ans par une petite annonce de Paris-Soir datée
du 31 décembre 1941 : « On recherche une jeune fille,
Dora Bruder, 15 ans, 1,55 m, visage ovale, yeux gris-marron,
manteau sport gris, pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu
marine, chaussures sport marron. » Dora avait fait une
fugue ; ses parents s'inquiétaient. Ils étaient
allés signaler la disparition de leur enfant à la
police. Le dernier jour de 1941, des étrangers, des juifs
pouvaient encore demander à la police française
de les aider à retrouver leur fille. Mais Ernest Bruder,
le père, est arrêté, sans motif connu, le
19 mars 1942 ; Dora le sera le 19 juin. Tous deux se retrouveront à Drancy
avant d'être expédiés à Auschwitz
le 18 septembre de la même année. Cécile,
la mère partira pour le camp de la mort cinq mois après
son mari et sa fille. Personne n'en reviendra.
Une histoire simple, comme il en existe des milliers d'autres.
Une histoire française, avec des fonctionnaires français
pleins de zèle qui, au contraire de l'écrivain,
ne recherchent les jeunes filles que pour mieux les faire disparaître.
Modiano leur vole cet effacement : Dora Bruder désormais
existe. la petite fugueuse parisienne du 41, boulevard d'Ornano,
l'interne de l'institution Saint-Coeur-de-Marie du 62, rue Picpus
ont une vie et des secrets que « les bourreaux, les autorités
dites d'occupation, le Dépôt, les casernes, les
camps, l'Histoire, le temps tout ce qui vous souille et vous
détruit n'auront pas pu lui voler ». Mais ce sentiment
d'une dérisoire et essentielle victoire accompagne celui
d'une insurmontable défaite : « Oui, malheureusement,
je venais trop tard. » Même si des lecteurs répondent à l'appel
de Modiano et lui permettent d'ajouter quelques touches au portrait
de Dora Bruder, il ne s'agira encore que de « signaux de
phare dont je doute malheureusement qu'ils puissent éclairer
la nuit. Mais j'espère toujours ». Pour combler
les trous, Modiano offre à Dora Bruder des fragments de
sa propre jeunesse, en mesurant la distance infinie qui les sépare.De
ces disparitions, tout désormais porte la marque, comme
si l'absence, d'être refoulée, oubliée, était
devenue notre mode d'être ; comme si l'on ne pouvait plus
marcher dans les rues sans avoir l'impression de le faire sur
les traces de quelqu'un. L'urbanisation elle-même devient
une opération de nettoyage de la mémoire. Il y
a dans Dora Bruder des pages simples et magnifiques sur le Paris
d'aujourd'hui qui essaie d'effacer jusqu'aux dernières
traces du Paris d'hier pour gommer de son paysage jusqu'à l'écho
des voix de ces enfants aux noms polonais « et qui étaient
si parisiens qu'ils se confondaient avec les façades des
immeubles ». Qu'on n'aille plus après ce beau et
grand livre entonner la rengaine de Modiano le nostalgique, de
Modiano l'illusionniste de l'incertitude. C'est un écrivain
d'aujourd'hui qui tente l'impossible et l'indispensable : tenir
le lien avec l'horreur de notre proche origine. « Beaucoup
d'amis que je n'ai pas connus ont disparu en 1945, l'année
de ma naissance. Ils avaient épuisé toutes les
peines pour nous permettre de n'éprouver que de petits
chagrins. » PIERRE LEPAPE le Monde, 4 avril
1997.
DORA
BRUBER La disparition, par Pierre Lepape
<< Hier ist kein Warum » : Ici, il n'y a pas de pourquoi.
Primo Levi raconte qu'un gardien SS, dès son arrivée à Auschwitz,
lui enseigna ainsi la loi du camp. Il n'y a pas davantage de « pourquoi » pensable,
rappelle Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah, à la destruction de six
millions de juifs. Il y a des explications multiples, sociologiques, économiques,
psychanalytiques, religieuses qui, séparément ou croisées,
ne suffisent jamais à déduire le fait de l'extermination. La
raison bute. Il arrive même qu'elle se fasse une raison de son incapacité à comprendre
: elle affirme alors que le génocide est aberration pure, anomalie historique,
instant de démence unique dans le déroulement explicable du temps.
Ce qui a entre autres avantages celui de débarrasser les bourreaux et
leurs complices du poids de leur responsabilité. Entre les deux écueils,
la rationalisation et l'irrationalisation, la voie est étroite.
Les Temps Modernes, la revue fondée par Sartre et que dirige aujourd'hui
Lanzmann, s'efforce de l'emprunter en analysant le succès remporté partout
dans le monde et notamment en Allemagne par le (mauvais) livre de Daniel Goldhagen,
Les Bourreaux volontaires de Hitler (1). On y rappelle la formule de Raul Hilberg
qui résume de manière terrible la logique historique de l'antisémitisme
occidental : « Les missionnaires de la Chrétienté avaient
dit : vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous en tant que Juifs. Les chefs
séculiers qui suivirent avaient proclamé : Vous n'avez pas le
droit de vivre parmi nous. Les Nazis allemands à la fin décrétèrent
: Vous n'avez pas le droit de vivre (2). » Lanzmann y souligne aussi
que la compassion et l'anathème, si largement pratiqués aujourd'hui,
ne sont peut-être encore qu'une ruse de l'histoire pour brouiller les
pistes et les enfouir sous l'émotion.
Mais comment écrire sur l'extermination en faisant l'économie
de la colère et de la pitié, ces mauvaises conseillères
? C'est la question qui hante toute l'oeuvre de Georges Perec, ce mur fragile
de signes édifié autour de l'absence. Perec, en 1963, écrivait, à propos
de Robert Antelme : « Dans tous les cas, monotone ou spectaculaire, l'horreur
anesthésiait. Les témoignages étaient inefficaces ; l'hébétude,
la stupeur ou la colère devenaient les modes normaux de lecture. Mais
ce n'était pas cela qu'il s'agissait d'atteindre. Nul ne désirait,
en écrivant, susciter la pitié, la tendresse ou la révolte.
Il s'agissait de faire comprendre ce que l'on ne pouvait pas comprendre ; il
s'agissait d'exprimer ce qui était inexprimable. » Ce « programme » d'écriture
est aussi celui de Patrick Modiano.
On a trop écrit sur le charme des livres de Modiano, sur sa trop fameuse « petite
musique », sur son art du flou et du trompe-l'oeil et sur les fausses
perspectives savamment tracées par ses errances et ses déambulations.
Non que ces qualités ornementales et rêveuses, ces délicieux
et troublants entrelacs de la fiction soient négligeables, mais parce
qu'ils sont l'expression manifeste, l'effet de surface d'un projet beaucoup
plus ambitieux : dire l'absence, la rendre présente. Il est nécessaire
d'inverser les termes du « cas Modiano ». Il n'a pas choisi pour époque
privilégiée de nombre de ses livres la période de l'occupation
allemande qu'il n'a pas connue en raison du caractère trouble, ambigu,
romanesque de ces temps mêlés. C'est au contraire à cause
du trou noir creusé par ce morceau d'histoire que tout, ensuite, devient
mystérieux, incomplet, irréel, inexplicable, absurde, insaisissable,
fictif. Comme si une pièce de la machine avait disparu et que le monde
continuait à tourner, de travers, en s'efforçant de l'oublier.
Dans certains de ses romans, Modiano décrit ce monde d'après.
Ses mensonges qui en sont à peine, faute de vérité ; sa
mémoire toujours trompeuse, son identité trouée, sa morale à géométrie
variable. Il peut même entrer de l'humour et de l'indulgence dans ce
tableau : un amnésique n'est jamais complètement responsable
de ses actes, et il est permis de sourire de certains de ses comportements.
Plus à plaindre qu'à blâmer. Dans d'autres, La Place de
l'étoile, La Ronde de nuit, Les Boulevards de ceinture, mais aussi dans
Emmanuel Berl, interrogatoire ou dans le scénario et les dialogues de
Lacombe Lucien, Modiano retourne au centre du mystère, au coeur même
de ce qu'on pourrait appeler, avec beaucoup de légèreté,
son obsession et qui est sa raison d'être écrivain : à ces
années qui précédèrent immédiatement sa
naissance en 1945.
Jamais il ne l'a fait de manière aussi explicite que dans Dora Bruder
; sans doute parce qu'il ose se défaire des maquillages de la fiction.
Dora Bruder est le récit d'une enquête ; Modiano s'y revendique
pour ce qu'il est : un gardien de la mémoire . « Si je n'étais
pas là pour l'écrire, il n'y aurait plus aucune trace de cette
inconnue », dit-il d'une jeune femme dont l'identité reste incertaine
mais dont il sait qu'elle fut raflée le 18 février 1942 et internée
aux Tourelles. Elle était une ombre ; elle devient, par lui, une trace,
une inscription, le début d'une présence.
Pour réussir, le gardien de la mémoire se doit de vaincre un
colosse collectif : les gardiens de l'oubli. Dora Bruder est aussi le récit,
parfois hallucinant, d'un combat inégal : celui d'un homme seul, d'un écrivain,
contre la bureaucratie de l'amnésie. Il y eut, bien sûr, les policiers
des Questions juives qui détruisirent leurs fichiers et les procès-verbaux
de leurs interpellations au cours des rafles ou lors des arrestations individuelles,
dans la rue. Il y eut ceux qui ne se souvenaient de rien ou qui n'avaient rien
vu, rien su et qui désiraient qu'après la mort de l'homme la
vie continue, comme si de rien n'était. Mais il y a encore, aujourd'hui,
une cohorte de sentinelles chargées d'interdire l'accès de la
mémoire à ceux qui la cherchent enfouie dans la poussière
des documents et des registres, enfermée dans des caves dont les clefs
semblent inaccessibles ou égarées.
Par bribes, morceau après morceau, Modiano leur a arraché des
fragments d'existence d'une jeune fille. Elle s'appelle Dora Bruder. Elle est
née dans le douzième arrondissement de Paris le 25 février
1926. Modiano a fait sa connaissance il y a huit ans par une petite annonce
de Paris-Soir datée du 31 décembre 1941 : « On recherche
une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1,55 m, visage ovale, yeux gris-marron,
manteau sport gris, pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures
sport marron. » Dora avait fait une fugue ; ses parents s'inquiétaient.
Ils étaient allés signaler la disparition de leur enfant à la
police. Le dernier jour de 1941, des étrangers, des juifs pouvaient
encore demander à la police française de les aider à retrouver
leur fille. Mais Ernest Bruder, le père, est arrêté, sans
motif connu, le 19 mars 1942 ; Dora le sera le 19 juin. Tous deux se retrouveront à Drancy
avant d'être expédiés à Auschwitz le 18 septembre
de la même année. Cécile, la mère partira pour le
camp de la mort cinq mois après son mari et sa fille. Personne n'en
reviendra.
Une histoire simple, comme il en existe des milliers d'autres. Une histoire
française, avec des fonctionnaires français pleins de zèle
qui, au contraire de l'écrivain, ne recherchent les jeunes filles que
pour mieux les faire disparaître. Modiano leur vole cet effacement :
Dora Bruder désormais existe. la petite fugueuse parisienne du 41, boulevard
d'Ornano, l'interne de l'institution Saint-Coeur-de-Marie du 62, rue Picpus
ont une vie et des secrets que « les bourreaux, les autorités
dites d'occupation, le Dépôt, les casernes, les camps, l'Histoire,
le temps tout ce qui vous souille et vous détruit n'auront pas pu lui
voler ». Mais ce sentiment d'une dérisoire et essentielle victoire
accompagne celui d'une insurmontable défaite : « Oui, malheureusement,
je venais trop tard. » Même si des lecteurs répondent à l'appel
de Modiano et lui permettent d'ajouter quelques touches au portrait de Dora
Bruder, il ne s'agira encore que de « signaux de phare dont je doute
malheureusement qu'ils puissent éclairer la nuit. Mais j'espère
toujours ». Pour combler les trous, Modiano offre à Dora Bruder
des fragments de sa propre jeunesse, en mesurant la distance infinie qui les
sépare.De ces disparitions, tout désormais porte la marque, comme
si l'absence, d'être refoulée, oubliée, était devenue
notre mode d'être ; comme si l'on ne pouvait plus marcher dans les rues
sans avoir l'impression de le faire sur les traces de quelqu'un. L'urbanisation
elle-même devient une opération de nettoyage de la mémoire.
Il y a dans Dora Bruder des pages simples et magnifiques sur le Paris d'aujourd'hui
qui essaie d'effacer jusqu'aux dernières traces du Paris d'hier pour
gommer de son paysage jusqu'à l'écho des voix de ces enfants
aux noms polonais « et qui étaient si parisiens qu'ils se confondaient
avec les façades des immeubles ». Qu'on n'aille plus après
ce beau et grand livre entonner la rengaine de Modiano le nostalgique, de Modiano
l'illusionniste de l'incertitude. C'est un écrivain d'aujourd'hui qui
tente l'impossible et l'indispensable : tenir le lien avec l'horreur de notre
proche origine. « Beaucoup d'amis que je n'ai pas connus ont disparu
en 1945, l'année de ma naissance. Ils avaient épuisé toutes
les peines pour nous permettre de n'éprouver que de petits chagrins.» PIERRE
LEPAPE Le Monde du 4 avril 1997
Modiano
recherche dora désespérément par
Jérôme Garcin
<<
De toutes les rondes de nuit que ce grand garçon affolé
et balbutiant accomplit dans un Paris dont il connaît chaque
ruelle, chaque faubourg, longeant les murs à grandes enjambées
comme s'il bravait toujours le couvre-feu, celle-ci est la plus
pathétique et la plus bouleversante. Pour la première
fois, d'ailleurs, une de ses rituelles escapades a résisté
au roman, une obsession oppressante à la fiction, et Patrick
Modiano a cédé à la confession. Elle est
exemplaire de ce que l'on appelle dorénavant le devoir
de mémoire. Elle illustre, en sépia, la haine de
l'oubli. L'enquête commence en 1988. Consultant de vieux
journaux, l'écrivain tombe, dans le « Paris-Soir
» du 31 décembre 1941, sur l'avis suivant : «
PARIS. On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1,55
m, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pull-over
bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron.
Adresser toutes indications à M. et Mme Bruder, 41, boulevard
Ornano, Paris. » Sans raisons objectives (il n'a aucun lien,
familial ou amical, avec les Bruder), ces quelques lignes perdues
dans une grande page, entre le tableau des cours de la Bourse
et le compte-rendu d'une visite d'écoliers au maréchal
Pétain, troublent Modiano. Bientôt, elles vont le
hanter. Il imagine la détresse des parents qui ont perdu
leur fille le dernier jour de l'année. Et puis il connaît
bien le quartier où elle a disparu. Comme s'il y avait
encore un espoir, comme si plus d'un demi-siècle n'avait
pas passé, comme si cette petite annonce lui était
personnellement destinée, Patrick Modiano est parti, pendant
près de dix ans, à la poursuite de Dora Bruder.
Il a erré boulevard Ornano et dans les alentours, compulsé
les archives des écoles communales et des pensions religieuses,
il est allé frapper à la mairie du 12e arrondissement,
à la Préfecture de Police, au parquet de grande
instance, il s'est promené autour de Drancy, il a consulté
le « Mémorial de la déportation des juifs
de France », il a retrouvé une nièce des parents
Bruder, mis la main sur quelques photos de famille, et parce que
les informations récoltées ici et là ne lui
suffisaient pas il s'adresse encore, page 43, à ses lecteurs
: « En écrivant ce livre, je lance des appels, comme
des signaux de phare dont je doute malheureusement qu'ils puissent
éclairer la nuit. Mais j'espère toujours. »
Même s'il reste des zones d'ombre dans sa courte et douloureuse
biographie, Dora Bruder n'est pourtant plus la jeune fille inconnue
de l'avis de recherche. Pas après pas, page après
page, Modiano ne lui a pas redonné la vie, mais il l'a
sauvée de la mort en lui restituant son identité
perdue. Dora Bruder est née à Paris le 25 février
1926. Son père, Ernest Bruder, autrichien, s'était
engagé dans la Légion étrangère et
avait été blessé au Maroc, en 1923. Un an
plus tard, il avait épousé une Hongroise, Cécile
Burdej. Lui était manoeuvre, elle, ouvrière fourreuse.
Avec leur fille, ils habitaient un hôtel du boulevard Ornano.
Le 9 mai 1940, Dora fut placée dans un internat religieux,
chez les Soeurs des Ecoles chrétiennes de la Miséricorde,
rue de Picpus. Sans doute ses parents, qui portaient le numéro
de dossier juif 49091 et avaient pris soin de ne pas déclarer
leur fille au commissariat du quartier Clignancourt, jugeaient-ils
qu'elle était, dans ce pensionnat catholique, à
l'abri des menaces. Mais en plein hiver de 1941, au plus fort
des représailles allemandes contre la population parisienne
et alors que le thermomètre affichait moins quinze, Dora
soudain a fugué. Disparue. Envolée. Tout à
son enquête, Patrick Modiano n'a pas supporté de
perdre soudain sa trace, d'ignorer où elle avait vécu
pendant plusieurs mois, jusqu'à ce fatidique 18 septembre
1942, date à laquelle, avec son père, elle est partie
de Drancy pour Auschwitz, dans le convoi numéro 34. Pour
combler ce manque, ce vide, ce silence, et qui sait offrir à
la petite condamnée un sursis, un détour amoureux,
un peu de soleil dans l'eau glacée, l'écrivain a
rédigé en 1990 un roman, « Voyage de noces
». L'adolescente, prénommée Ingrid, rencontrait
alors un jeune homme au Châtelet et, en sa compagnie, fuyait
la capitale pour la Côte d'Azur. Elle portait sur elle l'avis
de recherche que son père avait fait passer dans «
Paris-Soir ». « Je me rends compte aujourd'hui, avoue
Modiano, qu'il m'a fallu écrire deux cents pages pour capter,
inconsciemment, un vague reflet de la réalité. »
Persévérant, l'écrivain a aussitôt
repris le fil ténu de son investigation. Il a découvert
que Dora Bruder avait rejoint, en avril 1942, le domicile maternel
puis qu'elle avait été internée au camp des
Tourelles sous le matricule 439 avant d'être transférée,
le 13 août de la même année, à Drancy,
où elle retrouva son père avant de disparaître,
pour toujours, dans l'enfer concentrationnaire. L'enquête
s'arrête là. Modiano n'en saura pas plus sur celle
dont, cinquante-cinq ans plus tard, il sent toujours la présence
fantomatique et désormais familière au coin des
rues, comme s'il voulait fixer sa courte fugue dans l'éternité,
comme s'il était finalement heureux de n'avoir pas réussi
à percer, de cette liberté provisoire, le secret,
« un pauvre et précieux secret que les bourreaux,
les ordonnances, les autorités dites d'occupation, le Dépôt,
les casernes, les camps, l'Histoire, le temps ¬ tout ce qui
vous souille et vous détruit ¬ n'auront pas pu lui
voler ». Cela fait trente ans que, depuis « la Place
de l'Etoile » ¬ à gauche, sur la poitrine ¬,
Patrick Modiano traverse en somnambule le Paris de l'Occupation,
rôde au crépuscule de boulevards de ceinture en quartiers
perdus, interroge du regard la moindre pierre, une enseigne, une
affiche délavée, l'ombre d'un passant sous un lampadaire,
file des personnages équivoques aux noms d'emprunt, aux
biographies brouillées et aux commerces interlopes, glisse
toujours avec une inquiétude de proscrit sous les Guichets
du Louvre, écrit au passé antérieur des romans
fluides mais lacunaires dont il prolonge, de volume en volume,
les énigmes insolubles. Avec « Dora Bruder »,
ce récit d'une prospection à la fois vaine et nécessaire,
dérisoire et magnifique, Patrick Modiano pousse son obsession
jusqu'à l'identification. A travers la jeune fille, c'est
lui-même qu'il poursuit, comme il traque le sentiment inexpugnable
d'être né en 1945. Grâce à Dora, son
double imaginaire, il traverse l'époque qu'il n'a pas vécue,
qu'il ne supporte pas de n'avoir point vécue et qui fait
de lui un procureur sans emploi comme il y a des combattants sans
armes. « Moi, je voulais dans mon premier livre répondre
à tous ces gens (NDLR : les auteurs antisémites
des années 40) dont les insultes m'avaient blessé
à cause de mon père. Et, sur le terrain de la prose
française, leur river une bonne fois pour toutes leur clou.
Je sens bien aujourd'hui la naïveté enfantine de mon
projet : la plupart de ces auteurs avaient disparu, fusillés,
exilés, gâteux ou morts de vieillesse. Oui, malheureusement,
je venais trop tard. » A bien y réfléchir,
cette dernière phrase, qui résonne comme une épitaphe,
pourrait être l'épigraphe de toute l'oeuvre de Patrick
Modiano. Jamais il n'a autant qu'ici, mieux qu'ici, parlé
de sa jeunesse, de ses propres fugues, de ses révoltes,
de ses lectures, de sa mère et surtout de ce père,
mort en 1978, dont la figure tutélaire et ambiguë
pèse sur la plupart de ses livres. Dans « Remise
de peine », il avait raconté l'arrestation, en 1943,
d'Albert Modiano. Conduit dans une annexe du camp de Drancy, les
Magasins généraux de Paris, il avait été
libéré par Louis Pagnon, un membre de la tristement
célèbre bande de la rue Lauriston, qui devait être
fusillé à la Libération. Quelle était
la vraie nature des liens tissés entre son père
et ces collabos auxquels il avait dû d'avoir la vie sauve
? La vérité est simple : Albert Modiano faisait
du marché noir. Il n'avait pas le choix, estime aujourd'hui
son fils. Lui et ses complices étant des pestiférés,
« il était légitime qu'ils se conduisent comme
des hors-la-loi afin de survivre. C'est leur honneur. Et je les
aime pour ça ». Et il aime assez son père
pour lui pardonner ses silences, son absence, ses colères,
son ingratitude. Un jour où Patrick, alors âgé
de 18 ans, sonna à sa porte pour réclamer l'argent
de la pension qu'il devait à sa mère dont il était
séparé, Albert Modiano le traita de « voyou
», appela la police et, dans le panier à salade,
l'observa avec un dégoût pesant. Après quoi
il tenta de faire incorporer de force son fils à la caserne
de Reuilly. Ils ne se revirent plus. Ainsi donc, il aura fallu
que Patrick Modiano recherche désespérément
Dora Bruder dans Paris pour qu'il retrouve son père et,
malgré le silence de l'une et le mutisme de l'autre, fasse
entendre, à la première personne du très
singulier, sa voix littéraire, aussi claire, belle et juste
que sa parole et sa mémoire sont à jamais bégayantes.>>
Le
Nouvel Observateur du 27/03/1997
Dora
Bruder
DIEU
PREND-IL SOIN DES BOEUFS ?
2003
aux éditions de l'Acacia (Paris),
Livre
de Patrick Modiano (texte) et Gérard Garouste (lithographies)
(d'après
la note du Réseau Modiano)
L'ouvrage
est présenté dans un coffret blanc contenant deux
cahiers séparés. Le premier comporte le texte de
la nouvelle de Modiano, imprimé et illustré de 41
lettrines de Garouste. Le second est composé de 32 lithographies
en couleurs, où le texte se trouve calligraphié,
mêlé aux images. Il s’agit d’un ouvrage
de bibliophilie, tiré à seulement 160 exemplaires.Les
exemplaires de tête numérotés de I à
XX, enrichis à la gouache par Gérard Garouste, sont
vendus au prix de 7.500 euros. Les exemplaires numérotés
de 1 à 125 sont vendus 2.700 euros. Le produit de la vente
est destiné à La Source, une association d’
« insertion artistique » créée par Gérard
Garouste. Voir la présentation du livre sur le site de
La Source
Encore
une histoire de chien… «
Le chien noir du chagrin leva lentement la tête »,
lit-on sur l’une des premières pages. Un chien apparaît
d’ailleurs dès le dessin de couverture.
L’ouvrage a reçu en octobre 2005 le premier Prix
Jean Lurçat, qui récompense un ouvrage de bibliophilie.
Créé en 2005 et doté de 7.500 euros, le prix
est dû à l'initiative de Simone Lurçat et
destiné à encourager l'art de la bibliophilie. Il
a pour objet de perpétuer le souvenir de Jean Lurçat
(1892-1966), membre de l'Académie des Beaux-Arts, peintre,
rénovateur de l'art tapisserie qui s'est aussi illustré
dans l'art de la bibliophilie. Les
textes de l'ouvrage couronné sont composés à
la main par les typographes de l'Atelier du Livre à l'aide
du caractère dit «Romain du Roi» et imprimés
sur les presses typographiques de l'Imprimerie Nationale. Les
lithographies originales de Gérard Garouste ont fait l'objet
d'un tirage spécial sur les presses de Franck Bordas.
Le titre du livre renvoie à un passage de la Bible. Saint
Paul s’y interroge sur la parole de Dieu, le sens à
donner aux métaphores divines, et la charité. «
C’est bien dans la Loi de Moïse qu’il est écrit
: Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, dit Saint
Paul dans sa Première épître aux Corinthiens.
Dieu prend-il soin des bœufs ? N’est-ce pas pour nous
qu’il parle, évidemment ? Oui, c’est pour nous
que cela a été écrit : celui qui laboure
doit labourer dans l’espérance, et celui qui foule
le grain, dans l’espérance d’en avoir sa part.
»
DU
PLUS LOIN DE L'OUBLI
 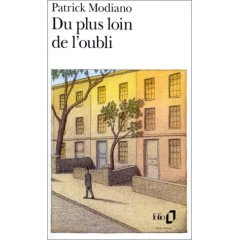
Du
plus loin de l'oubli [1996] Collection blanche (1995)
et Collection Folio (No 3005) (1997)
4ème de couverture : «J'aurais brassé les
papiers, comme un jeu de cartes, et je les aurais étalés
sur la table. C'était donc ça, ma vie présente
? Tout se limitait donc pour moi, en ce moment, à une vingtaine
de noms et d'adresses disparates dont je n'étais que le
seul lien ? Et pourquoi ceux-là plutôt que d'autres
? Qu'est-ce que j'avais de commun, moi, avec ces noms et ces lieux
? J'étais dans un rêve où l'on sait que l'on
peut d'un moment à l'autre se réveiller, quand des
dangers vous menacent. Si je le décidais, je quittais cette
table et tout se déliait, tout disparaissait dans le néant.
Il ne resterait plus qu'une valise de fer-blanc et quelques bouts
de papier où étaient griffonnés des noms
et des lieux qui n'auraient plus aucun sens pour personne.»
Du
plus loin de l'oubli, premières pages
Du
plus loin de l'oubli, Modiano, celui qu'on n'oublie pas , par
Josyane Savigneau
<< Paris, le passé, l'absence, la mémoire...
Un petit air connu, un refrain maîtrisé pour une
partition toujours aussi magique
On a beau se dire qu'on aime les romans plus denses, plus intellectuels,
plus violents, plus dénonciateurs ; on a beau se répéter
que « c'est toujours la même chose », Paris,
le passé, l'absence, la mémoire... Rien n'y fait.
Quand on ouvre un livre de Patrick Modiano, on va jusqu'au bout.
Quand on le referme on sait que pendant des années tel
coin de Paris rappellera une de ses pages, tel hôtel un
de ses livres, telle gare un autre, telle rue un autre encore.
On peut habiter Paris à travers Modiano.
Avec Du plus loin de l'oubli le Modiano 1996 la magie est intacte.
C'est même celle du meilleur Modiano. Bien sûr, si
l'on raisonne en termes d'intrigue, celle-ci est ténue,
comme toujours. Un narrateur se souvient de ses vingt ans, au
milieu des années 60. Il faisait semblant d'être étudiant
et habitait un hôtel du Quartier latin. L'héroïne
s'appelle Jacqueline. Le jeune homme l'a rencontrée un
soir d'hiver. Il se rappelle tous les détails : la lumière,
le « manteau en tissu à chevrons, trop grand pour
lui », que portait le compagnon de Jacqueline, Gérard
Van Bever. Jacqueline et Gérard rêvaient de s'installer à Majorque.
Gérard jouait au casino une « martingale » qui
ne rapportait guère.
Jacqueline toussait beaucoup et aimait un peu trop l'éther.
Mais, à vingt ans, on a envie de tout essayer : « Nous étions
serrés l'un contre l'autre et nous tombions dans le vide.
La sensation de fraîcheur était de plus en plus
forte et le tic-tac du réveil se détachait, de
plus en plus net, dans le silence, au point que je pouvais entendre
son écho. » Est-ce le début d'une passion
? Au printemps, le jeune homme et Jacqueline s'installent à Londres.
Sans Gérard, dont on n'entendra plus parler. Une nuit,
Jacqueline oubliera de rentrer.
Quinze ans plus tard, un après-midi d'été,
du côté de La Muette, le narrateur l'aperçoit
et la suit. Avec le naturel et la nonchalance qu'il a gardés
de ses vingt ans, il pénètre un soir dans son immeuble
et se fait l'invité clandestin d'une réception à laquelle
il la retrouve. On la lui présente sous le nom de Thérèse
Caisley. Elle semble ne pas le reconnaître mais évoque
sa maison à Majorque. Finalement, seule avec lui, elle
lui parle, le reconduit même à son hôtel et
lui laisse un numéro de téléphone. Faux. « Quinze
années ont encore passé dans un tel brouillard
qu'elles se confondent avec les autres », et le narrateur
a cru de nouveau apercevoir Jacqueline, dans une rame de métro.
Elle est descendue à Corvisart et a de nouveau disparu.
Reviendra-t-elle un jour, « du plus loin de l'oubli »,
dans un autre roman, dans une autre vie ? Peut-être.
Certes, on peut se dire que tout cela est trop simple, voire
simpliste : le souvenir, la petite musique du hasard et de l'oubli,
les phrases pas très longues, bien balancées. Partout
l'équilibre. Jamais un débordement, une faute de
goût. En réalité, cette simplicité est
la chose la plus difficile à atteindre. Il y faut infiniment
d'attention, de délicatesse et de patience. On le comprend
seulement quand on a lu trop de textes qui se prennent pour des
livres et ne sont pas « écrits », trop de
faux romans que des éditeurs publient « parce que
ce n'est pas si mal », « parce que ça va se
vendre » (pendant trois mois) et qu'il faut continuer à exister
commercialement.
Alors on sait de quelle entreprise de destruction des écrivains
relève cette volonté d'éditer n'importe
quoi, ce besoin d'affirmer que « tout le monde peut écrire »,
que « la France a cinq cents "bons écrivains",
donc aucun "grand" ». Et on voudrait pouvoir
expliquer, rationnellement, que Modiano, lui, est vraiment écrivain.
Mais comment convaincre ceux qui ont désappris à lire
en parcourant des histoires bien (ou mal) ficelées et
(toujours) mal écrites ? La démonstration ne saurait être
mathématique. Chacun, donc, a le loisir de la refuser
et, au fond, c'est heureux. Cela donne la liberté d'affirmer,
tranquillement, qu'en lisant Modiano on retrouve le territoire
de la littérature. Avec sa « petite musique »,
Patrick Modiano n'est sans doute pas un immense compositeur,
un de ces visionnaires qui peuvent difficilement être reconnus
par leurs contemporains, tant ils sont loin « en avant ».
C'est toutefois un merveilleux musicien. Jamais une erreur d'harmonie.
La joie de le lire demeurera. Sa simplicité même
le rendra inoubliable. >>
JOSYANE SAVIGNEAU Le Monde du 5 janvier 1996
Du
plus loin de l'oubli "Modiano cantabile" par Jean-François
Josselin
<< Ce
qu'il y a de plaisant avec Patrick Modiano, c'est qu'on est en
pays connu. Voici un quart de siècle et une vingtaine
de romans qu'on sillonne son monde, que l'on fréquente
ses personnages. Sans trop les connaître d'ailleurs puisque
aussi bien l'art et la règle de Patrick Modiano sont de
laisser ceux-ci dans l'ombre. Mais on prend toujours le même
plaisir à rencontrer ces fantômes éphémères
qui nous entraînent vers des histoires dont nous ne saurons
rien.
Les théoriciens (pas les auteurs, eux, ils sont rigolos)
du nouveau roman sont des pommes. Tout à leur dénonciation
enthousiaste et surannée (on pense à l'ardeur des élites
progressistes défendant les mérites du plan Juppé,
l'adversaire-qui-parlait-enfin-vrai et l'attitude «courageuse» de
Mme Notat (c'est drôle, au fait, comme en France on aime
les politiciens de gauche qui tiennent un discours de droite
et les politiciens de droite qui tiennent un discours de gauche),
enfin bref tout à leur dénonciation de l'héritage
romanesque balzaco-zolaco-flaubertiste, les théoriciens
en question ont négligé, sinon condamné,
l'oeuvre de Patrick Modiano qui correspond pourtant, et avec
quelle élégance, à ce que la Sarraute, Nathalie
bien sûr, appelait l'ère du soupçon. Car
la manière de Modiano, qui donne certainement des vapeurs
aux producteurs du cinoche français et aux actrices mégalos
souhaitant avant tout «approfondir» les caractères,
est celle de l'esquisse et de l'esquive. On n'est jamais familier,
chez Patrick Modiano. On ne sait pas trop d'où on vient
et encore moins où on va. On passe, comme un cirque (c'est
d'ailleurs le titre d'un de ses derniers romans), on est du voyage,
c'est dire qu'on est d'autre part. Alors les racines, l'hérédité,
les causes et les raisons, c'est à la carte. Au lecteur
de jouer.
«
Du plus loin de l'oubli» est de la même eau que les
précédents textes de Patrick Modiano, même
si on fait un détour par Londres (ville aussi sinistre,
semble-t-il, que le Paris de «Quartier perdu»), bien
que son titre évoque plutôt un livre d'Angelo Rinaldi,
son contemporain, collègue, critique et néanmoins
ami. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais rien ou presque. Le narrateur,
qui n'a pas 20 ans, vend des livres d'art à des libraires
soldeurs sur les quais de la Seine. Dans un café un peu
glauque (évidemment) du Quartier latin, il rencontre un
couple énigmatique - lui s'appelle Gérard Van Bever,
il doit donc être belge, et il gagne sa vie en jouant les
fins de semaine à la boule dans les casinos de Dieppe,
Bagnoles-de-l'Orne et Forges-les-Eaux. Sa martingale: «autour
du cinq neutre» (on ne saura pas ce que ça signifie
mais les joueurs auront compris). Sa compagne se prénomme
Jacqueline. Elle doit être jolie, porte une veste de cuir
noire et le narrateur (Patrick?) tombe amoureux d'elle, sans
doute parce qu'elle est placide, lente, mystérieuse, qu'elle
tousse, qu'elle fume, se drogue à l'éther et que
ni les émotions ni les sentiments ne semblent avoir prise
sur elle.
On s'est permis un «?». Parce que le héros
du livre a les manies de Modiano, celle entre autres de feuilleter
des Bottin et des annuaires à la recherche de noms d'inconnus
qui ne lui diront jamais rien et que, d'ailleurs, il ne connaîtra
jamais. Le narrateur, enfin le double de Patrick, accompagnera
Jacqueline en Angleterre où elle le sèmera avec
la même simplicité qu'elle a largué le Van
Bever cité plus haut. Le narrateur-Patrick en souffrira
beaucoup mais n'en mourra pas - au reste on ne meurt pas d'amour
chez Modiano, ça ne convient pas à son rythme poli
d'écriture, cette beauté lisse.
Précisons encore que cette aventure sans histoires se
déroule sur trente ans et que, par une coquetterie de
l'auteur, on jongle volontiers avec les concordances de temps.
On aimerait faire la fine bouche devant ce roman sans surprise.
Mais on ne peut pas. Le charme Modiano, insidieusement, nous
capte. On n'échappe pas à ses pas et ses démarches.
On est bien, un peu angoissé, mais aux anges. Ce n'est
rien? Comme dirait la reine Margot, c'est tout. >>
Jean-François
Josselin, le
Nouvel
Observateur : 04/01/1996
|