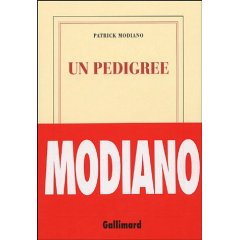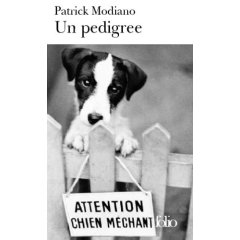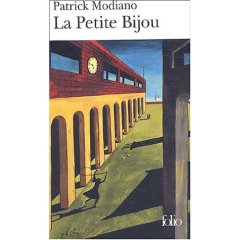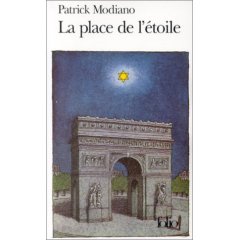Eddy
Pagnon (Fleurs de ruine*, Personnage)
Sylvianne,
celle qui a peut-être croisé le couple T. rencontre
Eddy Pagnon. Il
transporte des vins en fraude, de Bordeaux à Paris pour
le compte d'un hôtelier qui possède un entrepôt,
au quai Saint-Bernard, à la Halle aux vins. Faisait-il
partie de la bande de la rue Lauriston ( le siège de la
Gestapo française) ? Ce personnage est-il intervenu pour
faire sortir le père du narrateur du camp d'internement
de Drancy ? << J'ai tenté de découvrir le
garage où Pagnon travaillait avant-guerre et, parmi les
nouvelles bribes de renseignements que je viens de rassembler
sur lui, il y a ceci : arrêté en novembre 1941 par
les Allemands pour les avoir doublés dans une affaire de
marché noir d'imperméables. Détenu à
la Santé. Libéré par Chamberlin alias
"Henri". Entre à son service, rue Lauriston.
Quitte la bande de la rue Lauriston trois mois avant la libération.
Se retire à Barbizon avec sa maîtresse, la marquise
d'A. Il était possesseur d'un cheval de course et d'une
auto. SE TROUVE UNE PLACE DE CHAUFFEUR SUR UN CAMION POUR LE TRANSPORT
DE VINS DE BORDEAUX A PARIS.>>
Papillons
<<Je ne suis moi-même qu’un papillon affolé
allant d’une lampe à l’autre et se brûlant
chaque fois un plus les ailes. >> La Ronde
de nuit, p.72
<< Drôles de gens. Drôle d'époque entre
chien et loup. Et mes parents se rencontrent à cette époque-là,
parmi ces gens qui leur ressemblent. Deux papillons égarés
et inconscients au milieu d’une ville sans regard. Die Stadt
ohne Blick.Mais. Mais je n'y peux rien, c'est le terreau - ou
le fumier - d'où je suis issu .>> Un
pedigree, p.20.
<< Au fond, Bowing cherchait à sauver
de l’oubli les papillons qui tournent quelques instants
autour d’une lampe.>> Dans le café
de la jeunesse perdue, p. 19
<< Comme si l’on pouvait fixer par
une définition bien précise un André Poutrel,
de la même manière qu’un collectionneur épingle
un papillon dans une boite... >> L’Horizon,
p.154
Parents
Parents
absents
Une mère comédienne, prise entre les répétitions, les représentations
théâtrales et les tournages, un père aux activités louches qui
doit effectuer de fréquents et mystérieux voyages à l'étranger.
Il n'en faut pas plus pour que PM vive son enfance et son
adolescence dans un profond désarroi évoqué dans Remise de
Peine [1987] et
Vestiaire de l'enfance
[1989].
Des
parents très occupés par Michel Grisolia
"Le couple qui a donné naissance à Patrick
M., le 30 juillet 1945, ignore l'austérité puritaine
de la famille Simenon; il évolue, lui, entre demi-monde
et haute pègre. Dans Un pedigree, l'écrivain considère
ses géniteurs «comme deux papillons égarés
et inconscients au milieu d'une ville sans regard». Les
parents Modiano, pour l'état civil: la mère, Louisa
Colpeyn, comédienne sans avenir, née à Anvers
en 1918. On l'a vue dans des tournées de seconde zone,
un lever de rideau de Sagan, Bande à part de Godard, dans
La mort de Belle, qu'Edouard Molinaro et Jean Anouilh adaptèrent
de Simenon. Le père, né en 1912 à Paris,
entre IXe et Xe arrondissement; capital, cet entre-deux, chez
le futur auteur de Quartier perdu. Il se prénomme Aldo
ou Alberto, selon ses adresses et ses fidélités
successives, boulevard Malesherbes, rue Frédéric
Bastiat, rue des Saussaies; un père qui, parmi ses fréquentations
féminines, comptait une Mauricienne, une danseuse finlandaise,
habituée de la rue Lauriston, mais aussi une jeune juive
allemande autrefois fiancée à Billy Wilder; et qui,
on l'avait subodoré dès La ronde de nuit, oubliait
sa judéité à la faveur de trafics louches,
de minables affaires d'espionnage; c'est dans sa propre Ford,
réquisitionnée par la Milice, que Georges Mandel
sera conduit au supplice, lit-on dans Un pedigree... (Lire,
février 2005)
Pardessus
(le)
"Dans « Accident nocturne », (...) il y a donc, et encore,
la trace d'un père pressé et évanescent. Le narrateur le rencontrait,
autrefois, dans des cafés du Trocadéro ou de la rue de Rivoli.
Puis les rendez-vous se sont déplacés vers la porte d'Orléans,
vers Montrouge, à mesure que le père en question semblait plus
furtif et à mesure que ses mystérieuses affaires, sans doute,
l'obligeaient à fuir quelque chose. Bientôt, il n'y eut plus de
rendez-vous, et le narrateur se mit à errer, sans but précis,
dans les quartiers où, peut-être, il apercevrait le « pardessus
» ou le chapeau de cet homme qui aurait pu le renseigner sur
son propre destin. C'est au cours de ces errances qu'il sera,
une nuit, renversé par une « Fiat vert d'eau », place des
Pyramides. Il est blessé à la jambe, la conductrice et son compagnon
- un homme vêtu, lui aussi, d'un « pardessus », ce masque
d'adulte - le déposent dans une clinique avant de s'évaporer comme
toutes les réalités qui entrent en contact avec les héros de ce
romancier de la disparition. Pendant cent cinquante pages, le
narrateur va tenter de retrouver la conductrice. Mais ce qu'il
cherche, on le devine, scrute l'en deçà de cet « Accident nocturne
». Il guette la trace d'un passé incontestable, la cause d'une
blessure, la preuve de quelque chose qui a eu lieu et qui le concerne.
Modiano et son double accidenté boitent tout au long du livre.
Comme Jacob après son combat avec l'Ange. Leurs corps portent
la cicatrice d'une épreuve qui, comme dans la Bible, signale qu'ils
ont désormais le droit et le devoir de se souvenir. On a l'impression
que Modiano veut nous signifier qu'il achève un cycle. Qu'il solde
ses obsessions d'amnésique. Qu'il accepte la disparition définitive
de son père. Il était temps : ce romancier adolescent sera bientôt
sexagénaire." Jean-Paul Enthoven, Accident Nocturne, Le Point, 3-10-2003.
Parents
1
« Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pedigree.
Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun
milieu bien défini. Si ballottés, si incertains
que je dois bien m'efforcer de trouver quelques empreintes et
quelques balises dans ce sable mouvant comme on s'efforce de remplir
avec des lettres à moitié effacées une fiche
d'état-civil ou un questionnaire administratif »
Un Pedigree, roman, Gallimard, 2006
Parents
2
<< Je m’éloignais de mes parents. Mon père
me donnait rendez-vous dans les arrière-salles de café,
des halls d’hôtels ou des buffets des gares, comme
s’il choisissait des endroits de passage pour se débarrasser
de moi et s’enfuir avec ses secrets [...] Ma mère,
elle, me parlait de plus en plus fort, je le devinais aux mouvements
saccadés de ses lèvres, car il y avait entre nous
une vitre qui étouffait sa voix. >> D.P.O.,
p.137
~~~~~~~~~~~
Le
Parfum d'Yvonne de Patrice Leconte, FILM (1994).
Libre adaptation de Villa triste*.
Panier
à salade
Jérôme Garcin – Vous racontez, p. 76, que votre père,
pour se débarrasser de vous, vous a fait embarquer dans un panier
à salade. Est-ce vrai?
P. Modiano. – Oui. Cet épisode, qui a eu lieu en 1963,
j’avais donc 18 ans, m’a beaucoup marqué. Mais je le raconte sans
aucun ressentiment. J’étais à un moment vraiment critique. J’avais
besoin d’argent pour survivre. Ma mère, qui vivotait au théâtre,
ne pouvait rien pour moi, et de manière très calme, sans aucune
agressivité, j’avais demandé à mon père de m’aider et il avait
aussitôt appelé la police, qui nous a embarqués tous les deux.
C’est une impression très étrange que de se retrouver avec son
père dans un panier à salade. Au commissariat, mon père m’a chargé
et m’a traité de voyou. Après quoi les flics l’ont laissé repartir
et m’ont gardé. Pas longtemps, mais ça a été un choc symbolique.
Jérôme Garcin, Rencontre
avec P Modiano, Le Nouvel Observateur, 2 octobre 2003
Paris
1.
Paris,le personnage principal ?
Un espace commun à de nombreux ouvrages et sans doute le personnage principal
de l'oeuvre de PM. La ville représente un espace romanesque où un
personnage, le plus souvent un narrateur part en quête, traversant les
rues, les avenues ou les arrondissements, ou rêvant dans un parc, un square,
un café. Arpentant la ville, dans les dédales de laquelle il laisse
errer sa mémoire, il cherche à dégager le passé de
l’oubli. L’intrigue est souvent mince, prétexte parfois à l’errance,
et le narrateur nous promène à travers la ville et sa mémoire
pour reconstituer un certain passé et les fragiles fragments qui le composent.
Selon
Carine Duvillé, "si Paris apparaît
comme l’unique espace français où l’apatride
est habilité à exister, c’est aussi un lieu
d’oppression physique et morale, et l’espace urbain
du romancier, mentalement géométrisé et
cadastré, retranscrit les obsessions du personnage sur
le plan géographique. Prisonniers de leurs traumatismes,
les narrateurs entretiennent une mystérieuse correspondance
entre les méandres de leur esprit et l’espace qu’ils
se trouvent contraints d’arpenter. Que ce sentiment d’oppression
soit légitimé par l’Histoire ou non, il représente
l’une des constantes de l’œuvre, parfaitement
incarnée par la topographie." Carine
Duvillé Errance et Mémoire : Paris et sa topographie
chez Patrick Modiano Mémoire de maitrise, juillet 2000.
Paris IV, Sorbone.
2.
Paris fantasmagorique (un)
<<Paris prend parfois des allures fantasmagoriques d’une
extraordinaire poésie fantastique, et peut devenir, au
sens propre, cette « ville à la dérive »[14]
où le narrateur, en se promenant, projette ses visions
et son angoisse. Ainsi, à de nombreuses reprises, la ville
se transforme en navire, en « Titanic »[15], symbole
d’un monde englouti, et la métaphore du naufrage,
filée dans tout le roman, atteint à de certains
moments, au comble de l’étouffement et du désarroi
du héros, son apogée.>> (...)
<< Mêlant passé et présent, la ville
apparaît comme cet espace horizontal où les strates
temporelles se superposent[39]. Ainsi, les références
à l’Histoire sont brouillées, car elles naissent
simultanément dans les impressions que la ville exerce
sur le narrateur.>> Carine Duvillé Errance
et Mémoire : Paris et sa topographie chez Patrick Modiano
Mémoirede maitrise, juillet 2000. Paris IV, Sorbone.
3.
Paris (la destruction programmée de)
<< En
août 1944,
la capitale de la France aurait pu connaître le sort tragique
d'un grand nombre de villes d'Europe pendant la Seconde Guerre
mondiale, qu'il s'agisse des villes normandes, telles que Caen,
pilonnées par l'aviation alliée lors du Débarquement,
des villes russes ou polonaises – Varsovie en tête – détruites
par l'armée allemande, ou des villes allemandes, parmi
lesquelles Hambourg, Dresde, Berlin et Cologne, anéanties
sous les bombes. Sans oublier, à l'autre bout du monde,
Tokyo, capitale de bois et de papier, brûlant comme une
torche sous l'effet du phosphore tombé du ciel, avant
que les premières bombes atomiques de l'histoire ne réduisent
en paysage lunaire Hiroshima et Nagasaki.
La destruction de Paris avait en effet été programmée
par Hitler qui, alors que les fusées V 1 commençaient à pleuvoir
sur Londres, voulait transformer la capitale française
en champ de ruines dans l'hypothèse où l'armée
allemande serait contrainte de s'en retirer. Pour accomplir cette
tâche, il avait choisi un officier énergique, le
général Dietrich von Choltitz, qui avait fait ses
preuves sur le front de l'Est puis en Normandie. Le risque de
voir cet officier accomplir scrupuleusement les ordres du Führer était
d'autant plus réel qu'à l'intérieur de Paris
les Forces françaises de l'intérieur, fortement
noyautées par les communistes et considérées
par les Allemands comme des «terroristes», étaient
décidées à en découdre. A tous risques.
Les
hommes et les événements allaient permettre
d'éviter la tragédie. Pressés par le général
de Gaulle, chef de la France libre et du gouvernement provisoire
de la République française, les Alliés,
résolus initialement à contourner Paris afin de
poursuivre leur percée vers l'Est, acceptaient en fin
de compte de voler au secours de la capitale en confiant cette
mission à la 2e division blindée du général
Leclerc. Soumis aux sollicitations pressantes de Pierre Taittinger,
président du conseil municipal de Paris, et de Raoul Nordling,
consul de Suède, le général von Sholtitz,
sans doute convaincu intérieurement de l'absurdité criminelle
de l'ordre donné par son chef suprême, acceptait
d'épargner la ville.
Suivirent
quelques jours de combats ponctués par une
trêve, combats qui n'évitèrent ni les pertes
de part et d'autre, ni des règlements de comptes sommaires,
mais qui se soldèrent par la reddition de l'état-major
allemand. Ainsi fut évité l'irréparable.>>
Claude Jacquemart, le Figaro, 25 août 2004.
4.
Un Paris imaginaire
Faut-il avoir connu
ce Paris perdu pour bien vous lire ?
Ceux qui partagent les mêmes souvenirs et la même
expérience du temps perdu retrouveront certains itinéraires
et mots de passe. Mais le Paris que j'évoque est devenu
avec le temps totalement imaginaire, onirique et intemporel.
5. Paris
et les Parents loin et proches
Jérôme Garcin – Est-ce que le plus perturbant
n’était pas, en allant de ville en ville, d’être chaque fois plus
éloigné de vos parents?
P. Modiano. – Ce qui est terrible, vous voyez,
c’est que je n’avais pas pensé à ça. Et c’est parce que vous venez
de le formuler et de le synthétiser, ce dont je suis absolument
incapable, que j’en prends conscience. J’envie chez un Michel
Leiris la faculté d’introspection. J’ai toujours pensé que ceux
qui me lisent me connaissent mieux que je ne me comprends. Ces
séjours en province, où les gens s’occupaient de moi par substitution,
je les vivais en effet comme des rejets successifs. C’est la raison
pour laquelle, quand j’ai atteint la majorité, Paris m’a paru
comme le refuge où débarque un permissionnaire. Et encore! Car
j’ai été pensionnaire au lycée Henri-IV, c’est-à-dire enfermé
dans la ville où vivaient pourtant mes parents, et cela m’a semblé
encore plus dur à vivre. Je voyais mes copains rentrer chez eux
à 16 h 30, et, moi, je restais cloîtré dans le dortoir du lycée
avec des veilleurs de nuit. C’était lugubre et absurde. Aujourd’hui,
je ne pourrais plus vivre ailleurs qu’à Paris. Jérôme
Garcin, Rencontre avec P Modiano, Le Nouvel Observateur, 2 octobre
2003
6. Paris. N.O.- D'«Horizons
perdus», votre héroïne, Louki, dit que «c'est
l'histoire de gens qui gravissent les montagnes du Tibet vers
le monastère de Shangri-La pour apprendre les secrets
de la vie et de la sagesse.» Et elle ajoute aussitôt: «Ce
n'est pas la peine d'aller si loin. Pour moi, Montmartre, c'est
le Tibet.» Il me semble que cette phrase, vous pourriez
la reprendre à votre compte, vous qui voyagez si peu dans
le monde et tellement à Paris.
P. Modiano.- Le Paris où j'ai vécu et que j'arpente
dans mes livres n'existe plus. Je n'écris que pour le
retrouver. Ce n'est pas de la nostalgie, je ne regrette pas du
tout ce qui était avant. C'est simplement que j'ai fait
de Paris ma ville intérieure, une cité onirique,
intemporelle où les époques se superposent et où s'incarne
ce que Nietzsche appelait «l'éternel retour.» Il
m'est très difficile maintenant de la quitter. C'est ce
qui me donne si souvent l'impression, que je n'aime pas, de me
répéter, de tourner en rond.
N.O.- Est-ce que fuguer sans cesse, comme le fait Louki, n'est
pas la seule manière de bien connaître une ville et
ses frontières, invisibles à l'œil nu?
P. Modiano.- C'est comme ça, du moins, que j'ai découvert
Paris. J'avais entre douze et quinze ans, mes parents s'entendaient
mal, j'étais livré à moi-même, j'avais
l'impression de dériver au fil de promenades interdites,
de vivre de grandes aventures qui n'étaient pas de mon âge,
d'être confronté au fantastique social, certains quartiers
m'effrayaient, c'était un choc violent, que j'exprime dans
ce livre mais aussi dans tous les autres. Peut-être ne m'en
suis-je jamais remis de cette errance*-là et de cette solitude-là.
Entretien
avec Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur",
27 septembre 2007
Paris
à l'heure allemande, de Jean Pierre Azéma,
article paru dans Le Monde
du 22 août 1989
Paris
(libération de) La Bataille et le mythe de André
Kaspi, article paru dans Le Monde © du 25-08-1994
Paris sera toujours
Paris
Chanson de C.Oberfeld
et A.Willemetz chantée par Maurice Chevalier, 1939.
Par précaution on a beau mettre,
Des croisillons à nos fenêtres,
Passer au bleu nos devantures,
Et jusqu'aux pneus de nos voitures,
Désentoiler tous nos musées,
Chambouler les Champs-Elysées,
Emmailloter de terre battue,
Toutes les beautés de nos statues,
Voiler le soir les réverbères,
Plonger dans le noir la ville lumière.
Paris sera toujours
Paris, la plus belle ville monde.
Malgré l'obscurité profonde,
Son éclat ne peut être assombri.
Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage
Plus on voit briller son courage,
Sa bonne humeur et son esprit.
Paris sera toujours Paris
Pour qu'à ce bruit
Chacun s'entraîne,
On fait la nuit
Jouer de la sirène.
Nous contraindre à faire le zouave
En pyjama dans notre cave.
On aura beau par des oukases,
Nous couper l'veau et même le jazz,
Nous imposer le masque à gaz,
Les mots croisés à quatre cases,
Nous obliger dans nos demeures,
A nous coucher tous à neuf, dix, onze heuresŠ
Refrain
Bien que ma foi
depuis octobre,
Les robes soient beaucoup plus sobres,
Qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes,
Que les couleurs soient plus discrètes,
Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les hermines,
Que les bijoux pleins de décence,
Brillent surtout par leur absence.
Que la beauté soit moins voyante,
Moins effrontée, moins froufroutante
Paris sera toujours
Paris, la plus belle fille monde.
Paris sera toujours Paris, on peut limiter ses dépenses,
Sa distinction, son élégance,
N'en ont alors que plus de prix,
Paris sera toujours Paris !
PARIS
Manet
Van MONTFRANS*, Dante chez Modiano : une divine comédie
à Paris*.
http://www.revue-relief.org ; Igitur, Utrecht Publishing &
Archiving Services
© The author keeps the copyright of this article
Paris (Mon)
"Mon Paris n'est
pas un Paris de nostalgie mais un Paris rêvé, composé
d'expressions vécues et incorporées à la
fiction. Ces expressions sont devenues intemporelles. C'est le
cas des vieux numéros de téléphone, Trinité
14-28 ou Jasmin 34-21, qui figurent dans mes romans : pour les
jeunes qui ne les ont pas connus, ces numéros relèvent
de l'imaginaire plus que de la tentative de restituer le passé.
C'est de la littérature. Le passé devient intemporel.
Et l'intemporel, c'est la littérature." "Mon
Paris n'est pas un Paris de nostalgie mais un Paris rêvé"
entretien avec François Busnel (Lire), 04/03/2010
Passage
"En pensant à ce personnage [Louki], je pensais un
peu à moi. Jeune, je songeais à tous ces gens qu’on
croise dans des lieux de passage, des gares ou des cafés,
et je me disais trouvais dommage de ne pas pouvoir les répertorier,
pour garder une trace de leur passage. C’est pour ça
aussi que j’ai toujours été fasciné
par les annuaires*, par exemple : les gens y figurent et puis,
l’année d’après, ils disparaissent.
La seule trace qui reste d’eux, finalement, c’est
cet annuaire." [Rencontre]
Patrick Modiano à l'occasion de la sortie de Dans le
café de la jeunesse perdue, MK2 diffusion, 24/01/2008
PARIS
LIBERE Escampette et escopette dans les Belles Lettres par Bertrand
Poirot Delpech
Exit Céline, Rebatet, Brasillach ou Drieu la Rochelle.Les
autres écrivains, résistants de plus ou moins fraîche
date, préparent l'épuration
" De toutes les passions, la peur est celle
qui affaiblit le plus le jugement ", Cardinal de Retz.
LA
masse des Parisiens, fin août 44, pensez s'ils s'en moquent,
des arts et des lettres ! Ils n'ont plus d'yeux que pour leurs
cartes murales où les drapeaux alliés partis de
Normandie forment autour de la capitale la corolle tant espérée.
Ils n'ont d'oreilles que pour les tirs qui s'espacent et s'éloignent,
les coups de téléphone d'amis banlieusards annonçant
les premiers blindés libérateurs. La voilà,
la vraie culture, celle qui aide à revivre !
Bronzés
et penauds, les boches de la DCA descendent des toits où
ils s'étaient ménagé des cabanes de vacances
en Forêt-Noire. De vieux réservistes sortent de leurs
planques, mains sur la tête, veste ouverte, toute morgue
bue. Des attelages flapis ont remplacé les fringantes machines
de juin 40. La défaite, de quelque camp qu'elle soit, sent
toujours la pisse et le chou tiède. La Libération
est une question d'heures, de minutes. A condition d'éviter
les balles perdues (ce serait trop bête si près du
but), la joie de la délivrance et des retrouvailles va
carillonner dans les clochers, dans les coeurs. Alors, la culture
: cadet des soucis ! Pourtant, ils ont rendu bien des services,
ces arts et lettres, depuis quatre ans : pour tromper la faim
et l'attente, pour choisir son camp, s'y maintenir, en changer,
accompagner des amours, soulager des deuils, le tout-venant de
l'existence. La gêne matérielle est propice à
la consommation de symbolique. Alertes et couvre-feux favorisent
la lecture. Le nombre des Français lisant plus d'un livre
par mois a triplé entre 1938 et 1944. Les prêts des
bibliothèques municipales ont doublé. Les librairies
prospèrent. Les bouquinistes des quais vident leurs boîtes.
Plus
qu'on ne découvre, on relit : les classiques, les best-sellers
d'avant-guerre, la tuberculose selon Van der Meersch (Corps et
âmes), l'eugénisme selon Carrel (l'Homme, cet inconnu),
la déchristianisation des ouvriers selon l'abbé
Godin (France, pays de mission). Les nouveautés se font
rares. Non que les écrivains patriotes choisissent le silence
: ils seront une poignée à le faire ou à
le suggérer, Chamson, Guéhenno, Prévost,
Vercors (avec le fameux Silence de la mer). Tous plutôt
de gauche, autant le noter. Une liste dite " Otto ",
établie par l'occupant avec l'aide empressée de
certains éditeurs, a interdit de publication, en vue d'"
assainir les relations franco-allemandes ", les auteurs gaullistes,
communistes, juifs et francs-maçons. Cela fait du monde.
Aléas de la purification : des écrivains proches
de la collaboration subissent la même quarantaine que Kessel
ou Maurois. On retiendra qu'aucun des futurs dénonciateurs
de l'épuration de 1945 n'a protesté contre cette
censure de la liste " Otto ".
Les
" bons de papier " qui réduisent des deux tiers
la consommation des éditeurs sont répartis de manière
à favoriser les titres qui pensent " bien ".
Le succès des Décombres de Rebatet _ 100 000 exemplaires,
un record _, et celui des pamphlets de Céline s'expliquent
par ce coup de pouce, même s'il est vrai que la classe lisante
se délecte à l'évocation de la décadence
des démocraties " judéo-maçonnes ",
entre deux bols d'air frais : le Petit Prince, de Saint-Exupéry,
ou Premier de cordée, de Frison-Roche.
Des
auteurs qui s'engageront peu ou prou contre le nazisme passent
entre les gouttes. Desnos vient de publier Etat de veille ; Bataille
: le Coupable ; Sartre : l'Etre et le Néant ; Simone de
Beauvoir : l'Invitée ; Char : Seuls demeurent. Aragon sort
Aurélien, Triolet : le Premier Accroc. On n'a pas oublié
qu'avant de diriger le Combat clandestin, Camus a fait paraître
l'Etranger, le Mythe de Sisyphe, et qu'il a fait jouer le Malentendu.
Historiens
et polémistes ont plus souvent évoqué les
paradoxes de la vie théâtrale que ceux de la librairie.
C'est que la scène représente alors l'occasion unique
de se retrouver à plusieurs, en l'absence de droit de réunion,
et de communier par allusions dans des opinions qu'on aimerait
subversives. Le film de François Truffaut, le Dernier Métro,
a immortalisé ce moment rare dans l'histoire théâtrale.
L'Antigone d'Anouilh semble passer en fraude un message de rébellion
contre l'ordre. La presse du mois d'août montre que la pièce
reste à l'affiche tout l'été, au coeur des
combats, ainsi que le Voyageur sans bagages, du même Anouilh.
A 19 heures, à cause des restrictions d'électricité,
les rideaux parisiens se lèvent, à la lueur des
verrières de coulisses et de quinquets, sur la Danse de
mort, de Strindberg, tandis que les duos Sourza-Souplex et Charpini-Brancato
tentent d'arracher aux publics du Casino de Paris et du Moulin-Rouge
des rires dont on regrette qu'ils n'aient pas été
enregistrés, tant on les imagine jaunes... ou vert-de-gris.
J'oubliais,
ou plutôt je gardais pour la bonne bouche, le Huis clos
que Sartre vient de donner au Vieux-Colombier, après les
Mouches, jouées en 1943 au Sarah-Bernhardt, débaptisé
pour cause de lois raciales. Pour ce faire, il a fallu que l'auteur
sollicite l'autorisation de l'occupant, ni plus ni moins qu'Anouilh,
Montherlant ou Claudel. Seulement voilà : c'était
Sartre, c'est-à-dire celui qui allait siéger au
comité d'épuration des écrivains et prôner
la lutte, notamment antifasciste ; d'où les sarcasmes de
ses détracteurs, encore aujourd'hui.
En
plein mois d'août 44, dans la clarté d'une fin de
jour, il faut imaginer Michel Vitold, feutre mou sur l'arrière
de la tête, expliquant à Gaby Sylvia, de sa voix
métallique comme celle de l'auteur, que les bonnes intentions
n'excusent rien, que la mort fige nos actes, que le jugement posthume
ne retiendra qu'eux, que " les conséquences de nos
actions nous saisissent aux cheveux, indifférentes à
ce que, dans l'intervalle, nous soyons devenus meilleurs "
(le mot est de Nietzsche) ; on imagine ce texte fondateur de l'engagement,
proféré à la veille des combats décisifs,
alors même que Sartre, après des velléités
de résistance en 1941, et avant son reportage de choses
vues, dans Combat, sur le Quartier latin insurgé, s'est
surtout soucié d'écrire, quand il n'animait pas
des fiestas chez Picasso ou autres, faisant dire à Simone
de Beauvoir que l'Occupation n'allait pas, ma foi, sans une certaine
sensation de liberté...
La
chronique des littérateurs en ces heures où tout
bascule ne sera connue qu'après coup. Sur le moment, ce
petit monde se téléphone les nouvelles du front
et s'interroge sur les conduites à tenir selon les risques
pris la veille dans un camp ou dans l'autre.
Côté
collabos, c'est la solution escampette qui prévaut. Peu
de jours avant l'insurrection de Paris, Céline, Rebatet,
Paquis et quelques autres grimpent dans les camions ou les wagons
de la Wehrmacht en partance pour Baden et Sigmaringen. Les sanctions
à venir vérifieront que les absents, quand vient
le temps des comptes, ont toujours raison. Il suffisait d'attendre
un peu. En bravant le peloton, Brasillach deviendra le symbole
d'une épuration réputée sans merci. C'est
oublier quelques autres pro-nazis moins affichés, comme
le capitaine de vaisseau et romancier maritime Paul Chack, égaré
par une anglophobie en vogue dans la Royale. Drieu la Rochelle
ne laissera à personne le lugubre honneur de le punir d'un
choix plus névrotique que délibéré.
Le 11 août, ayant refusé de filer en Espagne ou en
Suisse, il tente ce qu'il s'est " toujours dit " qu'il
ferait. Suicide manqué. La seconde fois, début 1945,
sera la bonne. Prévost est mort dans le Vercors, Saint
Ex' en plein ciel, Max Jacob en déportation. Quelques vies
s'achèvent dans la cohérence admirable ou vont se
poursuivre dans des gloires discutées. Le gros de la troupe
(au sens de cirque) bricole dans ce qui est justifiable et ce
qui ne l'est pas. Les anciens admirateurs de l'Allemagne aryenne
aux torses bombés s'esbignent vers des couvents toscans
ou des haciendas sud-américaines. Les pèlerins de
Weimar et les commensaux des kommandanturs se procurent en vitesse
des certificats de double jeu et d'aide à un " bon
" juif.
Dès
le 15 août, le gouvernement provisoire établit des
listes de journalistes, éditeurs et écrivains à
appréhender. Des résistants de plus ou moins fraîche
date sortent l'escopette anti-collabo et suggèrent des
ajouts aux listes de traîtres. D'autres rebelles plus chevronnés
interviennent en faveur d'auteurs maison, de voisins de palier.
La France pensante pousse à l'extrême le don connu
de tout le pays pour la délation, la vengeance envieuse,
la protection bien placée, la justice à la tête
du client, et le passe-droit. Les naïfs seront les grands
perdants ; à eux les lourdes peines sans remise. Les rusés,
eux, se retrouveront du côté qui leur a toujours
convenu, celui du manche. Vite taxés de jalousie pour le
talent des proscrits, les écrivains résistants ne
tarderont pas à lever des sanctions mal réparties.
Tandis
que les occupants de marque comme Jünger et le lieutenant
Heller retrouveront la vie civile avec des souvenirs de roseraies
à Bagatelle et de causeurs giralduciens, la guéguerre
franco-française sur le thème " Que faisait-il
dans les années 40 ? " va durer un demi-siècle,
avec un regain d'âpreté en fin de période,
comme si le temps rebroussait chemin. La querelle pourrait bien
ne jamais s'éteindre, tels les souvenirs de malentendus.
C'est une aubaine pour un milieu qui ne dispose plus de grandes
causes idéologiques ou esthétiques pour pratiquer
son sport favori, l'entre-déchirement.
Nous
sommes le 25 août au soir. L'histoire chavire à la
vitesse du jour chassant la nuit. Les chars de Leclerc ont fait
trembler les bitumes et les coeurs de la capitale. On remet à
demain le bilan des têtes à couper, des honneurs
resplendissants ou salis, des talents fourvoyés, des combines
piètres, des oeuvres que la défaite et ses suites
auront produites. Le temps est aux soulagements vécus,
plus forts que toutes les émotions de l'art. On ne sait
pas encore, mais on sent que, dans quelques mois, on se jettera
sur les rééditions, sur les livres et les films
américains, le jazz, avec la même voracité
que sur la bouffe revenue. Déjà, Saint-Germain-des-Prés
danse dans les anciens abris et théorise l'éternelle
révolte du jeune âge.
De
ce magma de douleurs et d'exaltations, de ces vies privées
bousculées entre l'attente des disparus, les quais de gare
sans espoir et les petits bonheurs aux airs de larcins, retenons
deux nouvelles connues le même jour, et bien à l'image
de l'heure.
Arrêté
le 23 août, Sacha Guitry, qui avait un peu trop dîné
avec l'élite occupante, pour le plaisir de la conversation,
restera à Drancy jusqu'en octobre, date à laquelle
la France le rendra à son activité toute nationale
: le charme.
Sur
une barricade parisienne, s'est fait flinguer cet escogriffe d'Aimos,
comédien de la débrouillardise populaire, avec casquette
et bretelles, le clochard de Quai des brumes qui rêvait
de coucher, enfin, dans des draps blancs. © Le Monde, 25
Août 1994
~~~~~~~~
parler
(laisser les enfants)
«
Et puis j’appartiens à une génération
où on ne laissait pas parler les enfants, sauf en certaines
occasions assez rares et s’ils en demandaient la permission.
Mais on ne les écoutait pas et bien souvent on leur coupait
la parole. Voilà ce qui explique la difficulté d’élocution
de certains d’entre nous, tantôt hésitante,
tantôt trop rapide, comme s’ils craignaient à
chaque instant d’être interrompus. D’où,
sans doute, ce désir d’écrire qui m’a
pris, comme beaucoup d’autres, au sortir de l’enfance.
Vous espérez que les adultes vous liront. Ils seront obligés
ainsi de vous écouter sans vous interrompre et ils sauront
une fois pour toutes ce que vous avez sur le coeur. »
7
décembre 2014. Discours de stockholm, prononcé 3
jours avant la remise du prix Nobel de Littérature.
Parler
pour écrire
"lorsque l'on fait appel à lui [à un écrivain] pour écrire
un scénario, ce sont des discussions interminables soit avec un
metteur en scène soit avec un autre scénariste. Il faut parler
sans arrêt, après on écrit le scénario, mais on ne peut écrire
qu'après avoir beaucoup parlé. Il y a une énorme masse d'énergie
qui est dilapidée dans des conversations, dans des digressions.
En même temps, on y est obligé parce que c'est ce qui va nourrir
le scénario. Mais c'est un truc que j'ai toujours trouvé épuisant.
C'est une chose terrible pour un romancier, parce que quand on
écrit un roman, c'est le contraire. C'est une sorte de rêverie
silencieuse, et on n'est pas toujours obligé de parler."
Synopsis 10, entretien
avec Judith Louis à propos de l'adaptation de Dimanches d'Août
Passé
/ mémoire
Il aurait dit à Emmanuel Berl en 1976 «Me créer
un passé et une mémoire avec le passé et la mémoire des autres.»
Passage
"En pensant à ce personnage [Louki], je pensais un peu à moi.
Jeune, je songeais à tous ces gens qu’on croise dans des lieux
de passage, des gares ou des cafés, et je trouvais dommage de ne
pas pouvoir les répertorier, pour garder une trace de leur passage.
C’est pour ça
aussi que j’ai toujours été fasciné par les
annuaires*, par exemple : les gens y figurent et puis, l’année
d’après,
ils disparaissent. La seule trace qui reste d’eux, finalement, c’est
cet annuaire." [Rencontre]
Patrick Modiano à l'occasion de la sortie de Dans le café de
la jeunesse perdue, MK2 diffusion, 24/01/2008
Darquier de PELLEPOIX
<< Louis Darquier de Pellepoix nait à Cahors le 19 décembre 1897. Engagé volontaire à dix-sept ans, en 1914, c'est un brillant combattant. Il vit ensuite de petits emplois dans les affaires et milite à l'extrême droite. Le 6 février 1934, au cours des manifestations organisées par les Ligues, il est gravement blessé. Il préside l'Association des blessés du 6 février 1934 et devient, la même année, secrétaire général adjoint du quotidien le Jour.L'année suivante, il se fait élire conseiller municipal de Paris sur un programme " national antijuif ".
En mai 1937, il prend la présidence du Comité antijuif de France, qui fédère les principaux organes de combat contre les juifs et les francs-maçons. " Il faut, s'écrie-t-il au cours d'une réunion publique à la salle Wagram, de toute urgence résoudre la question juive. Que les juifs soient expulsés ou qu'ils soient massacrés. " En 1939, mobilisé, il se bat à nouveau brillamment et est fait prisonnier. Libéré de l'Oflag II D, il fonde, en novembre 1940, l'Union française pour la défense
de la race.
Une première fois, en 1941, il est proposé par les Allemands comme responsable de la question juive en France, sur une liste où figure notamment Céline. Ses protecteurs réussissent à l'imposer _ après le retour au pouvoir de Laval, le 6 mai 1942 _ au poste de commissaire général aux questions juives, où il succède à Xavier Vallat. Il exerce ses fonctions jusqu'en février 1944, date à laquelle il sera chassé officiellement pour malversations dans la gestion des biens juifs. " Le Petit Parisien " du 1er février
1943.
A la Libération, Darquier de Pellepoix passe en Espagne, où il
jouit de vives sympathies dans les milieux du gouvernement franquiste.
Il a été condamné à mort par contumace, par la Haute Cour de justice, le 19 juin 1947, pour " intelligence avec une puissance étrangère ".
En 1978, le journaliste Philippe Ganier-Raymond le retrouve,
paralysé, en Andalousie et s'entretient avec lui. Darquier de Pellepoix lui déclare notamment : " Je vais vous dire, moi, ce qui s'est exactement passé à Auschwitz. On a gazé. Oui, c'est vrai. Mais on a gazé les poux... Pendant ce temps-là, on désinfectait leurs vêtements...Mais que voulez-vous, ils sont comme ça,
les juifs, il faut qu'ils mentent. "
Cet entretien, publié dans l'Express du 28 octobre 1978, provoque une vague de protestations. L'extradition de Darquier est réclamée mais ne peut être obtenue, car l'ancien commissaire aux questions juives n'a pas été condamné comme
criminel de guerre.
Darquier de Pellepoix est mort le 29 août 1980 près de Malaga. Sa mort ne fut connue en France que deux ans plus tard. (le Monde, 22 février 1983.) * Informations tirées notamment de la France antisémite de Darquier de Pellepoix, Jean Laloum. Éditions Syros, 1979.>> Le Monde 17 mai 1987
Un
Pedigree [2005]
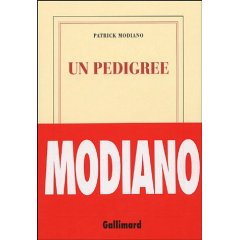 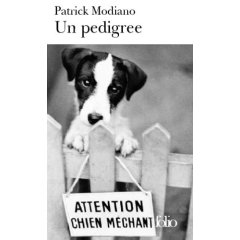
Quatième
de couverture : " J'écris ces pages comme on
rédige
un constat ou un curriculum vitae, à titre documentaire
et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était
pas la mienne. Les événements que j'évoquerai
jusqu'à ma vingt et unième année, je
les ai vécus en transparence — ce procédé qui
consiste à faire défiler en arrière-plan
des paysages, alors que les acteurs restent immobiles sur
un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression
que beaucoup d'autres ont ressentie avant moi : tout défilait
en transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie."
Un Pedigree, Premières pages.
Un
Pedigree. Entretien publié par les éditions Gallimard lors
de la publication de l'ouvrage
<<
Pourquoi, aujourd'hui, cette envie de prendre la parole,
de rendre publics ces faits réels, ces données
personnelles ?
Patrick Modiano — Parce que plus de quarante ans ont
passé et que tout cela appartient à une autre vie — et,
comme je l'écris dans ce livre, à « une vie
qui n'était pas la mienne ». Je n'éprouve
aucune impression de trahison et d'indécence. Le seul événement
qui m'a vraiment concerné pendant toutes ces années,
c'est la mort de mon frère. Le reste ne méritait
pas le secret et ce que Henri Michaux appelle « la discrétion
de l'intime ».
Plus
on entre dans la lecture de ces souvenirs, plus la frontière
entre réalité et fiction semble s'abolir…
Patrick Modiano — Presque chaque paragraphe de ce livre
peut se retrouver dispersé dans mes autres livres, et « transposé » dans
l'imaginaire. Il suffit d'appuyer sur un bouton, comme sur un
tableau de commande.
Tout
ce petit monde évoque une troupe de mauvais comédiens
: le passage où votre mère joue dans une pièce
calamiteuse, écrite par un amateur fortuné et représentée
uniquement pour ses amis, n'est-il pas emblématique de
tout le livre ? Patrick Modiano — Oui, on a l'impression de voir évoluer
une troupe de comédiens sans grand talent qui jouent souvent
faux. Mais malheureusement, je ne crois pas qu'ils éprouvent
un grand plaisir à le faire. Ils font partie de ces gens
qui meurent sans avoir appris sur eux-mêmes un grain de
vérité. Ils ne savent pas qui ils sont en réalité.
Ce sont des fantoches. Et, à cet égard, le passage
auquel vous faites allusion est bien emblématique.
Il
n'y a aucune rupture de ton entre ce livre et vos romans
précédents, à l'exception notable d'un humour
discret mais plutôt noir et décapant, comme si vous
vous sentiez plus libre à l'égard des personnes
réelles que des personnages de fiction…
Patrick Modiano — Je ne peux pas trop employer dans la
fiction cet « humour discret, plutôt noir et décapant »,
parce que, à trop forte dose, cela orienterait la fiction
vers la satire, et j'ai besoin que les personnages de fiction
me fassent rêver.
Vous
semblez finalement éprouver de la
tendresse pour la plupart des protagonistes…
Patrick Modiano — Peut-être une certaine tendresse,
mais qui se confond avec la pitié.>>
Pedigree
et autobiographie 1
"La
parution et le succès d'Un pedigree ont-ils changé
beaucoup de choses en vous ?
P.M. On pouvait classer ce livre du côté des autobiographies
- c'est d'ailleurs ce que l'on a fait - mais j'ai toujours eu
l'impression que ce livre se rattachait aux romans. En fait, la
perspective de l'autobiographie m'a toujours perturbé.
Dans Un pedigree, je ne racontais pas une vie, la mienne. Je parlais
de choses qui m'avaient été imposées. Ce
n'est pas la même perspective, vous comprenez. Je parlais
de choses qui m'avaient fait souffrir mais qui m'étaient
étrangères, qui ne m'étaient pas intimes.
Bien sûr, il s'agissait de mes parents. Mais ces choses
m'avaient été imposées par eux et étaient
presque comme des corps étrangers. J'ai écrit ce
livre pour me débarrasser de ces éléments
étrangers, pas pour raconter ma vie. Le pedigree, comme
pour les chiens ou les chevaux, renvoie aux choses dont nous ne
sommes pas responsables : nos parents, par exemple. Mais ce livre
ne relevait absolument pas d'une démarche pour essayer
de me comprendre moi-même. J'ai toujours trouvé qu'il
y avait quelque chose d'un peu faux dans l'autobiographie. Un
ton qui est toujours faux. On se met toujours en valeur. Ou bien
on oublie beaucoup de choses, ou on les cache... L'autobiographie
m'a toujours paru bizarre. Suspecte. On pourrait d'ailleurs faire
un pastiche des différentes formes d'autobiographie. J'ai
aimé en lire mais il y a toujours une forme de mensonge.
Il y a là une sorte d'impudeur. On ment parfois par omission,
ou en présentant les choses sous un angle qui n'est pas
celui de la vérité mais de la trahison. Tout cela
est un peu bizarre. Un pedigree n'était pas une autobiographie
mais le récit de choses qui m'avaient fait souffrir tout
en m'étant étrangères. Ce qui m'émeut,
dans les grandes autobiographies, celles des Russes ou des Anglais,
c'est qu'ils parlent tous de leur enfance comme d'un Eden perdu
; or, pour moi, l'enfance fut tout à fait autre..."
"Mon Paris n'est pas un Paris de nostalgie
mais un Paris rêvé" entretien avec François
Busnel (Lire), 04/03/2010
Pedigree
et autobiographie 2
- Dans votre oeuvre, seul Un Pedigree relève strictement
de l'autobioraphie ?
PM
- "Oui, on peut considérer les choses
ainsi. Pourtant, bizarrement, c'est un livre où je ne parle
pas de choses ou de gens très intimes. En fait, j'ai écrit
livre pour me délester de ce qui m'avait été
imposé dans la vie : mes parents, les personnes qu'on a
autour de soi lorsqu'on est enfant ou adolescent, qu'on n'a pas
choisies mais qui sont là et vous contraignent ou vous
pèsent. Je voulais vraiment m'en débarrasser, comme
on le fait d'un corps étranger. Je l'avais écrit
après avoir lu un ouvrage où il était question
de moi, qui comportait beaucoup d'inexactitudes. J'avais décidé
à titre documentaire et à mon seul usage, de dresser
une sorte de memorandum, très factuel et très précis,
de mon enfance et de mon adolescence. Au bout de dix ans, je l'ai
retravaillé pour qu'il soit publié. Ca a donné
ce livre lapidaire, sommaire, Un pedigree, qu'un temps
j'ai regretté d'avoir publié, justement à
cause de ce côté factuel et autobiographique. Puis
il s'est passé un phénomène bizarre : ce
livre a été comme aspiré par mes autres livres,
il ne s'en dissociait pas, il était comme un squelette
de mes autres livres." Télérama
Entretien avec Nathalie Crom, 01-10-2014.
Pedigree
et autobiographie 3*
- Pour beaucoup, Un pedigree a marqué un tournant dans
votre oeuvre : vous publiiez pour la première fois un livre
strictement autobiographique, dans lequel vous révéliez
frontalement certains éléments de votre vie qui
n'apparaissaient que de façon détournée dans
vos romans... On aurait pu penser que ce texte marquerait la fin
de ces travaux de déblaiement que vous évoquiez
au début de notre entretien, qu'enfin le champ serait libre...
PM - J'aurais pu croire que la boucle était bouclée,
que je m'étais débarrassé de certaines choses,
mais l'idée qu'on pourrait passer à autre chose
est un peu une illusion. On est prisonnier de son imaginaire,
comme on est prisonnier de sa voix. C'est ça qui est terrible.
J'ai toujours l'impression d'écrire le même livre.
Un pedigree lui-même se réfracte sur les autres ;
et il n'a d'ailleurs d'intérêt selon moi que par
renvoi aux autres livres. Ce que j'évoque dans Un pedigree,
ce sont des choses qui m'ont pesé mais qui ne me concernaient
pas en profondeur. J'ai regretté de ne pas avoir pu écrire
un livre dans lequel j'aurais parlé d'une enfance harmonieuse,
comme je l'avais aimé chez certains écrivains russes.
Ainsi Autres rivages de Nabokov, où l'enfance est une sorte
de paradis perdu. C'est dommage. J'aurais aimé écrire
quelque chose d'élégiaque, d'émouvant...
- Est-ce que ce livre marque pour vous la fin de l'écriture
autobiographique ?
PM - Oui, parce que l'écriture autobiographique m'a toujours
embêté. Si vous voulez vraiment parler de choses
intimes qui vous concernent, c'est un peu délicat... Il
y a pour moi un ton autobiographique qui n'est jamais tout à
fait juste. Pour Un pedigree, c'était facile car je parlais
de choses dont je voulais me débarrasser. Mais, si on veut
vraiment entrer dans le vif du sujet, on est obligé de
parler de choses très intimes, de gens qui ont été
mêlés à votre vie... Vous n'êtes pas
sûr que vous dites des choses vraiment justes sur eux. C'est
très périlleux, il y a toujours des oublis, volontaires
ou involontaires. Certaines autobiographies m'ont plu, comme Autres
rivages, ou Le Bruit du temps de Mandelstam. Mais ça m'a
toujours fait un peu sourire, quelque part. Il y a un côté
presque ridicule, chez les hommes surtout... une manière
de se donner le beau rôle. Je pense que je n'arriverais
pas à trouver le ton juste si j'écrivais une autobiographie.
Bizarrement, j'ai eu l'impression de m'approcher plus de ma propre
vie dans la fiction.
Entretien avec Maryline Heck, Magazine Littéraire, n°
490, octobre 2009
Un
Pedigree (articles, extraits d'articles)
Le
dépôt de bilan de Patrick Modiano Le
Soir, Bruxelles 7 janvier 2005
<<
Bribes et fragments. Moments
qu'il aurait préféré oublier
et qui le hantent. À tel point que, si ce livre est parfois
insupportable tant s'y trouve consigné le dégoût
de ce qu'il était, il est aussi très précieux,
au moins pour ceux qui ont aimé ses romans. Pensez un
instant à ces pages, si nombreuses depuis 1968, où traînent
un père ambigu et sans cesse en voie de disparition, une
mère souvent absente, un jeune homme presque transparent à force
de vouloir passer inaperçu... « Un pedigree » en
est la clef, souvent évoquée par morceaux dans
les nombreux entretiens qu'à force de succès, l'auteur
a donnés comme des aveux. Avec un curieux mélange
de timidité et de bravade.
Cette
fois, il y va. De plein gré, sans que personne
ne lui demande rien. Mais avec une réticence perceptible
: Je vais continuer d'égrener ces années, sans
nostalgie mais d'une voix précipitée. Ce n'est
pas ma faute si les mots se bousculent. Il faut faire vite, ou
alors je n'en aurai plus du courage.
Le
courage de revivre, en accéléré, ces
années dont il ne veut plus. Qu'il jette à toute
allure sur le papier, afin peut-être qu'elles cessent de
résonner en lui. Qu'il jette, au sens premier.>>
Modiano,
mode d'emploi, par Pierre Assouline, Blog
La République des Lettres, 4 janvier 2005
<<
Ce récit bouleversant tant il est crépusculaire,
sans fioritures mais non sans humour, tourne apparemment autour
de deux personnages : son père, un homme d'affaires trouble
comme les époques de marché noir en produisent
; et sa mère, une actrice ratée courant le cachet.
Au milieu, ce fils à la silhouette interminable, fuyant
sa mélancolie par d'incessantes traversées de Paris,
fugueur sur les bords, mal dans sa peau, voleur à l'occasion,
progéniture écrasée par une misère
familiale qui ne dit pas son nom, interne malheureux errant de
pensionnat en pensionnat.
C'est ce qu'on voit, ce qu'on lit, à la fois terreau et
fumier de sa vingtaine de romans et récits. Mais l'essentiel
est ailleurs. Car ces 122 pages ont été écrites
pour mieux en dissimuler une seule. La seule qui compte. La plus
difficile à écrire. A tel point qu'il ne pouvait
en dire plus alors que l'homme et l'écrivain sont nés
là, c'est leur matrice. Cette page 44 où l'on peut
lire :
"
En février 1957, j'ai perdu mon frère (...) A part
mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout ce
que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur".
Voilà. Le reste n'est que littérature, mais c'est
déjà beaucoup. >>
Patrick
Modiano Lieu de naissance par Jean Claude Lebrun, L'humanité,
6 janvier 2005
<<
On l’aura compris, c’est un texte majeur, venant
se poser en clef de voûte de son imposant édifice
littéraire, que nous livre aujourd’hui l’écrivain.
Celui-ci aborde donc ici, de manière enfin frontale, cette
période qui a fait souche et donné naissance à l’oeuvre
que l’on sait. Ces années encore dans l’ombre
portée de la Seconde Guerre mondiale qui furent celles de
son enfance et de son adolescence. La couleur fade et trouble,
quasi désespérée,
en a déteint sur tous ses livres. Une jeunesse d’après-guerre,
où l’on allait le dimanche au cirque Médrano,
où l’on venait humer l’odeur musquée
et légèrement sure de la baleine Jonas exposée
sur l’esplanade
des Invalides, où l’on avait la larme à l’oeil
quand passait au Rex le mélo de Cecil B. De Mille Sous le
plus grand chapiteau du monde. Tout cela que purent vivre, émerveillés,
les petits Parisiens contemporains de Patrick Modiano. Et que lui-même, à l’inverse,
traversa dans une complète
absence d’émotion, un absolu désert du sentiment.
Parce qu’il y avait ces parents, davantage figures romanesques
troubles qu’êtres de chair. Cette mère flamande,
comédienne vouée aux itinérances et aux seconds
rôles, qui jamais ne daigna s’occuper
de lui et de son frère cadet Rudy. Et plus encore ce père,
d’une famille juive de Toscane, qui dut sans doute sa survie
pendant la guerre à ses trafics divers et à ses fréquentations
peu ragoûtantes. Par la force des choses, chargé de
l’enfant, il s’était systématiquement
appliqué à l’humilier
et à le tenir en lisière de sa vie. Jusqu’à ce
9 août
1966 où il lui fit tenir une lettre de congédiement
dans le plus détaché style
notarial. Scène ultime d’un desséchant roman
familial, en lequel l’écriture naissante avait déjà localisé son
terreau nourricier. En même temps, scène première
d’un
sauvetage par la littérature. À la manière
d’un
greffier, « J’écris ces pages comme on rédige
un constat ou un curriculum vitae », Patrick Modiano tient
en effet le récit en forme d’inventaire de ces années
maudites. Il accumule jusqu’à saturation les dates,
les noms de personnes et de lieux. Donnant ainsi une impression
d’appartenance au monde (« Que l’on me pardonne
tous ces noms et d’autres qui suivront. Je suis un chien
qui fait semblant d’avoir un pedigree »), alors même
que celui-ci se présente tel un mur infranchissable face à lui.
Il ne se trouve nulle part chez lui, surtout pas dans le logement,
qu’on imagine à peu près vide, du quai de
Conti, où le père habite à l’étage
du dessus : la domination et la répudiation en quelque sorte
déjà symboliquement
signifiées. Le texte est méthodique et sec, délibérément
terne, presque atone. C’est d’une partie depuis longtemps
morte de soi que l’écrivain aujourd’hui se déleste.
L’écriture n’ayant
eu de cesse de circonscrire ce vide et de lentement venir l’occuper,
sinon le compenser. Le faisant véritablement naître,
au bout de vingt et une années pendant lesquelles son père
l’avait étouffé et
tenu captif. L’avait en fait obligé à payer
avec lui les dettes de son douteux passé. On découvre
maintenant dans leur réalité des
visages, des lieux, des situations qui depuis 1968 font régulièrement
retour dans l’oeuvre et en forment le tissu. On subodore
de possibles scènes primitives de tel ou tel roman. Lorsque,
par exemple, dans l’un de ses rares jours de confidence,
le père avait évoqué le souvenir d’une
jeune inconnue venue s’asseoir en face de lui dans un autobus,
un soir de 1942 ou de 1943.Et dont le fils avait « beaucoup
plus tard » vainement
essayé de retrouver la trace. Comment ne pas songer là à la
véritable source cachée de Dora Bruder, bien antérieure à la
lecture du nom au mémorial de la rue Geoffroy-Lasnier
? À moins que ce ne soit le drame de l’hiver 1957, énoncé dans
une phrase d’apparence trop impassible : « À part
mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout ce que
je rapporterai ici ne me concerne en profondeur » ? Patrick
Modiano ne nous fait à aucun moment entrer dans son atelier
d’écrivain,
mais il nous en délivre des clés. Il ne nous dit
rien de sa démarche, mais il rapproche comme jamais l’oeuvre
romanesque et la vie. Suggérant dans le même temps,
en creux, leur impossible superposition, leur disjonction de fond.
Car s’il donne incontestablement à voir, il donne
plus encore à imaginer et à réfléchir.
Un pedigree vient d’une certaine manière parachever
l’oeuvre. Mais n’en épuise certainement pas
la lecture et la glose. Bien au contraire, les relance.>>
Modiano,
délivré de famille Par
Jean-Baptiste Harang, Libération
jeudi 06 janvier 2005
<<
Vous qui avez lu les livres de Patrick Modiano, vous surtout qui
avez lu tous les livres de Patrick Modiano, vous recevrez
celui-ci comme un aveu, une catharsis, une douleur, une douleur
apaisée, un cadeau, un trousseau de clés inutiles
pour une oeuvre aux portes grandes ouvertes, comme la poignée
de hasard des petits cailloux noirs qu'il aurait semés
sous lui, enfouis, sous la terre et le goudron, dans l'espoir
de ne jamais revenir, de ne jamais se retourner sur son fantôme,
ces cailloux ont germé comme des cives sous les pas abusés
et désabusés de ce chaland nonchalant des rues
de Paris : vingt romans imparables. Vous qui avez lu tous ses
livres, vous recevrez celui-ci comme un viatique, le bagage et
les gages nécessaires pour reprendre tout le voyage, de
la Place de l'Etoile à Accident nocturne. Vous saurez
mettre des noms propres sur des visages aux noms d'emprunt, vous
saurez que les vrais noms s'empruntent autant que les faux, que
les passeports s'échangent comme au bonneteau, vous saurez
rectifier de peu quelques noms de lieu, vous saurez pourquoi
tout a commencé bien avant de naître, que la guerre
qui précède notre venue au monde est notre propre
guerre, vous saurez pourquoi un enfant meurt (vous ne saurez
pas de quoi), pourquoi une automobile peut renverser un chien,
un homme, pourquoi les cafés sont tristes à la
Porte d'Orléans, et les silhouettes solubles dans le brouillard,
pourquoi ne pas trop compter sur ses parents, et ne pas leur
en vouloir. Et vous serez bien avancés.
Car tous ces détails donnés, accumulés,
ces bribes de vraie vie, brutes, parfois pointées au seul
titre d'un élément dans une liste forcément
incomplète, tous ces efforts à vider les poches
de sa mémoire, en vrac, d'un geste preste, pour s'en débarrasser,
pour n'avoir pas le temps de le regretter, comme déposés
sur la table de métal du douanier. Tous ces points de
vague lumière piqués comme des étoiles dans
le ciel d'une oeuvre que vous avez si bien lue ne l'éclairent
pas : comme dans ces allées de pénombre qui conduisent
la nuit vers des gares de province, les halos chiches de lumière
ne font qu'assombrir l'obscurité qui sépare les
réverbères.
Vous qui avez lu tous ses livres et nous autres
qui ne les avons pas tous lus, et peut-être même, à tort, pas
tous aimés, nous serons bouleversés par Un pedigree.
Pas tant parce que les choses qui y sont dites (la vie de Patrick
Modiano jusqu'à 21 ans) y sont données pour vraies,
mais parce que le fait qu'elles soient vraies commande un geste
d'écrire différent de celui du romancier. Pas le
style, non, vraiment le geste. Bien des romans de Modiano sont
ainsi construits sur une instruction, l'assemblage de bribes,
l'acharnement à rechercher des éléments
manquants, le renoncement à les trouver, et la triste
jubilation à se résigner à leur absence.
La langue pour les lier est la même, concise, directe,
tendant vers sa propre simplicité, modeste comme la limpidité.
Sauf que, dans les romans, ce travail est entrepris pour construire,
pour rassembler, et donner à croire à un effet
de réel, même s'il s'agit d'un réel mystérieux,
d'un réel qu'on feint de ne pas maîtriser, qui fait
appel à la bonne volonté du lecteur pour qu'il
rejoigne l'auteur sur le chantier. Ici, ces mêmes moyens
sont au service d'un effet inverse : il ne s'agit pas de rassembler
mais d'éloigner de soi, pas de faire croire mais de ne
pas croire que cela fut, non de fixer des images mais de s'en
débarrasser, de vidanger sa mémoire dans un texte
qui ne saurait vous réclamer des comptes, il ne s'agit
pas de faire vivre un personnage, mais d'exposer un être
qui ne se reconnaît guère comme existant, en tout
cas pas comme ayant vécu cette vraie vie qu'il rapporte
pourtant en détails déliés, indiscutables.
Alors le geste est de ceux qui brûlent leurs vaisseaux,
de ceux qui jettent des bonnets par-dessus les moulins. Le geste
est celui d'un type qui ne se retournera pas, c'est un geste
d'adieu à ce jeune homme qu'il fut et ne reconnaît
pas, et sans rancune pour ces père et mère de dureté,
c'est le geste d'un auteur à ses lecteurs, l'air de dire
: oui, c'est à partir de moi que j'ai écrit mes
livres, voici les preuves, mais vous le saviez, alors n'en parlons
plus. Lorsqu'on entre en prison, on laisse au greffe tout ce
qu'on a en poche, ici, c'est le contraire on vide son sac pour
recouvrer un peu de liberté.
Pedigree,
en français, est un mot anglais qui désigne
un extrait du livre généalogique d'un animal de
pure race. Georges Simenon avait titré ainsi, sans article,
un récit autobiographique. Le livre de Modiano s'appelle
Un pedigree, l'article indéfini en porte autant la dérision,
puisqu'il s'agit là d'un jeune homme indéfini,
que le mot même, démenti dès les premières
phrases : «Je suis né le 30 juillet 1945, à Boulogne-Billancourt,
11 allée Marguerite, d'un juif et d'une Flamande qui s'étaient
connus à Paris sous l'Occupation. J'écris juif,
en ignorant ce que le mot signifiait vraiment pour mon père
et parce qu'il était mentionné, à l'époque,
sur les cartes d'identité. Les périodes de hautes
turbulences provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si
bien que je ne me suis jamais senti un fils légitime et
encore moins un héritier.» On devrait commencer
ici un article de presse qui rendrait compte des histoires que
raconte le livre de Patrick Modiano, les résumerait, ferait
en petit et en moins bien le portrait de ses parents en aventuriers
sans succès, et des autres qu'on réduirait maladroitement à leur
pittoresque quand ils tiennent parfois tout entiers dans leur
nom, on devrait citer d'autres phrases parmi les dizaines qu'on
a cochées, mais le bas de la page nous guette comme le
butoir au bout des rails. Pas la peine, on sait que vous le lirez,
en entier, et le relirez. L'auteur, lui, l'a écrit pour
ne pas le relire. Comme on dit dans les tribunaux, il le tient
pour lu. Sur la quatrième page de couverture, on a reproduit
un paragraphe du livre qui en dit bien l'objet, il y est allégé de
cette phrase qui pourtant ne l'alourdit pas : «Je n'ai
rien à confesser ni à élucider et je n'éprouve
aucun goût pour les examens de conscience. Au contraire,
plus les choses demeuraient obscures et mystérieuses,
plus je leur portais de l'intérêt. Et même,
j'essayais de trouver du mystère à ce qui n'en
avait aucun», page 45. Patrick Modiano a préféré ne
pas rencontrer de journaliste pour parler d'Un pedigree, il a
bien fait, ces gens-là sont, dit-on, avides d'éclaircissements,
il leur répond page 112 : «Malheureusement, on ne
vous pose jamais les bonnes questions.» >>
Un
Pedigree. Chronique de Vincent Josse, France Inter
Janvier 2005
<<
On retrouve dans "Un pedigree" ce que Modiano avait
entrepris dans "Ephéméride", petit livre
de notes sur son enfance, avec comme figure centrale le père,
si énigmatique. Dans un livre autobiographique qui ressemble à ses
romans d'ailleurs et qui permet de mieux comprendre son univers,
ses obessions, Modiano pose des questions superbes sur l'héritage
: que doit-on à ses parents? Grandir, est-ce grandir contre
eux? Et quand commence t-on à vivre vraiment? Modiano
est formel : tant qu'il a dépendu de sa mère et
son père, il était "passager clandestin" de
sa vie. Il est né non pas en 45, mais une fois adulte
seulement, quand il s'est mis à l'écriture, en
68. C'est donc cette "non vie" qu'il entreprend de
peindre. En traquant ses souvenirs, comme à son habitude.
Le romancier n'envisage l'écriture qu'avec la précision
d'un lieu, d'un visage ou d'une date. Son oeil d'entomologiste
cherche à ce que rien ne lui échappe, comme si
tout consigner permettait d'évacuer à jamais la
douleur du passé. "J'écris comme on rédige
un constat, à titre documentaire, pour en finir avec une
vie qui n'était pas la mienne". Modiano raconte le
père, aux activités troubles (un gangster?), la
mère, actrice de second plan, son frère, mort jeune
et lui. Il repense aux moments récurrents ou son père
l'éloignait systématiquement de lui : la pension à Annecy,
l'internat à Paris, l'hypokhâgne à Bordeaux
d'où l'adolescent s'échappe car il fuit, souvent,
aimanté par Paris, comme un oisillon voulant retrouver
son nid. Hélas, le nid n'existe pas. Les parents divorcent
et la mère comédienne passe toujours "en coup
de vent". Jamais de "geste de tendresse", elle
lui envoie des lettres que Modiano cite avec précision.
L'amour reçu est sec, mais Modiano n'écrit pas
sec. Derrière ses mots qui hurlent le manque d'amour,
on devine le petit garçon qu'il est resté et qui éprouve
pour ses géniteurs une tendresse, malgré tout,
mêlée de pitié. Cet amour entre les lignes
d'ailleurs fait la beauté de ce témoignage. Il
se souvient d'un livre sur la table de chevet du père,
avec un titre qui lui fait comprendre la solitude de cet homme.
Le titre : "Comment se faire des amis?". Modiano n'est
pas dans la rancoeur, il éprouve l'envie vitale de dire
cette enfance en noir et blanc vécue avec le sentiment
d'être transparent, la dire pour en finir. Avec cette conclusion,
superbe : "J'avais pris le large avant que le ponton vermoulu
ne s'écroule. Il était temps". >>
La
quête de l'origine, par Olympia Alberti, revue
du crdp de nice.
<<
On a déjà constaté combien Patrick Modiano,
depuis ses premiers romans, était à la recherche
d’une mémoire des traces, de la source, de cette
généalogie de l’histoire familiale qui nous
constitue. « Nous dressions des arbres généalogiques,
mon frère et moi. » Puis le frère meurt, très
jeune, et il y a cette phrase, définitive, qui rejoint
une forme d’absolu, serait-il en creux et en manque : «
A part mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout
ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur. J’écris
ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae,
à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une
vie qui n’était pas la mienne. »
A la fin de Pedigree, quand le père lui dit « j’ai
réuni un conseil de famille », pour annoncer sa décision
de ne plus se sentir responsable de son fils, ce dernier s’interroge
: « quelle famille ? » Tout est là : cette
vie, qui n’était pas la sienne, a collé à
son âme jusqu’à bientôt soixante ans,
au point qu’il faut aujourd’hui « en finir avec
»… Avec l’attention scrupuleuse de ceux qui,
assoiffés de cette absolue présence, qui n’a
cessé de leur manquer – l’amour – ne
cessent de s’accrocher au moindre détail qui donne
du corps aux choses et aux êtres, Patrick Modiano recense
les rencontres, les fréquentations, les amis de son père,
de sa mère, parents par inadvertance, à qui il n’en
veut pas, mais de qui l’indifférence, ou l’incapacité
d’aimer, de l’aimer, l’a fait tant souffrir
– au point que la moindre douceur dans la voix d’une
femme médecin le met au bord des larmes.
Adolescent et jeune adulte confronté au manque d’argent
d’un père affairiste, un peu trafiqueur plus que
trafiquant, d’une mère comédienne de théâtre,
durcie, sèche – « je ne me souviens pas d’un
geste de vraie tendresse ou de protection de sa part » –
et juste deux mots retracent toute sa vie d’écrivain,
à propos d’un tampon d’éther qu’on
lui applique sur le visage, parce qu’il est renversé,
enfant, en traversant la rue, seul : « Mémoire et
oubli ».
Qu’on relise La Place de l’Etoile, Villa triste, Livret
de Famille, Rue des boutiques obscures, Du plus loin de l’oubli,
Dora Bruder – qui retrace la recherche des traces d’une
jeune juive déportée, qui, comme par hasard, est
nommée « Bruder » (frère, en allemand),
tous ces livres forment cette manière de fredonnement de
l’âme en quête d’une certitude, d’une
pierre angulaire, d’une stabilité où trouver
refuge. Les grandes œuvres se bâtissent sur des manques
inconsolables – Flaubert ne dit-il pas qu’il a jetée
« la clef de la chambre royale » ? Peut-être,
avant de commencer, faut-il savoir, justement de manière
très sûre et parfaitement désespérée,
que l’on ne trouvera jamais consolation… et s’adonner
à ce comblement impossible, avec les ressources limitées
mais enthousiasmantes d’ici bas. Il faut sans doute être
devenu enfin « léger », libre de cette vie
qui n’est pas reconnue comme sienne, pour pouvoir en parler,
l’évoquer avec cette lucidité, et écrire
qu’à cette école, où il se retrouve,
avec d’autres, Patrick Modiano est un enfant parmi «
des enfants mal-aimés, des bâtards, des enfants perdus.
» Olympia Alberti,© revue du crdp
de nice
Patrick Modiano s’invente ’un
pedigree’ par
Jean-Claude Lamy, Le Midi Libre, 10 janvier 2005
<< En publiant Un pedigree, Patrick Modiano fournit des éclaircissements
sur les nuits et brouillards de son oeuvre. Il est le narrateur
de sa propre histoire familiale sans l’aborder de biais
par la fiction.
Un des textes essentiels de Georges Simenon est un roman autobiographique
et d’atmosphère liégeoise : Pedigree paru
en 1948. Avec ce livre il donnait les clés des grands
thèmes qui ont alimenté son oeuvre, y compris
la série des Maigret. En publiant Un pedigree, Patrick
Modiano fournit à son tour des éclaircissements
sur les nuits et brouillards de son oeuvre. Mais contrairement à Simenon,
il est le narrateur de sa propre histoire familiale sans l’aborder
de biais par la fiction. C’est aussi une façon
de nous démontrer que ses romans depuis La Place de
l’étoile, publié en 1968, sont tous des
exercices de style à partir de cette grande ambition
qui est de rêver sa vie.
« J’écris ces pages comme on rédige
un constat ou un curriculum vitae, à titre documentaire
et sans doute pour en finir avec une vie qui n’était
pas la mienne. Il ne s’agit que d’une simple pellicule
de faits et gestes. Je n’ai rien à confesser ni à élucider
et je n’éprouve aucun goût pour l’introspection
et les examens de conscience. Au contraire, plus les choses demeuraient
obscures et mystérieuses, plus je leur portais de l’intérêt ».
Modiano qui a toujours eu l’impression d’être
un passager clandestin, se comparant à un chien qui fait
semblant d’avoir un pedigree à cause de parents
aux origines cosmopolites, n’eut, en effet, qu’à reconstituer
le puzzle imaginaire de sa vie à partir de réalités
complexes.
« Je suis né le 30 juillet 1945, à Boulogne-Billancourt,
11 allée Marguerite, d’un juif et d’une Flamande
qui s’étaient connu à Paris sous l’Occupation. » Dès
la première phrase d’Un pedigree, l’auteur
nous met dans une situation d’attente. Des personnages
vont surgir et l’on sait déjà qu’ils
se comporteront de façon mystérieuse. D’abord
la mère de Patrick Modiano qui a passé son enfance
dans un faubourg d’Anvers. Après avoir suivi des
cours d’art dramatique, elle embrassera la carrière
de comédienne, travaillant à Paris pendant la guerre
pour la maison de production Continental, au service du "doublage".
Quant à Albert Modiano, le père de l’écrivain,
il a vu le jour dans la capitale, square Pétrelle, à la
lisière du IXe et du Xe arrondissement. C’était
sa destinée d’être assis entre deux chaises.
« Son père à lui, souligne Modiano, était
originaire de Salonique et appartenait à une famille juive
de Toscane établie dans l’Empire ottoman. Cousins à Londres, à Alexandrie, à Milan, à Budapest.
Quatre cousins de mon père, Carlo, Grazia, Giacomo et
sa femme Mary, seront assassinés par les SS en Italie, à Arona,
sur le lac Majeur, en septembre 1943. » Cet événement
tragique n’est pas sans conséquence sur les hantises
du romancier déclarant : « Moi, mon coeur bat pour
ceux dont on voyait les visages sur l’Affiche rouge. » L’itinéraire
d’Albert Modiano qui échappa à la Gestapo
et a vécu d’expédients dans le monde interlope
du marché noir, ne pouvait qu’exciter l’imagination
d’un fils à la recherche de vérité dans
une période trouble mais également en quête
d’affection.
Car le jeune Patrick a connu l’exil du pensionnaire. Envoyé dans
différents collèges, il se sentait hors circuit.
Dans la peau du garçon mal aimé, il avait l’impression
d’être devenu définitivement un étranger
vis-à-vis d’une mère indifférente
et souvent absente et d’un père marginal qui l’écartait
de son existence en lui donnant des leçons de morale.
D’autre part, la mort prématurée de son frère
Rudy, en 1957, une douleur si profonde sur laquelle il restera
muet, viendra s’ajouter à l’angoisse ambiante
de ces années d’un gris de plomb. Dernière
lettre d’Albert Modiano datée du 9 août 1966. « Ta
mauvaise foi et ton hypocrisie n’ont pas de limites (...)
Ton persiflage est abject. » Patrick Modiano n’a
plus revu son père. Il avait rejoint la liste des fantômes
en train de se métamorphoser en héros incertains
d’une épopée future. >>
Un
pedigree, par Virginie Clément , Le Pélérin, Jeudi 6
janvier 2005
<< Voici trente ans que Modiano fascine ses lecteurs avec sa « petite
musique » empreinte de nostalgie, de souvenirs flous, de
mystères. Dès les premières phrases de ses
romans, on le reconnaît. Une trentaine de romans courts,
qui décryptent la recherche de soi qui obsède Modiano
depuis ses débuts, en 1968. Ses détracteurs lui
reprochent de toujours écrire le même roman. Celui
d’un jeune homme qui erre dans un Paris nocturne, peuplé de
personnages louches, embarqué dans un fourgon cellulaire
en compagnie d’un père aux activités nébuleuses.
L’œuvre crépusculaire de Patrick Modiano serait
donc un vaste puzzle, un labyrinthe infini de motifs récurrents
qui font son estampille, mâtiné des thèmes
qui le hantent : le père absent, la double identité,
la traversée de Paris, le poids de l’enfance, le
tout éclairé par deux époques troubles :
l’Occupation et les années 1950 et 1960, sur fond
de guerre d’Algérie. Alors qu’apprend-on de
plus sur lui dans Un pedigree ? On sait déjà qu’il
est un gourmand de faits divers, qu’il collectionne des
vieux journaux. On sait aussi qu’il n’aime pas les
interviews, qu’il ne finit jamais ses phrases et que ses
apparitions télévisuelles sont souvent ponctuées
d’un silence éloquent. On sait, enfin, que l’écrivain
a reçu le prix Goncourt en 1978 et le Grand prix national
des lettres, en 1996, pour l’ensemble de son travail. Un
pedigree ressemble à s’y méprendre à un
nouveau roman. Sauf qu’ici et là, Modiano nous donne
les clefs de chacun de ses livres « phares ». On
mesure les blessures de l’abandon du père, de la
mort du frère, Rudy, qui marque chaque œuvre au fer
rouge. « J’écris ces pages comme on rédige
un constat », précise Modiano. En refermant ce récit,
le mystère reste entier. Mais n’est-ce pas là tout
le charme et tout le talent de l’un de nos plus grands
romanciers contemporains ? >>
Un
Pedigree Livret
de famille , Le Nouvel Observateur, janvier 2005
<< Où l’on comprend que Patrick Modiano n’est
pas né le 30 juillet 1945 mais en 1968, lorsque son
premier roman a paru
Le
ton est laconique, parfois exténué. Jamais Patrick
Modiano ne hausse le ton, jamais non plus il ne cède à la
nostalgie. Simplement, il met les choses au clair. Une fois pour
toutes. Il n’y reviendra pas. On a tellement interrogé ce
romancier, né en 1945, sur l’origine de ses obsessions
circulaires qu’il lui fallait bien, un jour ou l’autre,
passer aux aveux. «J’écris ces pages, explique-t-il,
comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre
documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui n’était
pas la mienne.»
En 122 pages aussi compactes et méticuleuses qu’un
rapport de police, Patrick Modiano accumule donc les dates, les
faits, les adresses, les preuves. Par un paradoxe troublant,
plus il est précis, plus il est trouble. C’est,
d’une certaine manière, le miracle de la littérature:
si «Un pedigree» contient, page après page,
toutes les clés de l’œuvre romanesque de Modiano,
elles ne sauraient ouvrir la porte vert-de-gris de son imaginaire.
La biographie du sexagénaire est enfin dévoilée,
mais le mystère de l’écrivain demeure. On
le savait déjà, la vérité, c’est
le style.
La figure centrale de cette confession lapidaire est, évidemment,
paternelle. Albert Modiano a vécu du marché noir
pendant l’Occupation, changé plusieurs fois d’identité et,
après la guerre, il est devenu un homme d’affaires
aux activités douteuses. Il n’a cessé d’éloigner
son fils dans des pensions et des collèges de province,
de le repousser pour mieux le malmener, de le traiter comme un
délinquant, un «voyou», et d’exiger
de lui, dans des lettres comminatoires, qu’il fasse de
brillantes études. «Il aurait souhaité que
je sois ingénieur agronome. Il pensait que c’était
un métier d’avenir. S’il attachait tant d’importance
aux études, c’est que lui n’en avait pas fait
et qu’il était un peu comme ces gangsters qui veulent
que leurs filles soient éduquées au pensionnat
par les "frangines".» Plus les années
passent, plus les rapports entre le père et le fils sont
violents. La mère, elle, ne fait que passer. C’est
une comédienne fantôme, détachée de
la réalité, indifférente au sort des siens.
Toujours sans le sou, elle court les cachets et, au théâtre,
les emplois sans gloire. Patrick dit aujourd’hui n’avoir
jamais réussi «à désarmer l’agressivité et
le manque de bienveillance qu’elle [lui] aura toujours
témoignés».
Lorsqu’il atteint enfin sa majorité, Modiano vit
dans la misère. Son père lui coupe les vivres,
sa mère se traîne au mont-de-piété,
quand elle ne vole pas des articles à la Belle Jardinière.
Il a l’impression d’être un passager clandestin,
un fraudeur. Il dérobe des livres chez les particuliers
et dans des bibliothèques afin de s’acheter de quoi
manger. Peut-être aurait-il reproduit le modèle
paternel ou serait-il devenu fou si, dans une chambre de bonne,
il n’avait écrit son premier roman, «la Place
de l’étoile». Modiano sort de l’enfer
et entre en littérature. «Il était temps.» La
véritable existence de l’auteur d’«Un
pedigree» commence à 23 ans.
Du relevé cadastral de son passé – «une
simple pellicule de faits et gestes» –, de la reconstitution
méthodique d’une enfance et d’une adolescence
gâchées, Patrick Modiano ne tire aucune conclusion,
encore moins une morale. Il fait penser à ces témoins
d’un drame ancien qu’on appelle trop tard à la
barre et sur l’impénétrable visage desquels,
malgré les rides et les cheveux blancs, on ne lit ni
rancune ni émotion rétrospective. Une seule phrase
tremblée
lui échappe. Elle est cachée page 44. «A
part mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout
ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur.» En
février 1957, il a en effet perdu son frère avec
lequel, le dimanche précédent, il avait rangé une
collection de timbres. Patrick Modiano a enterré sa
jeunesse, mais jamais il n’a fait le deuil de son double.
Un ange dans la nuit.>>
Un
Pedigree, De
l'envoûtement des voix singulières par
Marie-Stéphane Devaud
<< «
Pedigree : extrait du livre généalogique d’un
animal de race pure ». Telle est la définition donnée
par Le Petit Robert au terme choisi par Patrick Modiano comme
titre pour son autobiographie peu ordinaire, tant on le sent
pressé d’en finir avec ses vingt et une premières
années sur un mode excluant l’introspection propre
au genre, et surtout, ce qui est plus inattendu, la nébulosité si
singulière de sa prose épurée. Même
si Accident nocturne, paru en 2003, aurait dû nous mettre
la puce à l’oreille en mettant en scène un
personnage qui se trouve à un moment charnière
de son existence, à la soixantaine venue, Modiano, ce
maître de l’équivoque, des atmosphères
troubles, entre chien et loup, décide en effet de suspendre
la petite musique ensorcelante, reconnaissable entre toutes,
de ses fictions, pour nous plonger dans le « sable mouvant
[de son enfance], comme on s’efforce de remplir avec des
lettres à moitié effacées une fiche d’état
civil ou un questionnaire administratif ».
Car un pedigree, c’est précisément ce qui
manque à Patrick Modiano. La page d’ouverture est
pour le moins explicite : « Je suis né le 30 juillet
1945, à Boulogne-Billancourt, 11 allée Marguerite,
d’un juif et d’une Flamande qui s’étaient
connus à Paris sous l’Occupation. J’écris
juif, en ignorant ce que le mot signifiait vraiment pour mon
père et parce qu’il était mentionné, à l ‘époque,
sur les cartes d’identité. Les périodes haute
turbulence provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si
bien que je ne me suis jamais senti un fils légitime et
encore moins un héritier. » Et de confirmer en page
13 : « Je suis un chien qui fait semblant d’avoir
un pedigree. Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun
milieu bien défini .» De ce flou identitaire, accentué par
la judéité du père contraint, pendant l’Occupation, à vivre
sous des noms d’emprunt, le petit garçon ne souffre
pas. Au contraire, il attise son intérêt pour les
choses obscures au point de trouver du mystère même à ce
qui en est dépourvu, germe d’écrivain oblige.
Non, si ce travail de mémoire est rédigé avec
la froideur et la concision d’un « constat » ou
d’un « curriculum vitae », cela tient au fait
qu’excepté la mort de son frère Rudy, Modiano,
enfant, a toujours vécu les événements « en
transparence – ce procédé qui consiste à faire
défiler en arrière-plan des paysages, alors que
les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. »
Et de fait, Un Pedigree ressemble à un film sépia
truffé de fantômes louches qui nous fait revisiter
les coulisses glauques de l’Occupation puis de l’après-guerre,
avec pour protagonistes deux « papillons égarés
et inconscients au milieu d’une ville sans regard » – un
juif passé à travers les mailles du filet des rafles
et une actrice de seconde zone – et leur fils, balloté de
pensionnats en collèges quand il n’est pas confié à des
amis, pareil à un chien encombrant que l’on place
en fourrière. Livré à sa solitude âpre
de spectateur, l’adolescent respire dans les livres qui
nourrissent son attrait pour le fantastique des rues jusqu’au
jour où, pour la première fois, en automne 1959,
il « frôle les mystères de Paris » et « commence,
sans bien s’en rendre compte, à rêver sa vraie
vie .» Dès lors, il faudra presque dix ans pour
que l’étincelle devienne flamme et que le jeune
Modiano prenne la tangente « avant que le pont vermoulu
ne s’écroule », et plus de quarante pour qu’il
vienne à bout de ce passé dont ses romans nous
ont si bien caché la dure réalité. (…) >> par
Marie-Stéphane Devaud in le Blog Kritiks, http://kritiks.blogspirit.com/archive/2005/08/15/valeurs-sures.html
PEDIGREE
Une jeunesse... par Annie Coppermann, Les Echos, janvier
2005
« Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pedigree.
Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun
milieu bien défini. Si ballottés, si incertains
que je dois bien m'efforcer de trouver quelques empreintes et
quelques balises dans ce sable mouvant comme on s'efforce de
remplir avec des lettres à moitié effacées
une fiche d'état-civil ou un questionnaire administratif »...
C'est la surprise de ce début d'année littéraire.
Patrick Modiano parle... de lui. Dans un tout petit récit
(122 pages) écrit comme un document administratif, énumérant
lieux, personnes, rencontres, sans jamais les romancer. Mais
où pourtant, dans les interstices, se glisse cette brume
de mystère tremblé, qui, toujours, est la marque
du style, immédiatement reconnaissable, de l'auteur...
Et qui, dans cette confession à la fois sèche et émouvante,
se trouve, étrangement, à la fois dissipée
et comme épaissie...
Car l'on découvre ici que c'est, directement, dans sa
propre jeunesse, et dans celle de ses parents, que le romancier
a puisé l'univers, la matière, la part d'ombre
de ses romans. Ces personnages interlopes, ces hôtels d'où on
déménage sans cesse, ces cafés où l'on
se donne rendez-vous dans l'arrière-salle, ces garages à odeurs
d'essence, ces villas tristes, ces boutiques obscures, le petit
Patrick les a connus, et pas toujours aimés...
Le chien se suicide
Ses parents ? « Deux papillons égarés et
inconscients au milieu d'une ville sans regard ». Une mère
flamande, née à Anvers en 1918. Comédienne,
arrivée en juin 1942 à Paris, où elle est
d'abord employée à la Continental, et devient l'amie
d'un des adjoints de son directeur allemand, Greven. « C'était
une jolie fille au coeur sec. Son fiancé lui avait offert
un chow-chow, mais elle ne s'occupait pas de lui et le confiait à différentes
personnes, comme elle le fera plus tard avec moi. Le chow-chow
s'était suicidé en se jetant par la fenêtre.
Ce chien figure sur deux ou trois photos et je dois avouer qu'il
me touche infiniment et que je me sens très proche de
lui... » Tout est dit sur la carence affective du petit
Patrick ! Un père né en 1912 à Paris, fils
d'un juif de Salonique au passeport espagnol, sans diplômes,
impliqué dès l'adolescence dans de louches trafics,
vivant de marché noir sous de faux noms, « sans
existence légale », pendant la guerre où,
deux fois arrêté, il échappe à la
police et à la Gestapo. Tous deux, qui se sont rencontrés
un soir d'octobre 1942, naviguaient parmi de « drôles
de gens », dans une « drôle d'époque
entre chien et loup ». Un appartement quai Conti (près
de chez Arletty, qui prendra un temps la mère de Patrick
sous sa protection), une voiture, Ford, réquisitionnée
par la Milice et dans laquelle Georges Mandel fut assassiné,
et des proches, hommes et femmes, aux identités changeantes,
Russes, Chiliens, Australiens, une ancienne maîtresse de
Luciano, une danseuse finlandaise, un antiquaire belge, un banquier
italien, un gros Lucien P. amoureux de Simone Simon... « Demi-monde
? Haute pègre ? » « Mais je n'y peux rien,
c'est le terreau - ou le fumier - d'où je suis issu... »
La
confession, chronologique (appuyée sur quelques recherches
et surtout sur les récits de sa mère), se poursuit
avec les souvenirs personnels d'un enfant systématiquement
placé loin de ses parents, chez de vagues relations (à Jouy-en-Josas)
ou dans de stricts pensionnats (à Annecy) d'où,
parfois, il fugue... De rares entrevues, dans des cafés
souvent, avec un père autoritaire, distant, des séjours épisodiques
avec une mère tout occupée de sa carrière
et de ses amis, mais qu'il accompagne parfois dans les coulisses
des théâtres où elle joue et où il
croise, entre autres, Suzy Prim... Presque orphelin, pauvre,
délaissé, il lit, et parfois... vole quelques ouvrages
qu'il revend. Après le lycée, rompant avec les études,
refusant, contre l'avis de son père, de devancer l'appel,
le jeune homme va au cinéma, se promène dans Paris
et, dans une chambre du boulevard Kellermann, ou dans un café,
commence d'écrire un roman. Au printemps 1967, il apprend
qu'il sera édité. C'est « La Place de l'Etoile ».
Patrick Modiano a vingt-deux ans. « La menace qui pesait
sur moi pendant toutes ces années, me contraignant à être
sans cesse sur le qui-vive, s'était dissipée dans
l'air de Paris. J'avais pris le large avant que le ponton vermoulu
ne s'écroule. Il était temps. » C'est le
début de la liberté. Et d'une oeuvre, singulière,
que ce tout petit récit éclaire et rend, encore,
plus attachante. >>
Modiano
avant Modiano par Jean-Paul Enthoven, Le Point
6 janvier 2005
Autobiographie
? Tas de secrets ? Réquisitoire contre
quelques ombres ? Pour la première fois, Patrick Modiano,
romancier du clair-obscur, passe de la fiction à la réalité.
Cela s'appelle « Un pedigree ». Et c'est sublime...
Depuis
longtemps - presque trente livres, déjà...
- Patrick Modiano a vaporisé tant de brouillard sur sa
vraie vie et ajouté tant de fausses pistes à son
vrai passé que ses plus fervents exégètes étaient
en droit de s'interroger : cet écrivain désormais
sexagénaire a-t-il traversé une véritable
existence ? Est-il pétri de souvenirs ou d'illusions ?
A-t-il rêvé sa biographie ou réellement vécu
ses obsessions ? Et sa mémoire, cette usine à bizarre,
se nourrit-elle de fiable ou de flou ? J'étais de ceux
qui, jusque-là, avaient renoncé à en savoir
davantage : Modiano, artiste du vague, n'avait pas intérêt à préciser
les choses ; et son style de brume n'exigeait aucune mise au
point puisqu'il tenait, magiquement, à un don (peu commun)
de la déréalisation.
Or,
contre toute attente, le romancier de « La petite
Bijou » et de « Rue des Boutiques Obscures » revendique
sa part d'aveux. En ce début d'année, il troque
l'indistinct contre l'explicite. Il traque le sfumato au profit
du constat. On a même l'impression qu'un certain Modiano
Patrick, convoqué par erreur dans un commissariat de quartier,
rédige et signe son propre procès-verbal (nom,
prénom, date de naissance...) afin de semer les fantômes
qui l'escortent. Ce n'est pas un roman mais un « état
civil » (façon Drieu la Rochelle). Ou un plan-séquence
couvrant les vingt et une premières années de sa
vraie vie. Pourquoi vingt et une ? On va comprendre. Disons d'abord
que ce chef-d'oeuvre est « Un pedigree » - l'étymologie
suggère d'ailleurs que le mot vient de « pied de
grue » et désigne les pointillés qui, dans
un arbre généalogique, relient l'ancêtre
au rejeton -, qui, par enchantement, propose du Modiano concentré,
de l'élixir modianesque, du jus de passé réduit à son
essence. Aucune métaphore dans ce texte. Rien que des
faits, des dates, des lieux. Et un son de mélancolie obstinée...
Au
fond, Modiano a dû se dire : je vais, pour une fois,
jouer cartes sur table. Et mettre des visages derrière
les masques. Et de vrais noms sur ces visages. Et les convoquer,
tous, « comme on fait l'appel dans une caserne vide ».
L'incipit dece « Pedigree » surprendra alors les
amateurs de fiction : « Je suis né le 30 juillet
1945 [...] d'un juif et d'une Flamande qui s'étaient connus
sous l'Occupation. » Suivent à peine plus de cent
pages qui se concluent sur la seconde naissance duModiano qui, à 21
ans, va publier « La place de l'Etoile » : « J'avais
pris le large avant que le ponton vermoulu ne s'écroule.
Ilétait temps. » Ce récit, c'est donc l'histoire
du juif, de la Flamande, de l'Occupation, du ponton vermoulu
et du jeune homme qui, dans ce décor, va oser faire son
salut en devenant un écrivain. Minimalisme garanti. Devant
chaque page, on pense au Stendhal qui priait son lecteur de rajouter à des
phrases trop laconiques « les quelques mots qui leur manquent »...
Les
premiers rôles, donc : le père ? un Toscan
en provenance de Salonique, avec ses costards défraîchis
et ses officines au parfum de cuir pourri. On apprend que cet
individu naviguait entre la haute pègre et le demi-monde
; qu'il s'enrichit et se ruina dans toutes sortes de trafic sous
l'Occupation ; qu'il était indifférent, humain,
fourbe, délateur, pressé. Ce drôle de type,
toujours entre la Guyane, la Colombie, la Suisse ou les cafés
de la porte d'Orléans, ne savait pas trop quoi faire de
son fils - qui l'observait. La mère ? « Une jolie
fille au coeur sec », actrice très « Dernier
métro », fauchée, captivée par ses
amants de passage - dont Jean Cau, l'ancien secrétaire
de Sartre, auquel le jeune Modiano (qui s'exerce au mentir-vrai)
fait croire qu'il connaît « le fils de Stavisky ».
Dans cette atmosphère louche, on n'en finit pas de croiser
des patronymes - Ismaïloff, Didi, Safirstein, Grundwald,
Morawski... - qui, le jour venu, injecteront leur dose de mystère
dans les romans qui germent. Le petit Patrick encombre ces adultes
; on l'exile dans des pensionnats ; il flotte entre quelques
faits divers - de l'affaire Ben Barka à l'assassinat de
Jean deBroglie - qui, soudain, coagulent une réalité vaporeuse.Tout
cela, dit-il, a été vécu « en transparence » -
par allusion à ce procédé cinématographique
qui consiste à faire défiler des paysages tandis
que les acteurs sont immobiles. Mais, au détour d'une
page, l'essentiel : « A part mon frèreRudy, sa mort,
rien de ce que je rapporte ici ne me concerne en profondeur. » Il
y a ainsi, dans la solitude Modiano,un double à jamais
perdu. On aurait aimé mieux connaître Rudy. De lui
on ne saura seulement que ceci : il classait des timbres, avec
Patrick, un dimanche de février 1957, avant de disparaître...
Maintenant, il écrit à l'os
Le reste ? C'est la lente remontée vers les mots, vers
le roman, vers cette littérature où Modiano va
creuser son domicile fixe et qui peut transfigurer n'importe
quel paquet de boue ambiguë. Des lectures : Jules Verne,
Conan Doyle, puis Hemingway, puis Larbaud, puis Kafka. Des lieux
: rue Fontaine ou de Châteaudun, quai de Conti, un village
de Haute-Savoie, la plaine Monceau. Des émois : un soir, à Pigalle,
tandis que sa mère reçoit dans la coulisse d'un
théâtre, il commence « à rêver
sa vie ». On n'en saura pas davantage. Un ennui implacable
et fécond plane sur cette jeunesse enfuie. C'est un ennui
d'encre. Un gisement de désespérance qui, « avant
que tout ne se perde dans la nuit froide de l'oubli » (prototype
du phrasé modianesque), va irriguer l'oeuvre à venir.
Bientôt, vers ses 20 ans, il s'installera dans la chambre
d'un hôtel de La Garde-Freinet. Il y commencera son premier
livre. Queneau le lit, en rit (ce rire « moitié geyser,
moitié crécelle »), le publie. Modiano peut
enfin exister. Il est sauvé. Est-ce ainsi que les écrivains
naissent ?
Ce « Pedigree » fera date pour les théoriciens
de la littérature qui ne savent pas encore s'il convient
d'être pour ou contre Sainte-Beuve. Ni si l'oeuvre d'un
romancier est une variable indépendante de sa biographie.
Ni si l'on écrit pour montrer, ou pour escamoter, un secret.
Modiano tranche dans le vif - lui-même - et s'extasie devant
le miracle de sa survie. Il lui a fallu quatre dizaines d'années
pour passer de la fiction au réel. Pour dégrader
son imaginaire au rang de curriculum vitae. Maintenant, il écrit à l'os.
Il n'a plus peur. Jusqu'où le mènera ce jeu ? Car,
pour un romancier, fût-il aussi puissant que Modiano, le
goût de la vérité peut devenir le plus redoutable
des pièges. >>
(Un
Pedigree) Boucler la boucle ? par
François
Gandon
« Patrick Modiano est né en 1945 à Boulogne-Billancourt».
Ce condensé d'état civil est quasiment la seule
information biographique donnée par l'auteur sur la jaquette
de ses livres. C'est une petite phrase anodine que ses familiers
connaissent pourtant par cœur. Car dans l'apparente neutralité de
sa concision, elle contient l'essence même de l'œuvre
modianesque. Il y a ce point de départ, ce point d'ancrage
devrait-on dire : une date ; un lieu. Et puis plus grand-chose.
Seulement le doute, ce doute fondateur, ontologique presque,
qui motive la quête inassouvie de l'identité, obsession
récurrente de l'écrivain.
Patrick Modiano,
donc, est né en 1945. On a l'impression
de l'avoir toujours su, au point que l'information avait fini
par perdre sa valeur de repère. A chaque nouveau livre,
elle devenait un peu moins réelle. Et pourtant, cette
année, l'écrivain fêtera ses 61 ans, dont
presque quarante d'une carrière littéraire entamée
avec la Place de l'Etoile.
Un pedigree,
ressemble à une esquisse de bilan. On y
retrouve tous les ingrédients habituels de l'œuvre
- noms, dates, lieux - qui défilent comme dans un théâtre
d'ombres ou en arrière-plan d'un décor de cinéma.
Les brouillards de l'Occupation flottent plus que jamais sur
ce décor. La bande de la rue Lauriston. Les trafics interlopes
et les demi-mondaines. Mais cette fois, on sent une forme d'urgence
et de précipitation que les premiers romans ne contenaient
pas. Patrick Modiano donne l'impression de vouloir se débarrasser
d'un poids, comme si, les années le rattrapant, il craignait
de manquer de temps pour épuiser sa quête de soi.
Alors il évoque, il nomme, il inventorie. Il récapitule. «J'écris
ces pages, avoue-t-il en page 45, comme on rédige un constat
ou un curriculum vitae, à titre documentaire et sans doute
pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne.
Il ne s'agit que d'une simple pellicule de faits et de gestes.».
Dans le fourmillement
cosmopolite de leurs patronymes, et le mystère parfois peu reluisant de leurs origines, on croise
au détour des pages des noms qui résonnent familièrement, évoquant
des souvenirs d'autres livres. Cet acteur japonais au nom soyeux
comme une étoffe : Sessue Hayakawa. La fameuse Galina
Orloff, qui apparaît sous le nom de Gay Orlow dans un précédent
roman. Sylviane Quimfe (Quimphe) - l'amie de Lucien P. - lascive
femme rousse qu'on avait aperçue dans les Boulevards de
ceinture, courant «les seins hors de son décolleté» au
détour des couloirs d'une villa de banlieue. Un pedigree
serait-il alors plus autobiographique que les autres livres parce
que Patrick Modiano y raconte ouvertement les premières
années de Patrick Modiano ? On peut se le demander. Et
se demander d'ailleurs si la question elle-même vaut seulement
d'être posée. Aucun livre de Modiano ne l'est vraiment.
Tous, par le collage subtil de souvenirs vécus ou inventés,
fabriquent la nostalgie d'une enfance, une jeunesse mi-figue
mi-raisin qui devient au moins aussi réelle que la vraie.
«Je
suis un chien qui fait semblant d'avoir un pedigree»,
reconnaît d'ailleurs l'écrivain. Faire semblant.
Se rattacher aux apparences ou aux inventions qui permettent
de donner un peu de sens à la vie. Il y a plus de trente
ans déjà, en préambule à ses Boulevards
de ceinture, il croyait bon de prévenir : «Les personnages
et les situations contenus dans ce livre n'ont aucun rapport
avec la réalité». Alors, pour la énième
fois, on finira par laisser l'analyse de côté pour
se laisser bercer par une musique nostalgique au pouvoir unique.
On s'attardera sur sa seule et profonde concession à l'intime,
cette émouvante confession au détour d'une page
: «A part mon frère Rudy, sa mort, je crois que
rien de ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur.» Et
l'on se délectera d'un Modiano passé maître
dans l'art de la chute. Ou comment faire se refermer un livre
en plongeant le lecteur dans une rêverie mélancolique
: «Ce soir-là, je m'étais senti léger
pour la première fois de ma vie. La menace qui pesait
sur moi pendant toutes ces années, me contraignant à être
sans cesse sur le qui-vive, s'était dissipée dans
l'air de Paris. J'avais pris le large avant que le ponton vermoulu
ne s'écroule. Il était temps.» François
Gandon, Parutions.coml
( Mis en ligne le 12/05/2006
(Un
Pedigree) Modiano, autoportrait en chien perdu par
Isabelle Martin, Samedi 15 janvier 2005
<< C'est la littérature qui a, sans aucun doute,
sauvé le
jeune paumé qu'était l'écrivain à vingt
ans. Dans l'espace de constat apparemment dépourvu d'émotion
qu'est «Un Pedigree», il décrit le vide de
son enfance et de son adolescence.
Guérit-on jamais d'une enfance négligée et
d'une adolescence solitaire? Patrick Modiano a beau y avoir fait
déjà de nombreuses allusions dans ses livres jusque
dans le plus explicite, Remise de peine (1988), il y revient encore
dans Un Pedigree comme à la source même de son écriture.
C'est ainsi qu'il faut comprendre l'espèce de constat, apparemment
dépourvu d'émotion, qu'il dresse de ses débuts
dans la vie, jusqu'à ses 21 ans. La majorité sera
pour lui une double délivrance, en le libérant de
la tutelle paternelle et en lui offrant une nouvelle naissance
grâce à l'acceptation par Gallimard du manuscrit de
son premier roman, La Place de l'étoile.
Pedigree, titre à la Simenon (auteur que le jeune Modiano
a beaucoup lu avec Proust, Hemingway, Fitzgerald et bien d'autres),
renvoie à la généalogie d'un chien de race.
L'article indéfini qui le banalise fait penser à ce
fichier central auquel rêve un personnage de Livret de
famille, où tous les chiens seraient répertoriés à leur
naissance. Si l'écrivain fait ici «semblant d'avoir
un pedigree», c'est pour «trouver quelques empreintes
et quelques balises» dans le sable mouvant de son passé familial.
Quant à être un chien, pourquoi pas? Comme celui
que sa mère, «jolie fille au cœur sec»,
négligeait et qui s'est jeté par la fenêtre: «Ce
chien figure sur deux ou trois photos et je dois avouer qu'il
me touche infiniment et que je me sens très proche de
lui.» Presque à la fin du livre, Modiano réunit
dans l'amour des chiens son frère Rudy (sa seule vraie
famille) et son maître Raymond Queneau.
Venue d'Anvers à Paris pour travailler dans la compagnie
de cinéma allemande Continental, sa mère rencontre
son père un soir d'octobre 1942. Né d'un père
juif toscan établi à Salonique puis au Venezuela
et enfin à Paris, Albert Modiano est livré à lui-même
dès son adolescence et vit de petits trafics. Pris dans
une rafle, il s'échappe grâce à une panne
de minuterie et mène ensuite une existence semi-clandestine,
même après la guerre. D'où l'immense effort
de mémoire de son fils pour établir, sinon sa généalogie,
du moins des vestiges de celle-ci en citant des noms de lieux
et surtout de nombreuses personnes, plus ou moins louches, qui
apparaissent comme autant de fantômes d'un passé incertain.
Très vite, ses parents se séparent tout en continuant
d'habiter à la même adresse, au 15, quai de Conti.
Une mère en tournée, un père qui se désintéresse
d'eux: Patrick et son petit frère Rudy sont mis en pension à Biarritz,
où ils sont baptisés tardivement en l'absence de
leurs parents, puis à Jouy-en-Josas. En 1957, Rudy meurt
et ce deuil poursuit l'écrivain qui lui dédiera
ses huit premiers livres. Quand son père, remarié avec
une fausse Mylène Demongeot qui le déteste, fait
démolir l'escalier intérieur reliant les deux étages
de l'appartement du quai de Conti, Patrick retrouve dans les
gravats leurs livres d'enfants et des cartes postales adressées à Rudy
depuis le sinistre internat d'Annecy où son père
l'a exilé.
S'il
ne dit rien des blessures affectives que lui a infligées
sa mère, Modiano ne peut oublier le mutisme (à «décourager
dix juges d'instruction») ni la dureté de son père,
qui l'a dénoncé comme voyou à la police
et a voulu se débarrasser de lui en le faisant incorporer
dans l'armée contre son gré. Pourquoi redire tout
cela, près de trente ans après la mort d'Alberto
Modiano, volatilisé en Suisse au moment où paraissait
son premier livre? L'écrivain, qui aura 60 ans en juillet
prochain, ne renie pas ce passé délétère
dont il est issu: c'est sur «ce terreau – ou ce fumier» – qu'il
a fait pousser tant de fleurs fraternelles, à l'image
de Dora Bruder (récemment réédité en
poche dans La Bibliothèque de Gallimard, avec une lecture
de Bruno Doucey). Comme pour combler un vide par la fiction,
donner une sépulture et un nom à d'autres que lui.>> par
Isabelle Martin, Le Temps,15 janvier 2005
Un
Pedigree : le mystère Modiano, par
Louis-Bernard Robitaille
<< À
60 ans, l'«anachorète» de Saint-Germain-des-Prés
raconte son enfance et ses parents dans un récit de 122
pages. Ironie, sécheresse et détachement: un chef
d'œuvre!
Depuis trois ou quatre décennies, Patrick Modiano a un
fan club fidèle, pour ne pas dire des sectateurs, qui
n'en finissent pas de s'extasier sur l'atmosphère indéfinissable,
vénéneuse et ambiguë, qui se dégage
de ses livres. C'est un écrivain «grand public» et à grand
tirage, mais que l'intelligentsia parisienne ne parvient pas à traiter
de haut: car il y a indéniablement un style Modiano. Et, à travers
ce style allusif, tout en faux-fuyant et en clair-obscur, dans
ces récits peuplés d'agents doubles, d'escrocs
et de fantômes, un irréfutable fond de vérité.
À près de 60 ans, qu'il aura en juillet prochain,
Modiano le personnage est en quelque sorte la preuve ambulante
de l'authenticité de son œuvre. Et ce minuscule récit
autobiographique de son enfance tout juste publié, Un
Pedigree, en est pour ainsi dire le constat. Précisons
tout de suite que c'est un véritable bijou, écrit
comme on ferait une déposition à la police: «Je
suis né le 30 juillet 1945, à Boulogne-Billancourt,
11 allée Marguerite d'un juif et d'une Flamande qui s'étaient
connus à Paris sous l'Occupation.» Et un peu plus
loin: «Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pedigree.»
Ainsi que l'écrit Libération, ce Pedigree est
comme «un viatique» permettant de faire ou de refaire
le voyage à travers l'œuvre de Modiano. Parents plus
qu'incertains, eux-mêmes sortant de cette période
incertaine des années 40-44 à Paris: «La
nuit de l'Occupation, c'est la nuit originelle dont je suis sorti»,
a-t-il déjà expliqué.
Au milieu de cette nuit, son père, né à Paris
dans une famille juive de Salonique, de lointaine origine toscane:
il change de nom, de papiers, de domicile, frôle l'arrestation,
s'en tire. Il a l'air de se livrer à de mystérieux
trafics, ou à des commerces douteux, dont on ne connaîtra
jamais le fin mot. Sa mère, artiste de théâtre
et de music-hall à la carrière modeste et en dent
de scie: «C'était une jolie fille au cœur sec.
Son fiancé lui avait offert un chow-chow mais elle ne
s'occupait pas de lui et le confiait à différentes
personnes, comme elle le fera plus tard avec lui. Le chow-chow
s'était suicidé en se jetant par la fenêtre.»
Modiano raconte une enfance grise et incertaine,
qui se passe entre les querelles et le divorce des parents,
quelques déménagements,
les allées et venues d'un père qui paraît
toujours à l'affût d'un coup d'argent et qui est
toujours à court d'argent, les crises et les fantaisies
d'une mère en quête de travail ou d'un fiancé.
Les deux se mettent d'accord pour le placer pendant des années
dans des pensionnats-prisons.
Sans doute Patrick Modiano, beau jeune homme
très grand
et longiligne plaisant énormément aux dames, avait-il également
ce grain de bizarrerie qui a fait la différence: car après
tout, d'autres que lui ont été mis dans d'horribles
pensions et ont eu des parents volages et divorcés. Ceux-là sont
devenus des adultes bien normaux et banals. Modiano, lui, est
resté un authentique bizarre.
Pour la sortie de ce dernier opuscule, le brillant
scénariste
de Lacombe Lucien et de Bon Voyage (de Rappeneau) a décidé de
suivre jusqu'au bout sa pente naturelle: plus une seule interview,
pas le moindre quart de rendez-vous avec des journalistes ou
quelque professionnel que ce soit du milieu littéraire. «C'est
peut-être mieux comme ça, dit Hélène
de Saint-Hippolyte, chef du service de presse chez Gallimard.
Pour ses livres précédents, on parvenait de temps à autre à lui
arracher un rendez-vous ici ou là. Le plus souvent, il
annulait à la dernière minute, ou alors il y allait,
mais c'était une vraie torture, pour lui et pour le journaliste
d'ailleurs.» Beaucoup se souviennent des rares et angoissantes
prestations de Modiano chez Bernard Pivot, où les phrases, à peine
commencées, butaient aussitôt sur des mots qui devenaient
des onomatopées progressivement inaudibles. «Je
pourrais essayer de vous arranger un rendez-vous avec lui, m'avait
dit il y a quelques années un autre attaché de
presse, mais je vous le déconseille: son malaise est communicatif,
et très dérangeant.»
Par le plus grand des hasards, l'écrivain et journaliste
Pierre Assouline avait un temps fréquenté le romancier
muet: «En fait, je lui avais demandé par courrier
un renseignement sur Emmanuel Berl et je n'avais jamais eu de
réponse. Un an et demi plus tard, je le retrouve sur le
plateau d'Apostrophes, et il me dit, mais justement, j'ai le
renseignement que vous avez demandé. On a sympathisé,
on s'est revus, et on a même pris des vacances familiales,
un été, à Évian. C'était il
y a près de 20 ans. Mais son côté solitaire
s'est aggravé. Il fallait, pour le voir, non pas téléphoner,
mais envoyer un fax pour lequel on n'avait pas de réponse.
J'ai fini par lui dire: tu me téléphones quand
tu veux me voir. Modiano vit toujours rue Bonaparte, près
du Luxembourg, avec femme et enfants. Il va dans les bibliothèques,
lit, ne voit personne. Et personne ne l'embête: c'est la
preuve qu'on peut vivre comme un anachorète en plein Saint-Germain-des-Prés. »
Chez
Gallimard, il arrive qu'on lui parle au téléphone, à l'occasion
d'une sortie. Il termine toujours en disant: «On se voit
la semaine prochaine?» Simple formule de politesse jamais
suivie des faits. Mais chez Gallimard, au rayon des bizarres,
on a beaucoup plus fort en magasin: un certain Réjean
Ducharme, à qui son éditeur Roger Grenier n'a jamais
parlé, fût-ce au téléphone. En comparaison,
Patrick Modiano n'est qu'un éternel jeune homme juste
un peu timide.>> Louis-Bernard Robitaille,cyberpresse.ca,
16 déc
2005
Un
Pedigree de Patrick Modiano (anonyme)
<<
Patrick Modiano revient
sur sa jeunesse confuse dans un récit
autobiographique. Chef-d’œuvre d’épure
et de distance, Un pedigree est le constat clinique d’un écrivain
face à la vie qui a cessé d’être sienne,
quarante ans plus tôt.
Ecrivain de l’errance, de l’égarement, de
la quête de l’identité, Modiano n’avait
jamais évoqué sa jeunesse. Sur ses débuts
de romancier, son mariage, dont Raymond Queneau fut le témoin,
la naissance de son premier enfant, il avait rédigé un
irréprochable Livret de famille. Les années antérieures
demeuraient dans l’ombre. Seule se devinait en creux, dans
une suite de romans singuliers, obsédants, cette période
opaque de l’enfance où se sont succédés
des lieux, des événements, des portraits en décomposition.
Car qui fut-il au juste, ce narrateur arpentant sans relâche
sa mémoire, comme une rue aux boutiques obscures où l’on
trébuche à chaque souvenir, et dont on cherche à s’extraire
comme d’une impasse, du fond de l’amnésie
? Longtemps, l’écrivain a préféré à l’exactitude
des noms les pseudos improbables, les enseignes floues. Avec
Un pedigree, les figures s’ancrent dans la réalité,
se gravent sur les murs, deviennent un temps repères,
pour mieux retourner à l’oubli. Dans l’intervalle,
plaques et patronymes auront suffi à l’auteur pour
cerner son objet, en désigner la réalité jusqu’alors
innommable.
Né en août 1945 à Boulogne-Billancourt, Patrick
Modiano fut négligé par ses parents dès
ses premières années. Son père, Albert,
personnage effacé, énigmatique, avare de tendresse
et d’argent, mène ses affaires dans le plus grand
secret. Sa mère comédienne d’origine flamande,
abonnée aux petits rôles sans avenir, brille essentiellement
par son absence et le désintérêt que lui
inspirent ses rejetons. Patrick et son frère Rudy seront
refourgués dès que l’occasion s’en
présentera, à des relations douteuses, à des
pensions austères aux senteurs d’orphelinats. De
cette ascendance de prête-nom, de cette parenté usurpée,
presque malhonnête, Modiano narre la résurgence.
Son constat, semblable à un curriculum vitae, comme il
le stipule lui-même, laisse poindre de l’enfance
les résidus infimes et les menus détails, enfin
parvenus à la maturité du dicible - ou à sa
saturation.
Méthodiquement, le narrateur d’Un pedigree rapporte
les faits, décline les identités. De leur passé sous
l’Occupation, où Albert Modiano, juif originaire
de Toscane, travaillait sous une double identité dans
le marché noir, fuyant au gré des rafles et des
dénonciations, ses parents ont conservé quelques
relations louches, inquiétantes. Fantômes de la
grande époque où escrocs en costumes rayés,
amateurs de petits trafics et déclassés en tout
genre se croisaient Quai de Conti, dans leur appartement. Patrick
n’y fut jamais plus qu’un visiteur : ses années
de scolarité sont partagées entre l’internat
de Jouy-en-Josas et le collège Saint-Joseph de Thônes,
vacances comprises. Quelques fugues viendront rompre ce quotidien
de pensionnaire délaissé : échappées
belles à Paris, plongées dans les livres, évasions
des premières amours.
La vie familiale - ou prétendument telle -, n’est
qu’une succession de convocations fallacieuses, de renvois
autoritaires, de rendez-vous manqués. Ceux d’un
père ne recevant jamais son propre fils à domicile,
toujours dans des cafés, pour de violentes mises en demeure,
des sommations de départ immédiat, au nom des études,
ne serait-ce que pour l’internat situé au bout de
la rue. Autant de réminiscences exposées avec la
froideur et la distance qu’inspire à l’adulte
le sentiment du révolu. Patrick enfant n’est plus
qu’un double disparu dont Modiano tente de se souvenir,
de parachever le deuil. L’exercice est pénible et
le ton, monotone, semble parfois à la limite de l’épuisement.
Sous son allure de procès verbal, dénué d’émotion
et de nostalgie - à l’exception des passages évoquant
la mort soudaine de Rudy, toujours dans l’indifférence
parentale -, Un pedigree est l’œuvre d’un labeur
intime, sensible, éreintant. L’universelle et talentueuse
tentative d’un homme sondant la pénombre, en mal
de lumière.>> (anonyme)
11 mai 2005, site Culturofil,
Un
Pedigree Patrick Modiano ôte
le masque par Anna Bitton
Voilà presque quarante ans que Patrick Modiano traque, à travers
ses romans, les spectres des années noires. Dans Un pedigree,
publié en janvier, il a pour la première fois dévidé son
curriculum vitae. Pour L’Histoire exclusivement, l’écrivain
a accepté d’en parler. Portrait exceptionnel.
La longue porte de bois s’ouvre lentement. L’homme
se cache derrière, immense silhouette hésitante
(1,98 m) qui se recroqueville comme pour ne pas être cinglée
par les vents de la vie. Patrick Modiano. Le voici, enfin, en
chair et en os, en maturité, en maladresse, en paroles,
aussi, cet écrivain si secret. « Qui es-tu, toi,
voyeur d’ombres ? » se retient-on de l’apostropher
en empruntant les mots de Dylan Thomas que Modiano a lui-même
placés en épigraphe à Villa triste, son
quatrième roman, paru en 1975. Trente ans et presque autant
de livres plus tard, le romancier de la NRF célèbre
pour ses circonvolutions vespérales parmi les spectres
de l’Occupation tente de répondre. « M. le
Modi » vient de « déposer » sa vie,
au sens policier, dans son dernier ouvrage, Un pedigree. Pour
la première fois, son « je » n’est pas
un autre. Parce qu’il juge trop « débraillée » l’autobiographie,
la sienne a la sobriété cruelle d’un relevé cadastral
et patronymique de 122 pages. Sans pathos, sans introspection,
sans complaisance. De-ci, de-là, la prose est entrecoupée
de précipités poignants, où pointe une pitié,
où s’esquisse une tendresse.
Certes, le livre ne révèle rien de sa vie qui n’ait
précédemment été éparpillé,
romancé. Mais il en donne les clés. Et si d’ordinaire
ce romancier qui déteste autant être interprété que
jouer les exégètes de son œuvre se forçait à donner
quelques interviews, cette fois, rien. Une exception, une seule,
pour L’Histoire, que l’écrivain a reçu
chez lui, dans le VIe arrondissement de Paris.
«
Ce livre restitue quelque chose comme une ligne mélodique.
En parler, c’est briser la ligne », nous confie-t-il
pour justifier ce silence médiatique, comme s’il
commentait une prose qui lui serait étrangère.
Le grand homme ébauche un sourire, puis un autre. Il rit,
même. Se prend au « je ». Et parle !
É
videmment, les phrases s’interrompent, les mains forment
des entrelacs tortueux, le sourcil se soulève d’un
air désolé : « C’est difficile à dire… » Pour
peu qu’on le laisse errer dans ses silences, la parole
se délie. On comprend mieux pourquoi sa femme, Dominique,
pourfend la légende qui voudrait que son époux
fût bègue : « Il recherche toujours la pensée
la plus précise, comme un type qui ajuste sans arrêt
un microscope. »
Mais plus l’écrivain parle de lui, moins il en dit.
Est-ce si différent quand il écrit ? « Dans
Un pedigree, affirme-t-il, l’épure permet de créer
un sentiment de non-dit, de blanc. Pour donner cette impression
d’absence, que j’ai tellement connue. » Ce
manque de mots, d’amour, sourd dans le procès-verbal
que Patrick Modiano dresse de ses vingt et une premières
années, vécues « en transparence » jusqu’à l’écriture
de La Place de l’Étoile, son premier livre, sa deuxième
naissance.
Dès la parution, en 1968, de ce pamphlet fantasmatique,
très vite couronné de prix, Patrick Modiano polarise
ses obsessions sur sa « préhistoire », la
période qui précède sa naissance, le 30
juillet 1945 à Boulogne-Billancourt : l’Occupation.
Il n’a jamais écrit « Vichy ». On se
demande même si ce n’est pas lui qui a commencé de
mettre un O majuscule. « Les lumières crépusculaires
de cette époque sont pour moi ce que devait être
la Gironde pour Mauriac ou la Normandie pour La Varende : c’est
de là que je suis issu. »
La langue lui permet « d’être bien sûr
de sa nationalité »
Le jeune Modiano, beau comme un dieu diaphane
et mélancolique,
ne se reconnaît pas dans la génération de
ses pairs soixante-huitards. Il se voit, sinon en étranger,
du moins en « Français de hasard ». Un hasard
qui n’eût jamais été, pense-t-il, sans
l’Occupation : la rencontre d’Albert Modiano, un
affairiste juif opérant pour des officines affiliées à la
Gestapo, contraint à la clandestinité, avec une
jeune première flamande, Louisa Colpeyn, réfugiée à Paris.
Le fruit de cette union a priori « inconcevable » sera
l’écrivain de cette souillure originelle, matricielle.
Moitié juif moitié flamand, il est baptisé.
La loi talmudique ne le fait pas juif, mais juif il est aux yeux
des antisémites. Il est l’écrivain étoilé.
Celui qui, si on lui demandait, comme au jeune homme de son premier
roman, où se trouvait la place de l’Étoile,
pourrait encore hésiter à montrer le côté gauche
de sa poitrine. Celui qui écrit pour savoir où elle
est, son étoile. Dans un français classique. La
langue est son ancrage, son amarre, qui lui permet « d’être
bien sûr de sa nationalité ».
Déraciné. Ainsi se vit l’écrivain.
De tradition, il n’a point. De famille, pas davantage.
Le père a cherché à expédier son
fils le plus loin possible, chez des amis, dans des pensionnats,
puis il a disparu de sa vie en 1966, après avoir tenté de
l’enrôler de force dans l’armée. Il
meurt sans que Patrick ne l’ait revu, en 1977, un an avant
la parution de Rue des boutiques obscures, le premier livre dédicacé au
père, l’année du Goncourt, aussi. Entre-temps,
Modiano fils lui a écrit. En vain. Il l’a cherché des
heures durant à la Salpêtrière. En vain.
Il ne cherchera pas sa mère. Elle n’a jamais été là.
Il la sait vivante, mais « ce n’est pas quelqu’un
de gentil. » On aimerait en savoir plus. Il ne trouve pas
les mots.
Des décennies, un mariage et deux superbes filles n’y
ont rien fait, la douleur de Patrick Modiano est encore à vif
: « Je n’ai jamais été un fils »,
assène-t-il dans Accident nocturne. La vie ne lui a pas
donné le loisir d’être un frère longtemps.
Rudy, son cadet de deux ans, est mort en 1957. La seule chose
qui, certifie-t-il, le « concerne en profondeur ».
Une culpabilité sourde vis-à-vis
du passé
Il n’en parle quasiment jamais, « pour ne pas le
trahir » ; les années de plomb, en revanche, il
les hante et les arpente. Passé les romans de jeunesse,
il traque le mystère de ses origines dans un style de
plus en plus dépouillé. Les arrestations du père
font figure de scènes centrales, presque primitives, de
l’œuvre. Albert Modiano fut raflé un soir de
février 1942 dans un restaurant, il s’échappa
en profitant d’une minuterie éteinte. Dénoncé par « quelqu’un »,
il fut arrêté une deuxième fois, en 1943,
puis libéré par « quelqu’un ».
L’écrivain assure aujourd’hui qu’« il
y eut six ou sept arrestations ». Il n’a de cesse, à force
de spéculations, d’enquête, de poursuivre
ce père fantomatique qui incarne l’Occupation.
«
Comme s’il voulait reprendre à son compte un passé trouble
d’où il tire ses origines » (Les Boulevards
de ceinture). Un passé vis-à-vis duquel il éprouve
une culpabilité sourde. Comme s’il avait participé à un
crime « en qualité de complice ou de témoin,
je ne pourrais pas vraiment le dire ». Parce que le roman
familial croise l’histoire nationale, la quête du
père est une quête de l’histoire de la France
des années 1940. Patrick Modiano écrit l’histoire,
la sienne, au passé décomposé, puis recomposé.
Il se recompose un passé antérieur, un passé intérieur.
Il n’est pas historien, mais fut « une des lanternes » d’un
des spécialistes de la période, Henry Rousso, qui
assure que, s’il n’avait pas lu Patrick Modiano,
il n’aurait pas diagnostiqué « le syndrome
de Vichy ».
Maniaque de la recension, Patrick Modiano est un romancier qui
a du détail, notamment topographique, un soin policier.
Un sourcier de l’Occupation qui possède une connaissance
stupéfiante de la « petite histoire » des
faits et méfaits des acteurs de la collaboration. Après
le choc qu’a constitué pour lui, en 1978, le Mémorial
de Serge Klarsfeld, il est parti sur les traces de victimes anonymes
auxquelles il donne, sous sa plume, une sépulture digne,
comme la jeune Dora Bruder. Il découvre l’avis de
recherche en 1988. Le livre éponyme, majeur et inclassable,
paraît en 1997. Entre-temps, neuf ans de quête, de
fichiers administratifs, comme un historien, tandis que s’élabore, à l’échelle
nationale, le concept de « devoir de mémoire »,
dont il fut l’un des promoteurs avant la lettre. Chez Patrick
Modiano, toutefois, comme l’explique Henry Rousso, « l’Occupation
a perdu tout statut historique ». Elle est mythique. L’intéressé s’en
est expliqué : « La condition humaine est condensée
dans des périodes comme celle-là. Le point de vue
métaphysique me trouble plus que le point de vue historique. »
Si le cinéphile qui n’a pas fait d’études,
l’angoissé qui redoute la psychanalyse a réussi à devenir
un grand écrivain français bardé d’honneurs,
s’il est aimé des Français, donc, c’est
précisément parce qu’il restitue au pays
son malaise, son trou noir, son « syndrome de Vichy ».
Mieux, il l’incarne. Étranger à sa beauté,
il n’est pas plus sensuel qu’épicurien. « Un écrivain
est quelqu’un qui n’existe pas », proclamait-il
en 1978 (Elle du 23 octobre.) A force d’être floutée,
l’image prend la forme qu’on lui donne. « Méfiez-vous,
vous devenez le reflet de ce qu’on voudrait que vous soyez »,
lui a un jour lancé Philippe Sollers sur le plateau d’« Apostrophes ».
Avec Un pedigree, Patrick Modiano s’est confronté à l’original.
Voilà longtemps qu’à chaque roman il prétendait
espérer que c’était le dernier de la série, « pour
solde de tout compte », qu’il allait, enfin, pouvoir
commencer une autre vie, la sienne. Un pedigree pourrait signer
cette troisième naissance, après la naissance civile,
en 1945, et la naissance littéraire, en 1968. Après
quarante ans passés à se construire une identité avec
celles des autres, peut-être l’écrivain est-il
revenu du voyage au bout de ses nuits. A soixante ans, il serait
temps. De ne plus ressembler à un vieux jeune homme dont
les gens, mi-fascinés, mi-compatissants, parlent comme
d’un « garçon ». Patrick Modiano est
un monsieur. Et il aime rire. Puisse-t-il s’en convaincre
tout à fait. Anna Bitton, in
Histoire-Presse, n° 299.
Modiano
sur les traces de Patrick, par Bernard Pivot, Journal du Dimanche,
(02 janvier 2005)
<<
Flamande, la mère de Patrick Modiano, est arrivée à Paris,
en juin 1942, dans les bagages des Allemands. Elle espérait
que le cinéma lui offrirait de beaux rôles. Toute
sa vie, elle ne sera qu'une comédienne de complément,
principalement au théâtre. « C'est une jolie
fille au cœur sec », écrit son fils, soixante
ans plus tard. Elle ne s'est pas plus occupée de lui que
de son chow-chow, offert par son fiancé de l'époque.
Le chien s'est suicidé en se jetant par la fenêtre.
N'espérons pas de Patrick Modiano qu'il nous dise s'il
fut tenté par la même extrémité. On
va voir qu'il y avait de quoi. Il se contente d'écrire
qu'il se sent très proche du chow-chow et qu'il est très
touché de le voir sur des photos.
Juif
né à Paris, le père de Patrick Modiano
vivait déjà d'expédients et de trafics quand
la guerre a éclaté. Il a continué dans le
marché noir. Sous un autre nom pour cacher ses origines à l'occupant
nazi. Arrêté deux fois, deux fois il a recouvré la
liberté, d'abord par l'évasion, ensuite grâce à une
protection de choix. Il était habile et il avait de la
chance. Sans pour autant jamais parvenir à décrocher
l'eldorado. A la Libération, la police l'a recherché,
non plus pour ses opinions, mais pour ses activités. Patrick
Modiano a dû être conçu pendant cette nouvelle
période de camouflage. Il est né le 30 juillet
1945, à Boulogne-Billancourt.
Les
lecteurs de Modiano, fascinés par ses romans qui
sont autant de plongées dans un passé trouble et
jamais totalement déchiffrable, se posent tous et toujours
la même question : pourquoi ces personnages louches, ces
intermittents de l'Histoire, ces victimes dont on perd la trace,
ces enquêtes sur des destins bizarres, ces filatures dans
les rues de Paris, ces voyages d'incertitude et d'oubli, ces
feuilletons qui tournent court ? Pourquoi l'amour comme une énigme
dans le mystère général ?
Bien
des réponses sont dans ce petit livre, Un pedigree.
Modiano y raconte ses vingt et une premières années.
Dans un livre portant presque le même titre, Georges Simenon
relatait son enfance jusqu'à l'âge de 16 ans mais,
pour décourager les chicaneurs, il avait rangé son
Pedigree parmi ses romans. Rien de tel avec le Pedigree de Patrick
Modiano, dont le caractère autobiographique est revendiqué.
Quels fantômes, porteurs des noms des amants, maîtresses,
amis, clients, rencontres, etc, de ses géniteurs, viendraient
le poursuivre en justice ? D'ailleurs, quelque-fois, rarement,
il ne donne que la première lettre du nom. La seconde épouse
de son père, il l'appelle « la fausse Mylène
Demongeot ». Elle hait Patrick et pousse son père à se
débarrasser de lui. Souvent, il fait précéder
le nom d'un comparse de l'adjectif « certain », qui
exprime l'étrangeté ou le dédain. Un certain
Moranski, une certaine Suzy Prim...
Car
on retrouve l'enquêteur professionnel Patrick Modiano,
celui qui interroge les registres, les archives, qui fouille
les journaux, qui questionne l'air du temps. Sauf que, pour ce
livre-ci, c'est sans nostalgie, sans regret. Mais non sans émotion,
même s'il la cache derrière des phrases rapides,
sèches. La mémoire ne lui restitue qu'une enfance
solitaire, blessée, privée d'attention, plus encore
d'amour. Sa mère l'ignore, son père l'expédie
le plus loin possible. Mais qui étaient donc cette femme
dure, coléreuse, toujours dans la dèche, et cet
homme « qui aurait découragé dix juges d'instruction » et
qui veut toujours l'enfermer dans des pensionnats, au commissariat
de police, à l'armée ? Ce n'est pas l'écrivain
qui mène ici l'enquête, mais le fils, le rejeté,
le banni. Il ne leur en veut pas. Il s'efforce de les comprendre.
On
découvre un Patrick Modiano insoupçonné.
Qui, pour les revendre, vole des livres rares dans des bibliothèques
ou chez des particuliers. Qui, à 15 ans, plaque ses camarades
en stage d'anglais à Bornemouth pour fuguer à Londres.
Qui fait le mur d'un collège parce qu'il est amoureux « d'une
certaine Kiki Daragane ». Qui, rebelle, fuit le lycée
de Bordeaux où son père, une nouvelle fois, a voulu
l'exiler.
Il
y avait matière à écrire un gros livre
de souvenirs. Tout autre que Modiano se serait étendu
avec complaisance sur une jeunesse triste, ballottée ;
aurait écrit des morceaux de bravoure sur les querelles
et scandales de personnages toujours en sursis, dans une « drôle
d'époque entre chien et loup » ; aurait rempli avec
efficacité les trous de la mémoire et de l'enquête.
Modiano, lui, se contente de dire le plus simplement possible
ce dont il se souvient et ce qu'il a découvert après
recherches. Pas de fioritures ou de digressions. Pas de commentaires,
par exemple, sur ses lectures. La liste des ouvrages qu'il a
lus à tel ou tel âge, c'est tout.
De
ce livre-constat, de cette relation implacable, d'où toute
littérature est exclue, mais dont toute la littérature
de Modiano s'est inspirée, ¬ livre capital, donc ¬ émane
un charme étrange, délictueux. La musique de jazz
des films des années cinquante et soixante. C'est noir,
c'est tendu, c'est risqué.
Mais, à 21
ans, Patrick Modiano écrit La Place
de l'Etoile. Il avait eu l'impression jusqu'alors de vivre la
vie d'un autre. Il chasse enfin son passager clandestin. L'écriture
lui procure une autre identité. Il devient le Modiano
dont nous aimons lire les livres depuis bientôt quarante
ans.>> Patrick Pivot © Journal du dimanche.
Modiano,
l'homme sans pedigree, par Georges Guitton
Sa vraie vie commence à 21 ans, après l'enfance
et l'adolescence racontées dans ce livre, quand il se met
à écrire son premier roman
Récit.
Dans un livre autobiographique, le romancier évoque
son enfance et son adolescence.
« Je suis né le 30 juillet 1945 à Boulogne-Billancourt,
11, allée Marguerite, d'un juif et d'une Flamande qui s'étaient
connu à Paris sous l'Occupation. » Dans Un pedigree,
Modiano, l'homme aux vingt romans, raconte sa vie pour la première
fois. Depuis La place de l'Étoile en passant par La rue
des boutiques obscures, le romancier avait constitué un
univers flou, poétique, semé d'énigmes, revisitant
sans cesse les rues de Paris, les acteurs de l'Occupation et les
troubles de la filiation.
On devinait tout ce que ces histoires avaient à voir avec
la vie même de l'auteur. Un pedigree confirme. Le livre
étale ses 21 premières années. Étale
n'est pas le bon terme, car ici on ne trouve ni étalage
ni étalement. D'une pointe sèche et sans larme,
l'auteur énumère les noms des lieux et des personnes
qui ont marqué son enfance : André Gabison, Gordine
Sacha, Jacques Chatillon, Adonis Delfosse... « Que l'on
me pardonne tous ces noms et d'autres qui suivront, avertit l'auteur.
Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pedigree. Ma mère
et mon père ne se rattachent à aucun milieu bien
défini. »
Les parents de Modiano - elle, actrice de seconde zone, lui, homme
d'affaire véreux - sont des monstres d'égoïsme
et d'inconséquence. Ce que nous raconte l'écrivain
est évidemment une « enfance malheureuse »,
partagée entre la dèche intégrale et la frime
grand'bourgeoise. Il raconte sans cri ni pathos, en se cantonnant
à la surface des souvenirs. « Rien de tout ce que
je rapporterai ici ne me concerne en profondeur. J'écris
ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae,
à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une
vie qui n'était pas la mienne. »
Sa vraie vie, après les rigueurs du pensionnat, la délinquance
passagère, la rupture avec les parents, commence à
21 ans quand il se met à écrire son premier roman.
Ce qu'au fond, il ne cesse de faire depuis quarante ans. Il aura
fallu aussi tout ce chemin pour qu'avec Un pedigree, il finisse
par revenir aux sources. Et le plus étonnant, dans ce livre
qui, pour la première fois prétend raconter le vrai,
c'est qu'il se lit comme un vrai roman de Modiano. C'est-à-dire
délicieusement.
Georges GUITTON.
Un
filigrane de souffrance par Jean-Jacques Nuel
"Encore
un Modiano ? Oui, mais pas le énième et même
roman (qui me séduit d’ailleurs chaque fois, me happant
dans son mystère). Un pedigree est un morceau d'autobiographie
sans fioritures, un relevé de souvenirs que le seul fil
chronologique permet d’ordonner. Modiano met à jour,
par un constat net et sobre, le filigrane de souffrance présent
dans chacun de ses romans. Cette souffrance, c’est l’enfance,
l’adolescence, cette immense période qui va jusqu’à
sa majorité, les vingt-et-un ans d’alors - et qui
se clôt, se résout dans l’écriture et
la publication de son premier ouvrage. Devant ce gâchis,
on pense à un autre auteur, Michel Houellebecq, dont Les
particules élémentaires sont, à travers les
vies des deux demi-frères Bruno et Michel, le récit
à peine transposé d’une enfance malheureuse,
loin de parents sans amour, détruite par une mère
d’un égoïsme féroce.
De la figure centrale de la mère, actrice sans gloire (quelques
petits rôles au théâtre et au cinéma,
la misère quotidienne entre échecs et désillusions),
Modiano dresse un terrible portrait : « C’était
une jolie fille au cœur sec. Son fiancé lui avait
offert un chow-chow mais elle ne s’occupait pas de lui et
le confiait à différentes personnes, comme elle
le fera plus tard avec moi. Le chow-chow s’était
suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure
sur deux ou trois photos et je dois avouer qu’il me touche
infiniment et que je me sens très proche de lui. »
Entre la mère et le fils, aucune relation d’amour
ou de confiance ne pouvait s’établir (« Je
me sentais toujours un peu sur le qui-vive en sa présence
»), l’auteur ne se rappelle aucun geste de tendresse
ni de protection, et n’a jamais réussi à désarmer
l’agressivité et le manque de bienveillance qu’elle
lui aura toujours témoignés. « Jamais je n’ai
pu me confier à elle ni lui demander une aide quelconque.
Parfois, comme un chien sans pedigree et qui a été
un peu trop livré à lui-même, j’éprouve
la tentation puérile d’écrire noir sur blanc
et en détail ce qu’elle m’a fait subir, à
cause de sa dureté et de son inconséquence. Je me
tais. Et je lui pardonne. Tout cela est désormais si lointain…
»
Le pardon à ses parents, le seul moyen d’avancer
dans sa propre histoire, de se libérer du poids amer du
passé. Les relations avec le père, toujours en fuite,
entre deux affaires, comme en cavale, sont aussi difficiles. «
Je ne lui en voulais pas et, d’ailleurs, je ne lui en ai
jamais voulu. » Dans une autre vie, ou s’ils s’étaient
connus plus tard, les choses auraient pu être différentes
: « Il aurait été ravi que je lui parle de
littérature, et moi je lui aurais posé des questions
sur ses projets de haute finance et sur son passé mystérieux.
Ainsi, dans une autre vie, nous marchons bras dessus, bras dessous,
sans plus jamais cacher à personne nos rendez-vous. ».
Dans le souvenir du romancier âgé, l’image
du père est moins altérée, moins négative
que celle de la mère - Patrick Modiano ayant même
le regret de lui avoir envoyé une lettre ironique qui a
précipité leur rupture définitive - comme
si l’absence du géniteur, due en partie à
une vie clandestine et aventureuse, à une vie somme toute
assez romanesque, était moins violemment ressentie que
la cruelle indifférence de la mère, pour laquelle
il n’est qu’une chose gênante, dont elle se
débarrasse chez des amis ou dans les pensionnats. Et cette
famille si imparfaite n’existe pas longtemps, puisque après
la naissance de leurs deux enfants, les parents se séparent,
chacun vivant de son côté, entre amants et maîtresses.
« Mon père et ma mère ne se rattachent à
aucun milieu bien défini. » Modiano cherche ses origines
(le titre est une référence à Pedigree, l’autobiographie
de Simenon), une généalogie qui a des racines dans
toute l’Europe et même dans d’autres continents
(la mère, Flamande, venant de Belgique ; le père,
originaire de Salonique, d’une famille juive de Toscane
établie dans l’empire ottoman, dispersée à
Londres, Alexandrie, Milan, Budapest, Paris, le Vénézuela)
; il cherche aussi l’origine de son trouble, cette douloureuse
incertitude qui est sa source d’inspiration.
Le lecteur fidèle de Modiano retrouvera le fameux épisode
du 8 avril 1965, déjà évoqué dans
Dora Bruder : sa mère le force à aller réclamer
de l’argent à son père, qui habite dans le
même immeuble, un étage au-dessus. La nouvelle femme
de son père, « la fausse Mylène Demongeot
», téléphone à la police. Patrick est
embarqué dans le panier à salade jusqu’au
commissariat, où son père l’accuse de faire
du scandale et le traite de « voyou ». D’autres
évènements figuraient dans les derniers romans,
La petite bijou et Accident nocturne. Le séjour à
Jouy-en-Josas, ou à Biarritz l’accident du garçon
renversé à la sortie de l’école par
une camionnette et qui se voit transporté chez les sœurs,
où il découvre le vertige de l’éther
qu’on applique pour l’endormir, l’éther
qui aura cette propriété de lui rappeler une souffrance
et de l’effacer aussitôt, sensation mêlée
à jamais de la mémoire et de l’oubli. La mort
du frère cadet, à peine notée car la douleur
est plus forte que les mots, les longues années de pensionnat
(un voisin de dortoir « sans nouvelles de ses parents depuis
deux ans, comme s’ils l’avaient mis à la consigne
d’une gare oubliée »), ces pensionnats religieux,
d’une rigidité militaire, où il est interdit
de lire Le blé en herbe de Colette ou Mme Bovary, lectures
subversives, les premiers livres découverts, le désir
d’écrire…
On se croirait souvent dans un roman de Modiano… l’incertitude
sur les identités (le père ayant plusieurs noms
et pièces d’identité, en partie pour échapper
aux contrôles policiers sous l’Occupation et dissimuler
sa qualité de juif, en partie pour se livrer à des
trafics douteux, marché noir puis combinaisons hasardeuses
avec des comparses louches, « demi-monde ou haute pègre
»), litanie de noms de personnes disparues, litanie de noms
de rues, individus ballottés par les courants de l’histoire
et de l’émigration, incertains, troubles, rencontres
de hasard comme celle de ses parents « deux papillons égarés
et inconscients au milieu d’une ville sans regard »,
époque entre chien et loup, les rendez-vous dans les cafés
au petit matin, dans la lumière crue des néons.
« Les périodes de haute turbulence provoquent souvent
des rencontres hasardeuses, si bien que je ne me suis jamais senti
un fils légitime et encore moins un héritier. »
On a beaucoup parlé du style de Modiano, dont la grande
sobriété, le retrait (une autre parenté avec
Simenon) permet à l’histoire (trouée) et au
décor (brumeux) de s’installer sans entrave, de prendre
possession lentement mais sûrement du lecteur. Dans Un pedigree,
le style est encore plus dépouillé qu’à
l’ordinaire, comme pour épouser les faits, les réduire
à un procès-verbal – et retenir l’émotion,
la tenir à distance pour parvenir à extirper le
passé douloureux, des bribes de réel. Parfois, l’auteur
veut aller vite, ne pas s’arrêter, la voix se fait
précipitée, car il craint de ne pas avoir le courage
d’aller jusqu’au bout. Cette vie, lui semble-t-il,
n’était pas la sienne. Modiano réussit à
traduire cette impression, que nous avons tous connue, de vivre
une vie en restant immobile, sans y avoir la moindre part de volonté,
de la subir, comme si le décor et le temps défilaient
derrière nous, acteurs figés devant un écran
d’images en mouvement.
« A part mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien
de tout ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur.
Je n’ai rien à confesser ni à élucider
et je n’éprouve aucun goût pour l’introspection
et les examens de conscience. Au contraire, plus les choses demeuraient
obscures et mystérieuses, plus je leur portais de l’intérêt.
Et même, j’essayais de trouver du mystère à
ce qui n’en avait aucun. » La démarche du créateur
n’a rien à voir avec celle de l’analyste. Ce
livre n’est pas une cure psychanalytique, une vérité
dévoilée à l’auteur qui pourrait désormais
– le passé véritablement décrypté
et dépassé - écrire autre chose ou ne plus
écrire, repartir sur d’autres bases. Modiano ne cherche
pas à guérir, après 40 ans d’écriture.
Il jette les mots d’une chose inépuisable, le souvenir
revient, se renouvelle comme un niveau d’eau dans le sable.
Ce dernier livre projette une lumière plus crue, sans l’artifice
de la fiction, sur une douleur que l’écrivain n’a
pas fini de vivre et d’épuiser, de transfigurer dans
de nouvelles sommes romanesques. Le génie de Modiano, c’est,
tout en ressassant cette histoire personnelle, ce drame du manque
d’amour, cette quête angoissée et impossible
des origines, d’en faire une image de l’humanité
entière, d’une condition humaine où rien n’est
sûr, où rien n’est assuré". (http://nuel.hautetfort.com/archive/2005/05/20/un_filigrane_de_souffrance.html)
La
disparition, par Pierre Lepape
"Hier ist kein Warum » : Ici, il n'y a pas de pourquoi.
Primo Levi raconte qu'un gardien SS, dès son arrivée
à Auschwitz, lui enseigna ainsi la loi du camp. Il n'y
a pas davantage de « pourquoi » pensable, rappelle
Claude Lanzmann, l'auteur de Shoah, à la destruction de
six millions de juifs. Il y a des explications multiples, sociologiques,
économiques, psychanalytiques, religieuses qui, séparément
ou croisées, ne suffisent jamais à déduire
le fait de l'extermination. La raison bute. Il arrive même
qu'elle se fasse une raison de son incapacité à
comprendre : elle affirme alors que le génocide est aberration
pure, anomalie historique, instant de démence unique dans
le déroulement explicable du temps. Ce qui a entre autres
avantages celui de débarrasser les bourreaux et leurs complices
du poids de leur responsabilité. Entre les deux écueils,
la rationalisation et l'irrationalisation, la voie est étroite.
Les Temps Modernes, la revue fondée par Sartre et que dirige
aujourd'hui Lanzmann, s'efforce de l'emprunter en analysant le
succès remporté partout dans le monde et notamment
en Allemagne par le (mauvais) livre de Daniel Goldhagen, Les Bourreaux
volontaires de Hitler (1). On y rappelle la formule de Raul Hilberg
qui résume de manière terrible la logique historique
de l'antisémitisme occidental : « Les missionnaires
de la Chrétienté avaient dit : vous n'avez pas le
droit de vivre parmi nous en tant que Juifs. Les chefs séculiers
qui suivirent avaient proclamé : Vous n'avez pas le droit
de vivre parmi nous. Les Nazis allemands à la fin décrétèrent
: Vous n'avez pas le droit de vivre (2). » Lanzmann y souligne
aussi que la compassion et l'anathème, si largement pratiqués
aujourd'hui, ne sont peut-être encore qu'une ruse de l'histoire
pour brouiller les pistes et les enfouir sous l'émotion.
Mais comment écrire sur l'extermination en faisant l'économie
de la colère et de la pitié, ces mauvaises conseillères
? C'est la question qui hante toute l'oeuvre de Georges Perec,
ce mur fragile de signes édifié autour de l'absence.
Perec, en 1963, écrivait, à propos de Robert Antelme
: « Dans tous les cas, monotone ou spectaculaire, l'horreur
anesthésiait. Les témoignages étaient inefficaces
; l'hébétude, la stupeur ou la colère devenaient
les modes normaux de lecture. Mais ce n'était pas cela
qu'il s'agissait d'atteindre. Nul ne désirait, en écrivant,
susciter la pitié, la tendresse ou la révolte. Il
s'agissait de faire comprendre ce que l'on ne pouvait pas comprendre
; il s'agissait d'exprimer ce qui était inexprimable. »
Ce « programme » d'écriture est aussi celui
de Patrick Modiano.
On a trop écrit sur le charme des livres de Modiano, sur
sa trop fameuse « petite musique », sur son art du
flou et du trompe-l'oeil et sur les fausses perspectives savamment
tracées par ses errances et ses déambulations. Non
que ces qualités ornementales et rêveuses, ces délicieux
et troublants entrelacs de la fiction soient négligeables,
mais parce qu'ils sont l'expression manifeste, l'effet de surface
d'un projet beaucoup plus ambitieux : dire l'absence, la rendre
présente. Il est nécessaire d'inverser les termes
du « cas Modiano ». Il n'a pas choisi pour époque
privilégiée de nombre de ses livres la période
de l'occupation allemande qu'il n'a pas connue en raison du caractère
trouble, ambigu, romanesque de ces temps mêlés. C'est
au contraire à cause du trou noir creusé par ce
morceau d'histoire que tout, ensuite, devient mystérieux,
incomplet, irréel, inexplicable, absurde, insaisissable,
fictif. Comme si une pièce de la machine avait disparu
et que le monde continuait à tourner, de travers, en s'efforçant
de l'oublier.
Dans certains de ses romans, Modiano décrit ce monde d'après.
Ses mensonges qui en sont à peine, faute de vérité
; sa mémoire toujours trompeuse, son identité trouée,
sa morale à géométrie variable. Il peut même
entrer de l'humour et de l'indulgence dans ce tableau : un amnésique
n'est jamais complètement responsable de ses actes, et
il est permis de sourire de certains de ses comportements. Plus
à plaindre qu'à blâmer. Dans d'autres, La
Place de l'étoile, La Ronde de nuit, Les Boulevards de
ceinture, mais aussi dans Emmanuel Berl, interrogatoire ou dans
le scénario et les dialogues de Lacombe Lucien, Modiano
retourne au centre du mystère, au coeur même de ce
qu'on pourrait appeler, avec beaucoup de légèreté,
son obsession et qui est sa raison d'être écrivain
: à ces années qui précédèrent
immédiatement sa naissance en 1945.
Jamais il ne l'a fait de manière aussi explicite que dans
Dora Bruder ; sans doute parce qu'il ose se défaire des
maquillages de la fiction. Dora Bruder est le récit d'une
enquête ; Modiano s'y revendique pour ce qu'il est : un
gardien de la mémoire . « Si je n'étais pas
là pour l'écrire, il n'y aurait plus aucune trace
de cette inconnue », dit-il d'une jeune femme dont l'identité
reste incertaine mais dont il sait qu'elle fut raflée le
18 février 1942 et internée aux Tourelles. Elle
était une ombre ; elle devient, par lui, une trace, une
inscription, le début d'une présence.
Pour réussir, le gardien de la mémoire se doit de
vaincre un colosse collectif : les gardiens de l'oubli. Dora Bruder
est aussi le récit, parfois hallucinant, d'un combat inégal
: celui d'un homme seul, d'un écrivain, contre la bureaucratie
de l'amnésie. Il y eut, bien sûr, les policiers des
Questions juives qui détruisirent leurs fichiers et les
procès-verbaux de leurs interpellations au cours des rafles
ou lors des arrestations individuelles, dans la rue. Il y eut
ceux qui ne se souvenaient de rien ou qui n'avaient rien vu, rien
su et qui désiraient qu'après la mort de l'homme
la vie continue, comme si de rien n'était. Mais il y a
encore, aujourd'hui, une cohorte de sentinelles chargées
d'interdire l'accès de la mémoire à ceux
qui la cherchent enfouie dans la poussière des documents
et des registres, enfermée dans des caves dont les clefs
semblent inaccessibles ou égarées.
Par bribes, morceau après morceau, Modiano leur a arraché
des fragments d'existence d'une jeune fille. Elle s'appelle Dora
Bruder. Elle est née dans le douzième arrondissement
de Paris le 25 février 1926. Modiano a fait sa connaissance
il y a huit ans par une petite annonce de Paris-Soir datée
du 31 décembre 1941 : « On recherche une jeune fille,
Dora Bruder, 15 ans, 1,55 m, visage ovale, yeux gris-marron, manteau
sport gris, pull-over bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures
sport marron. » Dora avait fait une fugue ; ses parents
s'inquiétaient. Ils étaient allés signaler
la disparition de leur enfant à la police. Le dernier jour
de 1941, des étrangers, des juifs pouvaient encore demander
à la police française de les aider à retrouver
leur fille. Mais Ernest Bruder, le père, est arrêté,
sans motif connu, le 19 mars 1942 ; Dora le sera le 19 juin. Tous
deux se retrouveront à Drancy avant d'être expédiés
à Auschwitz le 18 septembre de la même année.
Cécile, la mère partira pour le camp de la mort
cinq mois après son mari et sa fille. Personne n'en reviendra.
Une histoire simple, comme il en existe des milliers d'autres.
Une histoire française, avec des fonctionnaires français
pleins de zèle qui, au contraire de l'écrivain,
ne recherchent les jeunes filles que pour mieux les faire disparaître.
Modiano leur vole cet effacement : Dora Bruder désormais
existe. la petite fugueuse parisienne du 41, boulevard d'Ornano,
l'interne de l'institution Saint-Coeur-de-Marie du 62, rue Picpus
ont une vie et des secrets que « les bourreaux, les autorités
dites d'occupation, le Dépôt, les casernes, les camps,
l'Histoire, le temps tout ce qui vous souille et vous détruit
n'auront pas pu lui voler ». Mais ce sentiment d'une dérisoire
et essentielle victoire accompagne celui d'une insurmontable défaite
: « Oui, malheureusement, je venais trop tard. » Même
si des lecteurs répondent à l'appel de Modiano et
lui permettent d'ajouter quelques touches au portrait de Dora
Bruder, il ne s'agira encore que de « signaux de phare dont
je doute malheureusement qu'ils puissent éclairer la nuit.
Mais j'espère toujours ». Pour combler les trous,
Modiano offre à Dora Bruder des fragments de sa propre
jeunesse, en mesurant la distance infinie qui les sépare.De
ces disparitions, tout désormais porte la marque, comme
si l'absence, d'être refoulée, oubliée, était
devenue notre mode d'être ; comme si l'on ne pouvait plus
marcher dans les rues sans avoir l'impression de le faire sur
les traces de quelqu'un. L'urbanisation elle-même devient
une opération de nettoyage de la mémoire. Il y a
dans Dora Bruder des pages simples et magnifiques sur le Paris
d'aujourd'hui qui essaie d'effacer jusqu'aux dernières
traces du Paris d'hier pour gommer de son paysage jusqu'à
l'écho des voix de ces enfants aux noms polonais «
et qui étaient si parisiens qu'ils se confondaient avec
les façades des immeubles ». Qu'on n'aille plus après
ce beau et grand livre entonner la rengaine de Modiano le nostalgique,
de Modiano l'illusionniste de l'incertitude. C'est un écrivain
d'aujourd'hui qui tente l'impossible et l'indispensable : tenir
le lien avec l'horreur de notre proche origine. « Beaucoup
d'amis que je n'ai pas connus ont disparu en 1945, l'année
de ma naissance. Ils avaient épuisé toutes les peines
pour nous permettre de n'éprouver que de petits chagrins.
» (Le 04 Avril 1997)
Un
Pedigree lu par Edouard Baer
A l'occasion d'un entretien avec le comédien,et François
Dufay, PM a évoqué la lecture réalisée
:
PM : "Edouard a trouvé le ton juste, avec beaucoup
de naturel. Sa lecture coïncide pleinement avec mon texte.
Il joue d'une manière un peu distanciée, comme quelqu'un
qui tâtonne, qui cherche, qui rassemble ses souvenirs. Ce
n'est pas du tout oratoire, écueil que n'éviteraient
pas beaucoup de comédiens. Il est amené à
accentuer son côté un peu lunaire - non, ce n'est
pas le bon terme... Il y a chez lui une sorte de somnambulisme,
pour dire des choses assez douloureuses. Comme si, pour ne pas
être complètement submergé, on voyait les
choses défiler en transparence, sur un écran, tandis
que soi-même on reste immobile à l'avant-scène.
Edouard dit le texte avec des ruptures, des décalages,
un peu par à-coups. Comme quelqu'un qui se dépêche,
qui veut se débarrasser. Exactement comme moi j'ai dû
raconter cette histoire, qui au fond n'était pas la mienne,
puisqu'on ne choisit pas ses parents."
François Dufay : Coïncidence très modianesque,
le texte se termine précisément, en 1967, devant
le théâtre de l'Atelier...
P. M.: "Cette scène finale coïncide avec une
impression de soulagement, de liberté, que j'ai ressentie
alors. C'était un lieu où je me réfugiais
entre 17 et 22 ans, comme un antidote. Je n'habitais pas très
loin, j'avais un ami régisseur... Quand je hantais les
coulisses, j'imaginais que j'écrirais un jour une pièce
qui serait jouée dans ce théâtre. ça
me fait un drôle d'effet, aujourd'hui, qu'Edouard y lise
Un pedigree. C'est vraiment bizarre." Modiano-Baer:
un air de famille" Par François Dufay (L'Express),
publié le 01/05/2008
-------------------------------------------------------------------------
Pellicule
«J'écris
ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae,
à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une
vie qui n'était pas la mienne. Il ne s'agit que d'une simple
pellicule de faits et de gestes.». Un Pedigree,
Gallimard, 2005, page 45
Le
Père
Albert Modiano
avait pu échapper aux rafles des Allemands grâce
à une fausse identité qui lui épargnait le port de l'étoile jaune.
De sa jeunesse passée, on ne sait pas grand' chose sinon que la
connaissance du milieu lui permettra de développer quelques trafics,
pendant la guerre, des affaires dont le fils ne saura jamais la nature exacte. Toujours est-il que l'adolescent
finira par rompre avec son père à 17 ans et à la veille de se
revoir, il apprendra sa mort, une mort
jamais élucidée. Il ne saura même jamais où est son corps…
Dans Un cique passe, en 1992, PM écrit : "Le seul
livre qu’il avait emporté pour ce voyage, s’appelait
La chasse à courre. Il me l’avait recommandé
à plusieurs reprises, car l’auteur y faisait allusion
à notre appartement où il avait habité vingt
ans auparavant. Quelle drôle de coïncidence…
La vie de mon père, à certaines périodes,
n’avait-elle pas ressemblé à une chasse à
courre dont il aurait été le gibier ? Mais jusque
là, il avait réussi à semer les chasseurs."
«
Ma mère est absente de mon œuvre, car je cherche à
la préserver de l’impureté. L’affaire
se situe entre mon père et moi. Mon père a pu préserver
sa vie grâce à une attitude trouble, grâce
à de multiples concessions. Ce qui alimente mon obsession,
ce n’est pas Auschwitz, mais le fait que dans ce climat,
pour sauver leur peau, certaines personnes ont pactisé
avec leurs bourreaux. Je ne réprouve pas pour autant la
conduite paternelle. Je la constate. » (Interview
accordée à La Croix, 9–10 novembre 1969; citée
par Morris, p. 42)
"Mes parents à moi étaient gentils.
Ils étaient des aventuriers, assez mystérieux."
Entretien
avec Sébastien le Fol, à propos de La Petite Bijou,
Le Figaro, 17-04-01
«
Il aurait été ravi que je lui parle de littérature,
et moi je lui aurais posé des questions sur ses projets
de haute finance et sur son passé mystérieux. Ainsi,
dans une autre vie, nous marchons bras dessus, bras dessous, sans
plus jamais cacher à personne nos rendez-vous. »
Un Pedigree, roman,
Gallimard, 2006
Le
Père d'après Pierre ASSOULINE (Pierre Assouline,
Modiano, Lieux de mémoire.)
<< Pierre Assouline nous livre dans son article de précieuses
indications biographiques : Juif dont la famille a émigré
au cours des siècles de Modène à Trieste,
Salonique puis Alexandrie, Albert Modiano est né en 1912,
Paris IXè. Son passé est flou : jeune homme livré
à lui-même, vivant de vagues combines et de projets
chimériques, ses activités deviendront encore plus
floues au temps de l’Occupation, où il vivra d’expédients
et fréquentera des gens troubles ou invraisemblables. Avant
guerre, il évoluera un certain temps dans le milieu du
cinéma, celui de producteurs originaires d’Europe
centrale, cruellement caricaturés par Paul Morand dans
France la doulce (1934). Pendant la guerre, il vit sans
l’étoile dans l’illégalité totale,
et sans jamais quitter Paris, pour mieux se fondre dans la masse,
sous la fausse identité de Henri Lagroux. Pris dans une
rafle et transporté gare d’Austerlitz pour un convoi
funèbre, il sera libéré par un ami haut placé,
probablement l’un des membres de la bande de la rue Lauriston,
autrement dit par la Gestapo.
On ne sait trop dans quelles circonstances il rencontra Luiza,
probablement grâce à leur commun intérêt
pour le cinéma. Peut-être se marient-ils pour échapper
à la persécution, puisqu’il s’agit d’un
mariage religieux sous un faux nom français. Après
guerre, ils restent à Paris, où ils ont deux fils
: Patrick et Rudy. Albert sera un père absent, toujours
préoccupé par de mystérieuses affaires. Le
futur écrivain que Modiano est alors le rencontre rarement,
dans des halls d’hôtel ou des gares, dans ces royaumes
paternelles de « caravansérails cosmopolites ».
Parfois il le rencontre aussi dans son bureau de la rue Lord Byron
où se traitent de mystérieuses affaires : «
immeuble ocre rouge, grandes baies vitrées 1930 aux teintes
orangées, double issue qui permet de sortir aux Champs-Élysées
à la hauteur du cinéma Normandie ». «
Parfum de cuir, pénombre, conciliabule interminables de
mon père et de Noirs très élégants
aux cheveux argentés », dira Chmara dans Villa
triste. Cité
par : Carine
Duvillé Errance et Mémoire : Paris et sa topographie
chez Patrick Modiano Mémoire de maitrise, juillet 2000.
Paris IV, Sorbone.
Père
et puzzle (image du)
Jérôme Garcin –
Pourquoi éparpillez-vous dans vos romans, comme les pièces d’un
puzzle, différents portraits de ce père plutôt que de lui consacrer
un livre?
P. Modiano. – J’ai retracé son histoire dans
des cahiers, et de manière très précise. Mais je ne pourrais pas
en faire un roman, je veux dire que je ne pourrais pas transformer
cela en littérature. Ça ressemblerait trop à un rapport de police.
La scène du panier à salade passerait pour banale dans un livre
de souvenirs, c’est la fiction qui lui donne son sens. Et puis
si mon père est présent ici et là, c’est que je ne cesse de recoller
des morceaux de réalité et que sans doute je n’arrive toujours
pas à l’aborder de face, frontalement. Je tourne autour de lui.
J’écris en rond. Jérôme Garcin, Rencontre avec P Modiano, Le Nouvel
Observateur, 2 octobre 2003
Père
(Arrestation*
du)
« Ce mois de février, le soir de l’entrée
en vigueur de l’ordonnance allemande, mon père avait
été pris dans une rafle, aux Champs-Elysées.
Des inspecteurs de la Police des questions juives avaient bloqué
les accès d’un restaurant de la rue de Marignan où
il dînait avec une amie. Ils avaient demandé leurs
papiers à tous les clients. Mon père n’en
avait pas sur lui. Ils l’avaient embarqué. Dans le
panier à salade qui l’emmenait des Champs-Elysées
à la rue Greffulhe, siège de la Police des questions
juives, il avait remarqué, parmi d’autres ombres,
une jeune fille d’environ dix-huit ans [...] Je l’avais
presque oubliée, jusqu’au jour où j’ai
appris l’existence de Dora Bruder. Alors, la présence
de cette jeune fille dans le panier à salade avec mon père
et d’autres inconnus, cette nuit de février, m’est
remontée à la mémoire et bientôt je
me suis demandé si elle n’était pas Dora Bruder,
que l’on venait d’arrêter elle aussi, avant
de l’envoyer aux Tourelles. Peut-être ai-je voulu
qu’ils se croisent, mon père et elle, en cet hiver
1942. Si différents qu’ils aient été,
l’un et l’autre, on les avait classés, cet
hiver-là, dans la même catégorie de réprouvés.»
Dora Bruder, 1997
Père
et Collaboration
<< Mon père aussi, en 1942, avec des complices, avait
pillé les stocks de roulement à billes de la société
SKF avenue de la Grande-Armée, et ils avaient chargé
la marchandise sur des camions, pour l’apporter jusqu’à
leur officine de marché noir, avenue Hoche. Les ordonnances
allemandes, les lois de Vichy, les articles de journaux ne leur
accordaient qu’un statut de pestiférés et
de droit commun alors il était légitime qu’ils
se conduisent comme des hors-la-loi afin de survivre. >>
Dora Bruder, p.119.
____________
PEREC
Georges
<< - Perec est un écrivain
que vous appréciez ?
PM - Oui. J'avais été très frappé
par Les Choses, que j'ai lues à leur sortie en 1965. Ça
tranchait sur ce qui se produisait à l'époque. Perec
se détachait vraiment dans le paysage littéraire,
après la guerre. Les gens qui étaient nés
dans les années 1920 n'avaient pas vraiment pu prendre
le relais de la grande génération active dans les
années 1930. Il y avait bien les gens du Nouveau Roman,
nés dans les années 1920, comme Robbe-Grillet, mais
après je ne voyais que Perec. Beaucoup de gens autour de
moi l'avaient connu, comme le sociologue Henri Lefebvre, Queneau,
qui m'avait parlé de lui. Perec m'avait envoyé Un
cabinet d'amateur, on devait se voir, mais cela ne s'est jamais
fait, malheureusement.>> Entretien
avec Maryline Heck, Magazine Littéraire, n° 490, octobre
2009
LES
PERSONNAGES
1.
Personnages (Les)
<< Des
noms, réels ou inventés (russes en exil, juif de la diaspora,
latino-américains, etc.) , mais bien souvent aucun n'est
vrai, car les à-coup de l'Hstoire ("avec sa
grande Hache" Perec)
ont fait perdre leur état-civil. Ainsi, pour les personnages
de Modiano, tout ce passe comme s'ils n'avaient pas de nom. Des
noms composés de deux prénoms (Guy Rolland), patronymes à consonnance
de pays de l'Europe de l'Est (Blunt) ou quelquefois des êtres
affublés de prénoms dérisoires ( Pimpin Lavorel, Tintin Carpentieri).
Ces noms semblent artificiels, cosmopolites et par là-même
drapés de mystère (Pedro Jeanschmidt ou Baby Da Sylva, Bob
Mc Fowles ou Daniel Desoto) tantôt sinistres ou ternes , au
point d'être insipides et presque inexitants (Sylvestre, Marcheret,
Muraille...)
Les
femmes ont souvent des noms de starlettes : Sylvia, Ghita,
Yvonne... des noms que l'Histoire ou leur histoire a recouvert.
Ces personnages peuvent médecins, acteurs, garagistes...
Ils habitent de vieux palaces déserts, des appartements
sans meubles, de simples chambres. Ils ne sont pas à proprement
parler, des "personnes",
et le reconnaissent : "Je ne suis rien", affirme le narrateur
de Rue des boutiques obscures. Et c'est ce qu'ils pourraient tous
dire. Ils ne font rien, non plus (c'est ce qui ressort de leur
emploi du temps) ,sinon hanter les endroits les pluis vagues :
villes d'eau hors saison, plages fluviales, littoraux des années
soixantes. (...) D'où viennent ces ombres ? En vérité,
un rien les fait naître, et lon pourrait même dire
qu'elles sourdent de l'espace ambiant ou de la limière, à moins
que ce ne soient les lieux ou les objets qui les engendrent. A
d'autres moments, en
d'autres lieux, elles se perdront sous la pluie ou dans les murs
: "Peu à peu, cet homme se fondait dans le mur.
Ou bien la pluie, à force de tomber sur lui, l'effaçait
comme l'eau dilue une peinture
qui n'a pas eu le temps de se fixer. ( Fleurs de ruine, p. 138-139)
De quoi peuvent donc parler ces personnages évanescents,
surgis de rien et prêts à retourner au néant
? De quoi parlent les romans de Modiano ? L'inconsistance est la
règle. ("J'ai
failli, tout à coup, le toucher et m'assurer qu'il ne s'agissait
pas d'un mirage")
Boulevard de ceinture, p 48. Le fantomatique est l'objet
même de
la réflexion de l'écrivain.>>
2. Sur le quivive
Tous les personnages de Modiano semblent sur le qui-vive, prêts
à fuir au moindre danger. En effet, leur vie paraît
toujours compromise, que ce soit à cause de leurs origines
ou de leurs activités.
3.
Personnages inventés et figures de l'histoire
La figure de Violette
Nozière* est évoquée comme personnage
de référence dans l'histoire des criminelles célèbres
et comme un personnage de roman qui, dans la mesure où elle a
peut-être croisé des figures de Fleurs de ruine*,
accède à un autre statut, le temps d'une évocation.
Violette Nozière (1915-1966) fut accusée d'avoir empoisonné ses
parents (seul son père fut tué), elle comparut devant les assises
de la Seine en 1934. Les surréalistes a qui ellel inspira plusieurs poèmes
et peintures exaltant la résistance à l'autorité parentale,
contribuèrent à sa célébrité. Condamnée à mort,
elle fut gracièe puis libérée après 10 ans d'internement
et enfin réhabilitée en 1963.
Dans Fleurs de ruine*, Patrick Modiano l'évoque à sa
manière : << Elle donnait ses rendez-vous dans un hôtel
de la rue Victor-Cousin, près de la Sorbonne, et au Palais du Café,
boulevard Saint-Michel. Violette était une brune au teint pâle que
les journaux de l'époque comparait à une fleur vénéneuse
et qu'ils appelaient "la fille aux poisons" Elle liait connaissance
au Palais du Café avec de faux étudiants aux vestons trop cintrès
et aux lunettes d'écaille. Elle leur faisait croire qu'elle attendait
un héritage et leur promettait monts et merveilles : des voyages, des
Bugatti... Sans doute avait-elle croisé, sur le boulevard, le couple T.
qui venait de s'installer dans le petit appartement de la rue des Fossés-Saint-Jacques."
Dans de nombreux romans, Patrick Modiano mêle des personnages
inventés et des figures de l'histoire qui ont attisé l'imagination
de la presse comme du public. Ce frottement du réel et de la fiction lui
permet de donner encore plus consistance à des personnages "inventés" qui
accèdent au statut du "pour de vrai" que les enfants confèrent à leur
invention dans des jeux tantôt improvisés, tantôt savants.
Ce procédé inscrit les personnages dans l'Histoire et brouille
les pistes entre fiction et réalité. C'est un jeu, un jeu infini.
5.
Personnes réelles et personnages de fiction.
"
Dans quel but mêlez-vous des personnes réelles à
des personnages de fiction ?
Ces personnes réelles apparaissent toujours en second plan,
et quelquefois ne sont que des silhouettes. Je le fais toujours
spontanément ; quand j'y réfléchis, c'est
peut-être une manière pour moi de rendre la fiction
plus troublante, plus magnétique, et de brouiller les perspectives."
Entretien à l'occasion
de la sortie de : Dans
le café de la jeunesse perdue, roman Gallimard, 2007, Le
Monde, 4 octobre 2007.
Personnes
(le Cahier*, retrouver des )
(...) un jour, dans un cahier, j'ai essayé de récapituler
des gens que j'avais croisés dans ma vie mais dont je n'ai
jamais su ce qu'ils étaient devenus. Il y a un côté
énigmatique dans tout cela qui m'a toujours fasciné.
Je me demande quelles vies sont devenues les leurs. C'est une
situation un peu étrange qui ne trouve pas de conclusion.
Parfois, il s'agit de situations dans lesquelles on était
trente ou quarante ans plus tôt et qui n'ont jamais eu d'avenir.
Ou des lieux que l'on n'arrive plus à retrouver, une rue,
un immeuble, un appartement. Ou encore une chose sur laquelle
on n'a jamais eu d'explication. Ça peut remonter à
l'enfance, parfois. Tout cela forme l'arrière-fond de toute
une vie. On a l'impression que le destin hésitait.
Trouve-t-on un jour les réponses ?
P.M. Non, je ne crois pas. Je crois que ces bribes restent toujours
énigmatiques. Il m'est souvent arrivé d'essayer
de retrouver certaines personnes, ou de trouver une explication
à certaines énigmes dupassé, mais à
chaque fois je me suis heurté à une résistance.
Peut-être me suis-je mis moi-même cette résistance
dans la tête... Mais ces choses-là résistent
toujours aux explications. Même si on se livre à
une enquête policière, on n'arrive jamais à
savoir.
"Mon
Paris n'est pas un Paris de nostalgie mais un Paris rêvé"
entretien avec François Busnel (Lire), 04/03/2010
Les
personnages qui font rêver *
<< - Il n’y a aucune rupture de ton entre ce livre
[Un Pedigree] et les précédents, à
l’exception d’un humour discret mais plutôt
noir, comme si vous vous sentiez plus libre à l’égard
des personnes réelles que fictives.
- Je ne peux pas trop employer dans la fiction cet "humour
discret et plutôt noir", parce que, à trop forte
dose, cela orienterait la fiction vers la satire, et j’ai
besoin que les personnages de fiction me fassent rêver.>>
Personnes
réelles
"(...) j’ai toujours incorporé des silhouettes
de personnes réelles, anonymes ou célèbres,
qui étaient comme une greffe sur la fiction. Je trouve
que cela renforce la fiction, que cela lui donne une profondeur
de champ plus intéressante. J’ai besoin de m’appuyer
là-dessus. C’est peut-être dû à
l’influence du cinéma, quand une scène se
passe en extérieur, et que les personnages du film se mélangent
aux gens qui passent pour de vrai dans la rue." [Rencontre]
Patrick Modiano à l'occasion de la sortie de Dans le
café de la jeunesse perdue, MK2 diffusion, 24/01/2008
Personnage
«La Petite Bijou» vous a-t-elle été inspirée par un personnage
de votre enfance? C'est un truc bizarre... C'était
une drôle de période, au début des années cinquante. J'avais 7
ans, j'habitais une maison aux environs de Paris, à Jouy-en-Josas.
A deux ou trois reprises, une fille un peu plus âgée que moi est
venue, elle avait 12 ou 13 ans. Il y avait comme une aura autour
d'elle... Ça venait du fait qu'elle avait joué comme figurante
dans un film. Elle avait ce côté des enfants qui ont grandi trop
vite et ont des vêtements trop petits, elle était un peu comme
la petite Fadette. Elle avait l'air d'être livrée à elle-même,
de ne pas avoir de famille. C'était un mélange bizarre de contexte
campagnard et de cinéma. Son rôle exact dans le film restait un
mystère. Je n'arrivais pas à savoir ce qu'elle avait fait exactement.
Comme si elle avait vécu quelque chose de très... de très...
Personnages
(les)
Il y a de l'intranquillité* dans les personnages, un fort
sentiment d'insécurité. Il ne sont sûr de rien, ni de leurs origines,
ni de leur histoire, ni de leur mémoire, ni de leurs sentiments.
Ils survivent comme ils peuvent dans un univers romanesque cosmopolite
et flou.
Personnages
de La Place de l'Etoile
<< Ainsi voyons-nous défiler des personnages réels
ou fictifs qui appartiennent à la mythologie personnelle
de l’auteur : Maurice Sachs et Otto Abetz, Lévi-Vendôme
et le docteur Louis Ferdinand Bardamu, Brasillach et Drieu la
Rochelle, Marcel Proust et les tueurs de la Gestapo française,
le capitaine Dreyfus et les amiraux pétainistes, Freud,
Rebecca, Hitler, Eva Braun et tant d’autres, comparables
à des figures de carrousels tournant follement dans l’espace
et le temps. >> Résumé deLa
Place de l'Etoile, p 5
Personnages
dans Rue des Boutiques obscures
<< Drôles de gens. De ceux qui ne laissent sur leur
passage qu'une buée vite dissipée. Nous nous entretenions
souvent, Hutte et moi, de ces êtres dont les traces se perdent.
Ils surgissent un beau jour du néant et y retournent après
avoir brillé de quelques paillettes. Reines de beauté.
Gigolos. Papillons. La plupart d'entre eux, même de leur
vivant, n'avaient pas plus de consistance qu'une vapeur qui ne
se condensera jamais. Ainsi, Hutte me citait-il en exemple un
individu qu'il appelait l' « homme des plages ». Cet
homme avait passé quarante ans de sa vie sur des plages
ou au bord de piscines, à deviser aimablement avec des
estivants et de riches oisifs. Dans les coins et à l'arrière-plan
de milliers de photos de vacances, il figure en maillot de bain
au milieu de groupes joyeux mais personne ne pourrait dire son
nom et pourquoi il se trouve là. Et personne ne remarqua
qu'un jour il avait disparu des photographies. Je n'osais pas
le dire à Hutte mais j'ai cru que l' « homme des
plages » c'était moi. D'ailleurs je ne l'aurais pas
étonné en le lui avouant. Hutte répétait
qu'au fond, nous sommes tous des « hommes des plages »
et que « le sable - je cite ses propres termes - ne garde
que quelques secondes l'empreinte de nos pas.>>
R.B.O., p.60
Perte
(la)
<< D’une manière générale, la
perte avive la mémoire à cause du manque ou du sentiment
d’absence qu’elle provoque. Bien sûr, la perte
d’un être que vous aimiez. Mais quelquefois la perte
d’un objet anodin qui vous était familier dans le
passé : soldat de plomb, porte-bonheur, lettre que vous
aviez reçue, vieux carnet d’adresses… Cette
perte et cette absence vous ouvrent une brèche dans le
temps.>> Entretien
réalisé avec Patrick Modiano à l'occasion
de la parution de "Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier"
Bulletin Gallimard, (octobre 2014).
Maréchal
Pétain
Pétain
( L'appel aux Français du Maréchal) - 17 juin 1940
<< Français!
J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux
hostilités. Le gouvernement a désigné mercredi
les plénipotentiaires chargé de recueillir leurs
conditions.
J'ai
pris cette décision, dure au coeur d'un soldat, parce que
la situation militaire l'imposait. Nous espérions résister
sur la ligne de la Somme et de l'Aisne. Le général
Weygand avait regroupé nos forces. Son seul nom présageait
la victoire. Pourtant la ligne a cédé et la pression
ennemie a constraint nos forces à la retraite.
Dès
le 13 juin, la demande d'armistice était inévitable.
Cet échec vous a surpris. Vous souvenant de 1914 et de
1918, vous en cherchez les raisons. Je vais vous les dire.
Le 1er mai 1917, nous avions encore 3 280 000 hommes aux armées,
malgré trois ans de combats meurtriers. A la veille de
la bataille actuelle, nous en avions 500 000 de moins. En mai
1918, nous avions 85 divisions britanniques: en mai 1940, il n'y
en avait que 10. En 1918, nous avions avec nous les 58 divisions
italiennes et les 42 divisions américaines.
L'infériorité
de notre matériel a été plus grande encore
que celles de nos effectifs. L'aviation française a livré
à un contre six ses combats. Moins forts qu'il y a vingt-deux
ans, nous avions aussi moins d'amis. Trop peu d'enfants, trop
peu d'armes, trop peu d'alliés: voilà notre défaite.
Le
Peuple français ne conteste pas ses échecs. Tous
les peuples ont connu tour à tour des succès et
des revers. C'est par la manière dont ils réagissent
qu'ils se montrent faibles ou grands.
Nous
tirerons la leçon des batailles perdues. Depuis la victoire,
l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice.
On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner
l'effort: on rencontre aujourd'hui le malheur. J'ai été
avec vous dans les jours glorieux. Chef du gouvernement, je suis
et resterai avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes
côtés. Le combat reste le même. Il s'agit de
la France, de son sol, de ses fils.>>
Pétain à Paris
<< Le 26 avril 1944, à 9 h 25, cinq automobiles
franchissent la porte Dorée. A leur bord, le maréchal
Pétain,
le docteur Bernard Ménétrel, Jean Tracou, le directeur
du cabinet civil, des inspecteurs de police et un policier allemand.
Ils sont accompagnés par huit motocyclistes de la Garde.
Quelques passants ont reconnu le Maréchal et le saluent,
bras tendu. Le cortège emprunte l'avenue Daumesnil, tourne
dans la rue de Lyon, traverse la place de la Bastille, s'engouffre
dans la rue Saint-Antoine et la rue de Rivoli. " Vive Pétain
! ", entend-on de temps à autre. Des applaudissements éclatent.
A
9 h 35, le Maréchal entre dans l'Hôtel de Ville.
La rumeur commence à circuler dans la capitale. Pétain
est à Paris. Certains croient au canular. Le chef de l'Etat
français n'est pas revenu dans la capitale depuis 1940.
Pourquoi soudainement y ferait-il une apparition ? Que signifie
cette visite qui n'a pas été annoncée ?
A 10 heures, Pétain quitte l'Hôtel de Ville dans
une voiture découverte avec, à ses côtés,
le préfet de la Seine et le préfet de police. Il
se rend à Notre-Dame où le cardinal Suhard le reçoit.
Les caciques du régime sont présents : Laval, Scapini,
Déat, Cathala, Gabolde, Bonnard, Philippe Henriot, Victor
Constant qui préside le conseil départemental de
la Seine, Pierre Taittinger qui préside le conseil municipal
de Paris. Les membres du corps diplomatique ont également
fait le déplacement. A leur tête, Otto Abetz, l'ambassadeur
d'Allemagne à Paris. Le général SS Oberg
arrive en trombe.
Paris
touché par les bombardements alliés
L'archevêque de Paris célèbre la messe des
morts à la mémoire des victimes des bombardements.
Puis, Pétain retourne à l'Hôtel de Ville.
Sur la place, trois mille personnes environ crient " Vive
Pétain ! Vive le Maréchal ! Pétain à Paris
! ", et chantent tantôt la Marseillaise, tantôt
Maréchal nous voilà... A 14 h 55, le Maréchal
apparaît au balcon. " Le vent disperse ses paroles,
raconte Tracou. Les hauts-parleurs ne fonctionnent pas. Mais
sa courte allocution est enregistrée et rien n'en sera
perdu : " C'est une première visite que je vous fais
aujourd'hui. J'espère bien revenir plus tard ; et alors,
je n'aurai pas besoin de prévenir mes gardiens. Je serai
sans eux et nous serons tout à l'aise. A bientôt,
j'espère. (1) " De nouveau, la Marseillaise. Emu,
les larmes aux yeux, le Maréchal salue la foule avec son
képi.
Il
quitte alors l'Hôtel de Ville et gagne l'hôpital
Bichat pour rendre visite aux blessés. A sa sortie, une
femme lui offre un bouquet de roses. Après une courte
escale dans son appartement du square de la Tour-Maubourg, il
franchit de nouveau la porte Dorée à 17 h 45 et
retrouvera " Vichy, le triste Hôtel du Parc, nos cellules
et nos soucis ".
Ce
n'est pas une visite ordinaire, un déplacement officiel
parmi d'autres. Paris vient d'être touché par les
bombardements alliés. Le 3 mars, les 10, 18 et 21 avril
1944, les aviateurs anglais et américains ont attaqué les
points sensibles de l'agglomération, notamment Villeneuve-Saint-Georges,
Juvisy, Noisy-le-Sec et la gare de La Chapelle. Les quatre bombardements
font mille cent treize morts et plusieurs milliers de blessés.
Si aux morts de la région parisienne on ajoute ceux de
Lille, de Toulon et de Rouen, le total dépasse les trois
mille pour la période du 10 au 25 avril.
Certes,
les attaques aériennes ne datent pas de 1944.
Elles ont commencé en mars l942. De plus en plus fréquentes
maintenant, elles frappent les villes, les noeuds ferroviaires,
les sites industriels. L'opinion publique est désorientée.
Bien sûr, on ne peut plus douter que le débarquement
tant annoncé, très souvent espéré,
soit désormais proche. Mais que restera-t-il de la France,
redevenue théâtre d'opérations, et des Français,
victimes des bombardements approximatifs ? Faut-il applaudir
les aviateurs alliés qui préparent la Libération
ou bien crier sa douleur, protester avec force contre ces attaques
imprécises et meurtrières ? " Frais, solide,
bien campé "
Le
préfet de la Seine parle de " résignation " ;
d'autres rapports, d'une véritable révolte : " Si
vous voulez détruire du matériel roulant, il n'est
peut-être pas nécessaire de venir le chercher au
coeur de l'agglomération parisienne où la densité de
population vous condamne de faire à chaque erreur de nombreuses
victimes. Des bombes sont tombées boulevard Barbès,
rue de La Chapelle, rue Championnet, rue Doudeauville. Si ces
actions sont suivies, et rapidement, de la grande invasion libératrice,
elles trouveront alors leur justification. Sinon, vous perdrez
ici de nombreux partisans (2) ".Derrière son micro,
le secrétaire d'Etat à l'information et à la
propagande, Philippe Henriot, l'un des symboles de l'Etat milicien,
s'en donne à coeur joie. Deux fois par jour, il dénonce " les
Anglo-Saxons ", soumis à l'internationale judéo-bolchevique,
qui tuent, sans états d'âme, de bons Français.>>
André KASPI, Le Monde du 17 avril 1944.
LA PETITE BIJOU (2001)
 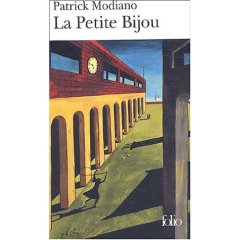
Petite
Bijou (la)
[2001] Collection
blanche, Gallimard
Quatrième de couverture : <<
"Quand j'avais sept ans, on m'appelait la Petite Bijou"Il
a souri. Il trouvait certainement cela charmant et tendre pour
une petite fille. Lui aussi, j'en étais sûre, sa maman lui avait
donné un surnom qu'elle
lui murmurait à l'oreille, le soir, avant de l'embrasser. Patoche.
Pinky. Poulou. Ce n'est pas ce que vous croyez, lui ai-je dit.
Moi, c'était mon nom d'artiste. >>
La
Petite bijou, premières pages
Petite
Bijou, l'histoire ? (la)
" L'histoire est celle d'une jeune fille d'une vingtaine
d'années
qui vit seule à Paris. Un soir, dans le métro, elle
est attirée par la vision d'un manteau jaune et remontant
du manteau au visage, croit reconnaître sa mère qu'on
lui a dit morte des années auparavant au Maroc. Une mère
qui l'avait abandonnée avant de partir en voyage. La jeune
fille qui n'a pas de prénom au présent de l'histoire
mais qui rappelle sans cesse l'époque où elle s'appelait
la petite Bijou, suit ce manteau jaune, découvre le lieu
où habite sa mère, parle avec sa concierge, apprend
des bribes sur elle comme jadis auprès des amies de celle-ci
qui l'avait recueillie. Elle rencontre aussi un homme, être
singulier, dont le métier consiste à écouter
la nuit des émissions du bout du monde, dans les langues
les plus improbables (il en parle une vingtaine dont le merveilleux "persan
des prairies") et à les traduire pour une agence de
presse ; Et puis elle garde une petite fille triste, qui petit à petit
se dessine dans le récit comme une sorte de double contemporain
de la petite Bijou d'hier. Mêmes douleurs, même appartement
immense et désert, même mystère autour des
parents, mêmes suspicions de choses plus ou moins louches.
" Flote, Zazieweb, 13-06-2003
Petite
bijou 2 (la)
<<
Dans De si braves garçons, un roman paru en 1982 - près
de vingt ans déjà ! —, un narrateur (qui pourrait être Modiano
lui-même) recompose la vie du collège de Valvert, un pensionnat
pour garçons riches et abandonnés, telle qu'elle se déroulait
une vingtaine d'années auparavant. Il y raconte notamment les
séances de cinéma qui s'y déroulaient un samedi sur deux.
Un
jour, alors que le film Le Carrefour des archers est au
programme, un ancien de Valvert dont le nom demeurera inconnu
assiste à la séance et évoque comment, autrefois (il y a une vingtaine
d'années, pendant l'Occupation), sa vie a été mêlée à celle de
deux actrices du film, Sonia O'Dauyé - de son vrai nom Odette
Blache, semble-t-il - et surtout la fille de celle-ci, une gamine "de
six ou sept ans" qu'on appelait "la
Petite Bijou". "Oui, déclare le visiteur anonyme, je
peux dire que ma vie, jusqu'à présent n'a été qu'une quête
longue et vaine de la Petite Bijou." Et il relate -
c'est le chapitre V de De si braves garçons -, la
triste et troublante histoire de cette petite fille, abandonnée à elle-même,
traitée comme un objet décoratif et que sa mère, "si influençable,
si évanescente", avait décidé de transformer en enfant
prodige de l'écran, en chien de cirque, en réplique de Shirley
Temple à l'usage de la France de la collaboration et du marché noir.
Le
présent roman de Modiano commence ainsi : "Une douzaine
d'années avait passé depuis que l'on ne m'appelait plus "la
Petite Bijou" et je me trouvais à la station de métro Châtelet
à l'heure de pointe." Voilà donc un pont lancé à travers
le temps pour relier deux îles de l'archipel Modiano. Lui-même
commente le très court texte : " Cela fait donc
vingt ans, et beaucoup plus longtemps d'ailleurs, que cette histoire
me hante. J'ai l'impression depuis plus de trente ans d'écrire
le même livre - c'est-à-dire l'impression que les vingt livres
publiés séparément ne forment en fait qu'un seul livre. Alors,
un thème qui n'a été qu'esquissé reparaît de manière plus développée,
et il y a une sorte de logique interne là-dedans."
Une "sorte" de logique interne en effet, mais dont tous
les éléments concourraient à désorganiser l'ensemble, à rompre
les chaînes logiques - à commencer par les chronologies -, à introduire
le règne de l'incertain, de la rupture, du vide, de l'oubli, du
trou de mémoire, de l'effacement, de l'abandon. Et de l'imaginaire
comme seul recours susceptible de combler les lacunes, de nouer
les fils et de donner forme à la vérité.
Pierre Lepape (Le Monde du 03/05/01)
La
Petite Bijou (propos)
"L'histoire de la Petite Bijou apparaît dans De si
braves garçons, et cela fait donc vingt ans, et beaucoup
plus longtemps d'ailleurs, que cette histoire me hante. J'ai l'impression
depuis plus de trente ans d'écrire le même livre
— c'est-à-dire l'impression que les vingt livres
publiés séparément ne forment, en fait, qu'un
seul livre. Alors, un thème qui n'a été qu'esquissé,
reparaît de manière plus développée,
et il y a une sorte de logique interne là-dedans."
(...)
"C'est après avoir achevé le livre que je me
suis rendu compte que les personnages ont des noms d'emprunt,
ou alors pas de prénoms, ou une identité flottante.
Je l'ai fait presque inconsciemment, en me mettant dans la peau
de la Petite Bijou, c'est-à-dire de quelqu'un dont les
souvenirs sont incohérents et énigmatiques. C'est
le cas de tous les souvenirs d'enfance, mais l'on ne s'en aperçoit
pas quand l'enfance a été heureuse. Alors, ils ont
une certaine cohésion apparente. Mais, si l'on y réfléchit
bien, les souvenirs d'enfance sont toujours étranges et
fragmentaires, à plus forte raison pour la Petite Bijou."
(...)
"les histoires de la Petite Bijou et de la « petite
», du chien perdu de l'une et du chien refusé de
l'autre, sont symétriques. C'est comme si la Petite Bijou
se trouvait entre deux glaces opposées qui projetteraient
son image jusqu'à l'infini. Il s'agit bien de l'enfance
malheureuse. Pendant que j'écrivais ce livre, je suis tombé
sur une phrase de l'écrivain Friedrich Glauser : «
J'en ai vécu, des nuits : pendant la guerre, à monter
la garde ou faire des patrouilles, et ensuite, là-bas,
chez les Français, dans la Légion… Toutes
sortes de nuits… Mais les pires, ce sont les nuits de l'enfance…
»
(...)
"Je voulais donner cette impression de voix à la radio,
qui sont très claires par moments, mais qui risquent de
s'éloigner ou d'être brouillées par des grésillements
de parasites. La Petite Bijou n'est qu'une voix. Comme pour Des
inconnues, on ne sait pas très bien d'où elle nous
parle, quel âge elle a exactement quand elle nous parle,
et on ne saura rien de la « deuxième partie »
de sa vie."
(...)"Il s'agit bien d'un rêve éveillé,
qui tourne quelquefois au cauchemar. La ville elle-même,
les rues où se trouve la Petite Bijou sont « surréelles
». C'est aussi parce que le personnage principal est en
état de « crise », du début à
la fin du livre."
Rencontre
avec Patrick Modiano à l'occasion de la parution de La
Petite Bijou, éditions Gallimard. 2001.
La
Petite Bijou
Le mariage du flou et du net, par Jean-Claude
Lebrun
<<
Patrick Modiano est né en 1945. Une année
de bascule historique dont la prégnance s’étend à toute
son ouvre. Comme s’il ne pouvait décidément
se remettre d’être venu au monde dans un entre-deux.
Alors on le voit, au fil de ses livres, arpenter Paris en tous
sens ou s’aventurer dans la banlieue proche. Et toujours
manifester une incroyable boulimie de repères : stations
de métro, numéros d’immeubles, noms de rues,
de lieux publics, de commerces... Façon pour lui, à travers
ses personnages, de s’accrocher à un espace rigoureusement
corroyé, faute de pouvoir tabler sur d’autres certitudes.
Il
s’est ainsi affirmé comme notre plus grand artiste
du flou et du net. En même temps capable de mises au point
maniaques et de vertigineux flottements. À l’exacte
image de la narratrice de la Petite Bijou, dont le regard ne
semble accommoder sur des personnes ou des lieux que pour davantage
encore renforcer le halo alentour. C’était vers
1956 ou 1957. Les stations de métro ne possédaient
pas encore leurs portillons automatiques. Les postes de radio
s’ornaient d’un " oil magique " vert glauque.
Des figures improbables paraissaient continuer les trafics des
années d’occupation. On allait en bandes écouter
un jazzman célèbre, au Slow Club, rue de Rivoli...
Patrick Modiano multiplie les notations d’époque
comme autant de signes d’orientation, autour de cette figure
elle-même en train de rassembler ses souvenirs d’un épisode
crucial. Elle avait alors dix-neuf ans. Elle restait seule. Sa
mère l’avait abandonnée à la fin de
la guerre sur un quai de la gare d’Austerlitz, un petit écriteau
autour du cou. De son père, elle ignorait tout. Depuis
lors elle tenait dans une boîte à chaussures quelques
papiers et photos. Et un acte de naissance. Autant dire rien.
Des pièces disparates, qu’elle ne parviendrait jamais à faire
tenir ensemble, d’une histoire qui lui avait échappé.
Mais le présent ne lui offrait pas davantage de prises.
Des relations inexistantes, pas d’amis, mis à part
un vieil homme qui écoutait la nuit, crayon en main, des émissions
en langues étrangères à la radio. Pour quelle
cause ou quel discret service ? Une pharmacienne aussi, qui s’était
occupée d’elle un soir de grande déprime,
et avait paru pouvoir jouer le rôle de la mère disparue,
d’ailleurs entre-temps annoncée morte quelque part
au Maroc. La jeune fille semblait tout autant absente au monde
extérieur, dont aucun écho ne parvenait jusqu’à elle.
Pas une remarque en passant, ni même une allusion, alors
que tant d’événements capitaux survenaient
dans le pays et au dehors. Parce que ses regards étaient
tout entier aimantés vers un vide ravageur en elle.
Celle
qui prend aujourd’hui la parole ne sort cependant
pas tout à fait de nulle part. Les lecteurs de Patrick
Modiano l’ont en effet une première fois aperçue
il y a presque vingt ans, au détour d’un autre livre,
De si braves garçons. Elle y apparaissait, dans un film
datant de l’occupation. Elle avait alors six ou sept ans
et portait déjà un nom de scène, " la
petite Bijou ". Sa mère, qui y tenait aussi un bout
de rôle, avait manifestement voulu faire d’elle une
vedette enfantine. Une manière de revanche contre sa propre
destinée d’artiste ratée, en même temps
sans doute qu’une façon de ravaler la fillette au
rang d’un petit animal de salon. Malgré les premières
apparences, la figure de jeune fille en perdition des années
cinquante s’inscrit bel et bien dans une histoire. Même
s’il lui faut en imaginer l’essentiel. Faute d’éléments
tangibles. Mais probablement aussi à cause d’un
refus de savoir, en lequel se laisse deviner une stratégie
de survie. Ce que suggère très exactement l’épisode
autour duquel le roman se construit.
Un jour de sa dix-neuvième année, au métro
Châtelet, la narratrice avait en effet aperçu une
femme portant un manteau jaune défraîchi, en qui
elle avait cru reconnaître sa mère. " J’ai
pensé que c’était elle ", annonce-t-elle
au début du roman. Elle l’avait prise en filature,
s’était renseignée, avait presque acquis
la certitude qu’il s’agissait bien de la génitrice
envolée, mais n’avait surtout pas tenté de
l’approcher. Comme si elle avait craint de se brûler à quelque
vérité. Ou comme si elle n’avait pas voulu
hypothéquer une autre possibilité de vie, délestée
des sombres histoires qu’elle ne cessait de pressentir.
Le marché noir, la collaboration...
Troublante coïncidence, telle qu’en regorgent les
romans de Patrick Modiano : elle avait à la même époque
répondu à l’annonce d’un couple qui
cherchait une garde pour sa petite fille. Et elle avait cru revivre
un cauchemar ancien, avec l’enfant le plus souvent seule,
dans une maison sans meubles, en lisière du bois de Boulogne.
Elle-même avait habité non loin de là, dans
des conditions similaires, laissée à l’abandon
par la mère en continuelles virées. Elle avait
incidemment entendu des grandes personnes désigner celle-ci
comme " la Boche " : " Certains mots se gravent
dans la mémoire des enfants et, s’ils ne les comprennent
pas sur le moment, ils les comprennent vingt ans plus tard. " C’est
aussi l’un des leitmotive de l’ouvre de Patrick Modiano.
Sa narratrice avait fait une tentative de suicide. À son
réveil, elle avait eu l’impression de reposer au
fond d’un aquarium : faute de place, on l’avait casée
chez les bébés prématurés. Comme
pour une autre naissance, une fois effectuée sa randonnée
autour du vide. Cela même que Patrick Modiano, depuis son
premier roman, la Place de l’Étoile, en 1968, n’a
pas un instant cessé d’entreprendre.>> © Journal l'Humanité,
17 mai 2001
La
Petite Bijou
Modiano,
souvenir écrin (...) un noir
bijou par Antoine de Gaudemard
Si
deux périodes historiques marquent l'œuvre de
Patrick Modiano (l'Occupation et les années 50-60 sur
fond de guerre d'Algérie), deux questions existentielles
la hantent tout au long: les traumatismes de l'enfance et les
troubles de l'identité. Livre après livre, à mi-chemin
entre autobiographie et fiction, l'écrivain a exploré ces
zones indécises de l'histoire française et de l'histoire
intime à travers des récits de vies cassées,
précaires ou même vaguement louches, toutes marquées
au fer de la mélancolie. En quête d'une identité perdue,
d'une mémoire défaillante, d'une image lointaine,
ses personnages illustrent à la perfection cette phrase
de René Char, souvent citée par Modiano, et selon
laquelle «Vivre, c'est achever un souvenir.»
La
Petite Bijou n'échappe pas à la règle:
la jeune et poignante héroïne du roman éponyme
achève, à sa manière, un souvenir. Perdue
sans collier dans le Paris du mitan du XXe siècle, elle
croise dans le métro une femme au manteau jaune en qui
elle croit reconnaître sa mère, dont elle n'a plus
de nouvelles depuis une douzaine d'années. Une vieille
femme, à moitié folle, surnommée dans son
gourbi de Vincennes «Trompe la Mort», comme autrefois
on appelait «la Boche» la mère de la Petite
Bijou. Celle-ci se met à suivre ce fantôme, et de
filature en filature, remonte en elle son propre passé,
jusque-là bloqué comme par un invisible couvercle.
Son enfance de gamine abandonnée, son père inconnu,
sa mère artiste mineure mais toujours absente et partie
un beau jour sans retour pour le Maroc, les pensions sinistres
et le grand appartement désert: tout le «pays natal» ressurgit,
mais plus cauchemardesque encore qu'il ne l'a jamais été.
«Enfant
du froid» qui tente de «voir plus
clair» dans sa propre vie, la Petite Bijou ne tire aucun
bénéfice de son enquête. Juste des bribes,
des lambeaux, accrochés à une photo conservée, à une
adresse, à un nom. Un désespoir plus grand s'abat
même sur elle. Un jour pourtant, prenant son courage à deux
mains, elle décide de monter frapper à la porte
de l'inconnue qu'elle pense être sa mère. Un effort
démesuré: «J'ai eu l'impression non pas d'avoir
gravi un escalier, constate-t-elle, mais d'être descendue
au fond d'un puits.» Elle renonce et a l'impression d'avoir échappé à un «danger».
Le retour sur soi et l'élucidation de son passé seraient-ils
donc inutiles, voire porteurs du pire? Faut-il vraiment «aller
jusqu'au bout» d'un souvenir? Ne vaudrait-il pas mieux «couper
les ponts», comme la jeune femme le pense un jour de déprime
ordinaire ?
Paradoxalement,
Modiano, cet obsessionnel de la mémoire,
pourrait le laisser croire, tant le passé est ici vécu
comme un «marécage» sans fond, où on
s'embourbe et on se noie, et tant la Petite Bijou endure. Le
jour, elle s'occupe d'une petite fille, à demi-abandonnée
par un couple des beaux quartiers, riche mais paumé. Une
complicité de victimes unit bientôt les deux délaissées,
et la Petite Bijou comprend qu'elle n'est pas seule dans son
malheur. Parfois, on a de la compassion pour elle. Un homme,
dont le travail est de traduire des émissions de radio
du monde entier, l'emmène au café le Babel, où l'on
entend parler toutes les langues du monde, et l'écoute,
lui posant les questions qu'elle-même se pose secrètement.
Une pharmacienne l'aide à surmonter les cafards sans nom,
les nuits de solitude qu'elle passe dans sa chambre d'hôtel
de la place Blanche, en face du cabaret Le Néant. Mais
ces médecins de hasard suffiront-ils pour qu'elle survive,
même «de justesse» ?
La
Petite Bijou est sans aucun doute l'un des romans les plus noirs
de Modiano. Penserait-il désormais qu'il n'y a plus
de rédemption par la lutte contre l'oubli? Les blessures
de l'enfance seraient-elles décidément inguérissables?
Cette question est au centre de l'œuvre de Modiano, dont
la propre enfance, entre pensionnats et fugues, a été traumatisée
par la disparition de son frère Rudy, de deux ans son
cadet, mort à l'âge de 10 ans en 1957. Sans avoir
lu tout Freud, on sait qu'un tel événement, dans
une vie, peut engendrer une culpabilité sourde, la quête
névrotique de quelque chose d'irrémédiablement
perdu. Dans ce bref roman, épuré jusqu'à l'os,
Modiano broie du noir, même si une faible lueur d'espoir
clôt le récit, comme si nous étions des esclaves
de la mémoire, incapables d'oublier, mais incapables de
s'affranchir. Sciant les barreaux de l'oubli pour se retrouver
dans une prison plus froide encore.© Libération le
26/4/2001.
La
Petite bijou. Modiano, logique interne par Daniel
Rondeau (Express 14-05-2001)
<< La lumière d'une vie qui se dérobe, c'est
d'abord des mots pour la dire. «Une douzaine d'années
avait passé depuis que l'on ne m'appelait plus "la
Petite Bijou" et je me trouvais à la station du métro
Châtelet à l'heure de pointe.» Le dernier
roman de Patrick Modiano, La Petite Bijou , nous ramène
dans un monde au contexte flou. Pas d'histoire, mais une succession
de petites aventures, liées par une main trop molle pour être
celle du destin, et des personnages au visage de brouillard,
garçons et filles du même âge, qui restent
dans le flou et l'inachevé et ont besoin de «contacts
humains»; c'est l'éternel côté Françoise
Hardy de Modiano. Tous semblent flotter dans les vêtements
trop grands, et toujours un peu démaillés, de leur
existence: une jeune fille à la recherche de sa mère,
une pharmacienne en manteau de fourrure, un couple mystérieux,
suspect et déboussolé, une petite fille à l'abandon,
une femme en jaune suivie dans un couloir du métro, un
garçon brun en veste de cuir qui capte des émissions
de radios étrangères.
Il y a longtemps que Patrick
Modiano a décidé ce
qu'il voulait faire de sa vie d'écrivain: «Me créer
un passé et une mémoire avec le passé et
la mémoire des autres.» En 1976, il avait confié son
projet à Emmanuel Berl, qui l'avait encouragé.
Berl, lui, n'avait pas tellement besoin de la mémoire
des autres. La sienne était chatoyante, chargée
de mille souvenirs. Il avait dirigé un journal, tutoyé des
ministres, été l'ami de Drieu et de Malraux, servi
de nègre à Pétain et épousé Mireille.
Comme l'écrivait Modiano dans Interrogatoire , «il
avait été dans le coup».
C'est pourtant le
Berl «seconde manière» qu'aimait
Modiano. Celui qui n'était plus dans aucun coup et qui écrivait
Sylvia ou encore Présence des morts , calfeutré dans
son appartement du Palais-Royal, en regardant au mur de sa chambre
une lettre de Proust sur l'amitié, arrachée à la
boue des tranchées. Je n'ai aucune idée de ce que
peut être la vie de Patrick Modiano, mais je sais, à le
lire, qu'il écrit ses livres comme s'il n'avait jamais été «dans
le coup» et était resté calfeutré dans
sa chambre de jeune homme. Il n'y a jamais eu de Modiano première
manière. L'auteur de La Place de l'Etoile a brûlé les étapes.
Il s'est installé à 20 ans dans la peau de celui
qui se souvient et n'en finit pas de remuer dans son encre un
passé qui ne lui appartient pas.
Modiano fait ainsi sa matière de ses propres rêveries.
Il lui suffit de regarder le monde tel qu'il se dessine sous
ses paupières closes pour lancer le manège à trois
temps de ses obsessions. Le lecteur reconnaît quelques
points fixes du décor, des boulevards ou des places aisément
repérables sur le plan de Paris (le boulevard Jourdan,
la place de Clichy, l'avenue Malakoff et le bois de Boulogne).
Les circonstances varient peu, nous sommes toujours dans l'après-guerre,
même si cette fois-ci, au fil des années qui passent,
le souvenir de l'Occupation semble s'estomper. Des personnages
apparaissent, qui tiennent des conversations banales, mais certaines
expressions («pays natal») exercent un pouvoir magique
sur leur volonté. Ils sont tous plus ou moins sur le qui-vive,
dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Si la main invisible
qui conduit leurs actions semble incertaine, c'est parce que
ces personnages sont des créations non de l'Histoire,
mais du songe. Leur statut évanescent ne leur évite
pas de tituber dans les décombres de la vie. Les fantômes
aussi ont du mal à vivre.
Les livres de Modiano se ressemblent,
s'interpellent, se répondent,
se poursuivent. L'histoire de La Petite Bijou apparaissait déjà dans
De si braves garçons et l'auteur a raison de dire que
tous ses livres ne forment en réalité qu'un seul
- et grand - roman, celui d'un temps retrouvé et inventé dans
la mémoire des autres, et marqué du sceau de la
répétition des destins (ce que Modiano appelle
sa «logique interne»). Il y aura toujours une femme
qui hantera les couloirs du métro avec un manteau jaune.
Les personnages de Modiano ne l'oublient jamais. Leurs mains
tremblent. >>
La Petite Bijou
La consigne des enfants perdus Propos
reccueillis par Antoine de Gaudemard. Libération, le 26/4/2001
«La Petite Bijou» vous a-t-elle été inspirée
par un personnage de votre enfance ?
C'est
un truc bizarre... C'était une drôle de période,
au début des années cinquante. J'avais 7 ans, j'habitais
une maison aux environs de Paris, à Jouy-en-Josas. A deux
ou trois reprises, une fille un peu plus âgée que
moi est venue, elle avait 12 ou 13 ans. Il y avait comme une
aura autour d'elle... Ça venait du fait qu'elle avait
joué comme figurante dans un film. Elle avait ce côté des
enfants qui ont grandi trop vite et ont des vêtements trop
petits, elle était un peu comme la petite Fadette. Elle
avait l'air d'être livrée à elle-même,
de ne pas avoir de famille. C'était un mélange
bizarre de contexte campagnard et de cinéma. Son rôle
exact dans le film restait un mystère. Je n'arrivais pas à savoir
ce qu'elle avait fait exactement. Comme si elle avait vécu
quelque chose de très... de très...
Par la suite, avez-vous su ?
Non,
je préférais ne pas trop savoir. Je préférais
qu'elle reste comme ça, avec son mystère. Elle était
plus vivante.
La Petite Bijou, c'est un peu vous ?
C'est
une enfant un peu spéciale. C'est une manière
de parler de mon enfance et de l'enfance en général,
mais en beaucoup plus sombre.
Pourquoi assombrissez-vous si souvent le trait ?
Les
choses pénibles de l'enfance reviennent toujours,
dix ans après, vingt ans après, comme une espèce
de boomerang... de bombe à retardement... Comme si les
fondations étaient pourries au départ et finissaient
par s'effondrer. La Petite Bijou est dans une situation lugubre,
qui débouche sur une sorte de suicide, qui heureusement échoue....
En même temps, à la fin, on peut supposer qu'elle
est libérée, libérée de son passé.
Tout le livre est comme un cauchemar.
Oui,
comme un cauchemar. Elle est dans un état second,
elle vit les choses de manière déformée,
tout se dérobe, c'est un mauvais rêve. Dans ces états
de crise, de dépression, on fait appel à des inconnus,
on croit qu'ils peuvent vous aider. On pense que les gens de
son entourage ne peuvent pas comprendre.
Vous faisiez souvent des cauchemars, enfant ?
Oui.
Quand on est enfant, on reçoit les choses de manière
un peu... On les voit démesurément grandes, et
en même temps de manière très parcellaire.
Quelquefois des détails prennent une très grande
importance, alors qu'ils n'en ont aucune. Alors, ça ressurgit
dans les cauchemars. Les souvenirs d'enfance sont complètement
fragmentaires, il y a des détails hypertrophiés.
Tout prend une dimension bizarre, les lieux les plus banals,
ne serait-ce qu'un garage, un ascenseur, deviennent brusquement
inquiétantes, étranges... Peut-être c'est
pareil maintenant pour les enfants, avec d'autres lieux, d'autres
objets.
A propos de l'enfance, il y a dans vos livres une angoisse de
l'abandon.
Oui...
C'est une manière d'exorciser une peur de l'enfance,
c'est un poids dont on essaie de se débarrasser. En pension,
j'ai connu beaucoup de garçons comme ça, abandonnés.
Comme s'ils avaient été oubliés à la
consigne. Je me souviens d'un garçon brésilien.
Il était là depuis un an et jamais personne ne
venait le voir. Il n'avait aucune nouvelle de qui que ce soit,
le collège était obligé de le garder. Comme
si ses parents avaient perdu le ticket de la consigne. La petite
dont je parle avait vécu dans des appartements immenses
et vides, livrée à elle-même. Et la plupart
de ces parents étaient complètement déculpabilisés,
c'était horrible.
La Petite Bijou apparaissait déjà dans «De
si braves garçons» et on dit souvent que vous écrivez
le même livre depuis trente ans. C'est vrai ?
C'est
compliqué à expliquer. Je n'ai jamais eu
l'impression, chaque fois que j'ai écrit un livre, d'avoir écrit
quelque chose de fini, de clos sur lui-même, comme un roman
de Simenon, par exemple. J'ai toujours eu l'impression que j'essayais
au fur et à mesure de mes livres de déblayer quelque
chose pour enfin arriver à écrire un vrai livre.
Mais ce n'est jamais fini, c'est comme une fuite en avant, très
désordonnée, comme quelqu'un qui n'a pas assez
de souffle, qui est obligé de faire des pauses. Dans mon
enfance, il y avait une course de vélo qui s'appelait
les Six jours. Pendant six jours, les coureurs tournaient sur
une piste. Parfois, ils s'arrêtaient, ils faisaient du
surplace. C'est pareil quand j'écris. Dans cette succession
de livres, il y a plein de moments inutiles, il ne faudrait garder
que les bons et les rassembler, comme des morceaux choisis. Je
me dis toujours: je vais me débarrasser de ça,
et après j'aurai le champ libre. Mais c'est impossible,
c'est une illusion. Le vrai livre n'arrive jamais. Et je n'arrive
jamais à écrire un livre complètement autonome
des autres. J'ai toujours l'impression que je pourrais prendre
tel truc dans tel livre et le raccrocher à tel morceau
d'un autre, que ça ne ferait pas vraiment de différence.
Tout ces déblayages vers un livre principal donnent une
direction mais pas une architecture, ce qui fait qu'on continue
d'écrire. On reprend sous un autre angle, c'est comme
un contrechamp. Dans «Des inconnues», un des trois
récits est un contrepoint, bien noir, de «Villa
triste».
En peinture, on parle de repentir.
Oui,
c'est tout à fait ça. Le mot est fort, presque
moral, mais c'est ce que je ressens. D'un livre à l'autre,
je rafistole des choses entre elles, je bricole. C'est une sorte
de patchwork, mais j'oublie des éléments en cours
de route, et j'essaie ensuite de les rattraper. Je reprends des
choses trop superficielles, pour les approfondir, comme si quelque
chose avait germé. C'est bizarre, mais il y a une sorte
de logique interne... Pendant le premier mois, on ne sait pas
où on va, c'est pénible. Quand c'est fini, ça
ne correspond plus du tout à ce qu'on imaginait. C'est
pareil depuis trente ans. Au début, on s'embarque, on
cafouille, on va à l'aveuglette. Puis ça se met
en place, mais jusqu'à la fin, on bifurque, on croit que
c'est fichu, mais il suffit de revenir en arrière pour
s'apercevoir où on s'est fourvoyé. Parfois c'est
décourageant. Godard disait, je crois, qu'il avait coupé au
hasard dans la pellicule de son premier film. C'est vrai. Il
suffit quelquefois de taillader, pas vraiment au hasard, il y
a toujours des intermèdes qu'on peut couper. Le texte
est souvent comme une masse molle qui vous paralyse, mais vous
taillez dans le vif, vous enlevez les doublons, les répétitions.
Et vous repartez. Ecrire, c'est comme un lent travail d'accommodation,
comme un regard qui divergerait et qu'on redresserait peu à peu.
Je ne trouve jamais le bon angle d'emblée. A l'origine,
Moreau-Bardaev, par exemple, c'était deux personnages
mais je me suis rendu compte qu'un seul suffisait. Alors je lui
ai donné les deux noms. Au départ, on louche, on
voit tout en double. Puis la mise en place, l'accommodation,
se fait.
«La Petite Bijou», comme votre roman précédent «Des
Inconnues», est écrit au féminin. Pourquoi
?
Le «je» de
mes autres romans a toujours été un
peu vague, c'est moi et pas moi. Mais utiliser le je me concentre
mieux, c'est comme si j'entendais une voix, comme si je transcrivais
une voix qui me parlait et qui me disait je. Ce n'est pas Jeanne
d'Arc, mais plutôt comme quand on capte une voix à la
radio, qui de emps en temps s'échappe, devient inaudible,
et revient. Ce je d'un autre qui me parle et que j'écoute
me donne de la distance par rapport à l'autobiographie,
même si je m'incorpore parfois au récit.
La radio est souvent présente dans
vos livres..
Elle
a un vrai pouvoir suggestif, toutes ces voix qui se chevauchent,
qui se brouillent. Il y avait autrefois
aussi ce qu'on appelait
le réseau, des gens qui se cherchaient et qui se parlaient
sans se connaître sur des lignes téléphoniques
hors service. Parfois c'étaient des numéros qui
n'étaient plus attribués depuis vingt ou trente
ans, je me suis renseigné, c'est bizarre qu'ils aient
laissé ces lignes marcher si longtemps. J'imaginais que
des téléphones sonnaient pendant des heures dans
des appartements vides, des maisons abandonnées.
Pratiquez-vous ce qu'on appelle depuis quelque temps l'autofiction
?
Oui,
si on veut. Je mets dans mes livres des éléments
de ma vie, je suis toujours mal à l'aise dans le roman
proprement dit. C'est une sorte de carcan. J'essaye toujours
de trouver une façon plus directe d'écrire, plus
intime. Pas l'autobiographie car c'est toujours un peu artificiel,
il y a toujours un effet littéraire. L'autobiographie
interdit à l'imaginaire de se développer, elle
condamne à des poses paralysantes. Il faut trouver la
bonne distance. L'autofiction est une sorte de compromis, plus
proche de la vérité, plus honnête finalement,
sans l'illusion autobiographique. >>
La
Petite Bijou, c'est moi... » par Jérôme Garcin.
<< Saura-t-on jamais de quel secret désarroi, de
quelle lointaine et obscure blessure d'enfance Patrick Modiano,
romancier passé avec le temps de la confusion à
la compassion, tire la faculté d'être ému
jusqu'aux larmes par les jeunes femmes à l'abandon, les
orphelines un peu butées, les provinciales esseulées
et timides que l'on croise dans la rue sans les voir, mais que
lui, doué d'un sixième sens, prend le temps de regarder,
d'écouter et d'accompagner avec une infinie délicatesse
? En 1998, il avait reconstitué les trois monologues de
jeunes femmes opaques et désespérées. «
Des inconnues » était écrit ¬ sans faute
de goût et sans que jamais l'on sente l'exercice de style
¬ à la première personne du féminin singulier.
Thérèse, alias « la Petite Bijou »,
à laquelle l'écrivain prête aujourd'hui sa
plume, est la soeur de ces oubliées du bonheur. Elle ne
vit pas, elle traîne sa vie. Pas de travail, pas de famille,
pas d'avenir. Identité improbable. Une ombre, dans le métro.
Sa confession, qui ressemble à la relation d'un rêve,
voire au récit d'une dépression, commence d'ailleurs
dans les longs couloirs de la station Châtelet, où
déambulent « des égarés » dont
elle tient qu'ils « ne remonteront plus jamais à
la surface ». Il suffit alors qu'elle aperçoive,
dans la foule compacte de l'heure de pointe, une femme portant
un manteau jaune élimé pour que Thérèse
se fasse, au sens propre, tout un roman. Elle veut croire en effet
que cette inconnue est sa mère, dont on lui avait pourtant
assuré qu'elle était morte, quinze ans auparavant,
au Maroc. Mais, pense-t-elle, « on ne meurt pas au Maroc.
On continue de vivre une vie clandestine, après sa vie
». Au lieu de l'aborder, comme par crainte de rompre la
magie de ces retrouvailles imaginaires, elle la prend en filature,
la suit jusqu'à Vincennes, repère la cabine d'où
elle téléphone, le café où elle boit
un kir, et l'immeuble triste où elle habite, escalier A,
4e étage. Thérèse ne savait plus à
quoi s'occuper, voici qu'elle a trouvé une raison de vivre.
Elle se consacre à percer l'énigme irrésolue
de cette mère fantasque et mythomane qui s'était
inventé un titre de noblesse irlandaise, trichait sur son
âge, falsifiait ses papiers d'identité, se faisait
appeler comtesse Sonia O'Dauvé, et dont elle conserve,
en guise de testament, une boîte à biscuits métallique
contenant un agenda, un carnet d'adresses, et quelques photos
jaunies. C'est une enquête vaine, pathétique, et
d'autant plus émouvante que dès la première
page on sait bien que, menée par une fabulatrice neurasthénique,
elle ne peut aboutir à rien. Plus l'investigation semble
méticuleuse, plus elle est nébuleuse. Quel est ce
film, « le Carrefour des archers », dans lequel, enfant,
elle aurait joué un petit rôle aux côtés
de sa mère ? Et quel est ce livre, « les Enfants
du froid », qu'on lui lisait autrefois pour l'endormir ?
Chez Modiano, les numéros de téléphone (le
Passy 13-89 ou le 225 à Bar-sur-Aube), les adresses (le
11 de la rue Coustou ou le 129 avenue de Malakoff), les noms (Moreau-Badmaev,
Valadier), n'éclairent jamais l'intrigue, ils ne font au
contraire qu'ajouter au mystère et à son charme
désuet. Du plus loin de l'oubli... Comme dans son livre
précédent, « Des inconnues », Patrick
Modiano feint de n'être ici qu'un greffier, chargé
d'enregistrer la déposition divagante d'une jeune femme
inconsolée qui « recherche des contacts humains »
et murmure : « Il faut trouver un point fixe pour que la
vie cesse d'être ce flottement perpétuel. »
Elle raconte ses insomnies et ses errances dans Paris ¬ une
fleur de ruine dans les quartiers perdus. Elle rencontre dans
une librairie un homme qui traduit et résume les émissions
de radio en langues étrangères. Elle garde la petite
fille, également prénommée « Petite
Bijou », d'un couple inquiétant, dans une grande
maison vide, sise près du bois de Boulogne. Et elle finit
par s'évanouir dans une pharmacie de l'avenue Ledru-Rollin,
avant d'être raccompagnée jusque chez elle, à
Pigalle, près du cabaret le Néant, dont un panneau
vante à la fois « les filles » et « le
train fantôme ». On a l'impression d'être à
bord de ce dernier depuis la première page du livre. Jamais
Patrick Modiano n'a mieux exprimé que dans ce roman somnambulique
la quintessence de son art, où il excelle depuis trente-trois
ans. Plus rien, ici, ne rattache l'écrivain et son orpheline
à la réalité. Même l'obsession de l'Occupation
est absente. A côté, Dora Bruder, jeune juive disparue
en 1941 dont il s'est appliqué à retrouver la trace,
passe pour un personnage naturaliste. « La Petite Bijou
», elle, n'existe que par ses fantasmes. C'est une image
floue, une figure de style, une métaphore de la littérature,
un prétexte à déambuler au gré du
hasard, à poser des questions sans réponses, à
provoquer, grâce à la magie des mots, une intemporelle
rêverie. Flaubert, on le sait, rêvait d'écrire
un livre ex nihilo, qui tienne par la seule force du style, réponde
aux lois de la rhétorique pure, ne puisse être réduit
à la vie de l'auteur et lui soit finalement supérieur.>>
Le Nouvel Observateur le 26/04/2001.
Un
joyau signé Modiano, par Marc Lambron
Roman - Fidèle à lui-même, l'écrivain
traque, dans « La Petite Bijou », un monde qui ne
veut pas mourir. Un charme sans pareil.
L'auteur s'appelle
Modiano, Patrick, Jean, né à Boulogne-sur-Seine
le 30 juillet 1945. Fils d'Albert Modiano, administrateur de sociétés,
et de Mme née Luisa Colpeyn, comédienne. De ces
quelques lignes sèches dans le « Who's Who »
est sortie une oeuvre, jamais frontalement autobiographique, mais
hantée par l'impossible transmission du passé. Les
154 pages de « La Petite Bijou » n'éclairciront
pas l'énigme. Mais c'est, comme l'on dit, le nouveau Modiano.
Donc un événement de principe et une lecture de
plaisir.
Il suffit de quelques pages pour retrouver, insinuante et familière,
la tonalité de toujours. On reconnaît le style de
Modiano comme la voix de Pierre Fresnay ou le toucher de Stéphane
Grappelli. Personne ne saurait dire pourquoi, mais tout ce qu'écrit
l'auteur de « Villa triste » est merveilleusement
signé. Voyez l'ouverture du livre : une jeune femme, Thérèse,
suit dans le métro une passante quinquagénaire.
Elle a cru reconnaître le visage de sa mère disparue,
« comme si un projecteur l'avait fait surgir de la nuit
». La mystérieuse passante - un sosie ? - descend
à la station Porte-de-Vincennes et téléphone
d'une cabine publique. Puis elle se dirige vers un immeuble en
brique rouge, l'une de ces vieilles HBM de la périphérie
parisienne. La jeune fille la suit toujours.
En quelques traits, tout est installé : la filature, la
filiation, le dernier métro, le vertige des doubles, les
boulevards de ceinture, l'énigme des vies. Il semble que
l'on soit à Paris dans les années 60. Des fragments
de mémoire flottent au milieu du brouillard. Comme dans
les trois nouvelles du précédent livre de Modiano,
« Des inconnues », c'est une jeune femme qui parle
à la première personne. Thérèse, 19
ans, a vécu son enfance de pensionnat en pensionnat. De
sa mère elle a conservé un portrait peint par un
certain Tola Soungouroff, l'adresse d'un hôtel qui figure
sur son acte de naissance, des notes transmises par une cartomancienne.
Elle se souvient d'avoir tourné à l'âge de
7 ans dans un film, « Le carrefour des archers »,
sous le nom de « la Petite Bijou ». Thérèse
vit de menus métiers, vendeuse, réceptionniste,
baby-sitter dans une étrange famille de Neuilly. Du côté
du boulevard Maurice-Barrès, elle a soudain un sentiment
de déjà-vu. Elle aussi a connu dans sa première
enfance un grand appartement près du bois de Boulogne.
Des phrases lui reviennent en mémoire : « Ta mère
aussi, on l'appelait la Boche. » Qu'est devenue cette mère,
née Suzanne Candères pour l'état civil, mais
dont la carte de visite portait le nom de comtesse Sonia O'Dauyé
? A-t-elle vraiment disparu au Maroc après avoir précipitamment
quitté Paris ? Et quel rapport existe-t-il entre un visage
de 1942 et une inconnue croisée dans le métro ?
On trouvera dans « La Petite Bijou », parfois jusqu'à
l'autopastiche, tous les charmes qui font la griffe Modiano -
et d'abord cette fascination cotonneuse pour les étrangers
que Paris a un jour avalés, Russes blancs, rescapés
de l'Egypte khédiviale, officiers de la Wehrmacht. Mais
on aura rarement ressenti autant qu'ici son art particulier de
la découpe : focaliser sous une lumière de studio
des objets nimbés d'une inquiétante étrangeté.
La moquette pelucheuse et les barres de cuivre d'un escalier de
banlieue. L'enseigne lumineuse d'un garage. Une boîte de
biscuits Lefèvre-Utile. Une affiche d'autrefois dans le
métro : « Pupier, le chocolat des familles ».
Il en émane une inquiétude urbaine, noire et blanche,
qui serre le coeur et fait peur. Car il y a des aspects Hitchcock
chez Modiano, un côté romancier des spectres. Faut-il
que le miroitement des adolescences estompées, que l'effroi
de l'invisible l'habite pour qu'il s'entête et succombe
à cette résonance clandestine des choses, entre
les villes balnéaires et la place Blanche, la plaine Monceau
et la rue Lauriston ? Autant de personnages qui promènent
leur désarroi d'orphelins dévoyés, leur charme
éteint par la nuit.
Une même énigme plus dérobée
La grande blancheur des années 60, semble dire ici Modiano,
n'était que l'écho trouble d'un monde qui ne veut
pas mourir : monde que ressuscitent les brownings dans leurs étuis
de daim gris, quelques plaques sur les façades, les voix
de speakers lointains. « Ta mère aussi, on l'appelait
la Boche. » Chacun des livres de Modiano apparaît
ainsi comme la même photographie jaunissante d'une même
énigme toujours plus dérobée. C'est pourquoi
ses romans vont du même jet vers leur épuisement
en même temps qu'ils peuvent, à l'infini, se répéter.
Est-ce que 1965 ressemblait encore à 1942 ? Oui, non, peut-être
? Un tel miroitement d'époques ne porte qu'un même
regret et une seule leçon : tout entêtement généalogique
est hantise de l'illégitime. C'est par là, je crois,
que Modiano pince une corde chez ses lecteurs. On ne voudrait
pas vivre la vie de ses personnages. Mais ils expriment la guigne,
le malaise, le flottement doucereux, le vacillement d'identité,
la part maudite et quotidienne qui émane de nos mauvais
rêves.
Un roman de Modiano en 2001, c'est aussi une certaine situation
de l'auteur. Cinquante-six ans cette année et trente-trois
ans de carrière. Ce dernier mot convient-il à un
écrivain qui paraît médiumniquement poussé
à vivre entre ses miroirs de papier ? Le « Who's
Who », toujours très factuel, lui dessine pourtant
un destin de poète lauréat : prix Fénéon
et Nimier, grand prix du roman de l'Académie française,
prix Goncourt, prix des Libraires, prix Pierre-de-Monaco, grand
prix du roman de la ville de Paris, etc. Dans son « Journal
inutile », Paul Morand le cite dix-huit fois, toujours avec
estime. Patrick Modiano entrera donc à l'Académie
malgré lui, au terme d'une rafle verte où le panier
à salade s'arrêtera sur le lieu de son enfance, quai
de Conti. Une autre façon de saisir le profil consisterait
à recenser les collaborations auxquelles Modiano s'est
prêté au fil des années : un livre d'entretiens
avec Emmanuel Berl, un film avec Louis Malle, des textes illustrés
par Sempé, Pierre Le-Tan ou Dominique Zehrfuss (son épouse),
des préfaces pour Brassaï ou Jean-Marie Périer,
un livre sur Françoise Dorléac cosigné avec
Catherine Deneuve. Cela dessine une famille de préférences,
pessimistes élégants et graphistes subtils, photographes
de l'air de Paris et actrices inoubliables. Des gens qui pourraient
trouver leur bonheur dans l'annuaire du téléphone,
pourvu qu'il date de 1937 ou de 1967.
Il y a enfin une autre raison d'aimer Modiano, et même de
le placer sous protection écologique. C'est sa fidélité
à lui-même, son indifférence aux tendances.
Les écrivains français viennent de traverser - s'en
est-on rendu compte ? - l'une des pires périodes dans les
annales plombées du diktat littéraire. Point de
salut en dehors de la dérive obligatoire, des maux de ventre,
de l'aveu tripal. On était sommé de déférer
au règne de l'endoscopie, du cri primal, de l'ulcère
duodénal érigé en épopée du
moi. Modiano, lui, a tenu sa note, indifférent aux rebelles
officiels, narguant par sa musique les stridences de l'amnésie.
Sous cette Occupation-là, il aura résisté.
Cela donne pour l'heure « La Petite Bijou », un joli
joyau . © le point 27/04/01 - N°1493
~~~~~~~~
"Petite musique"
Depuis combien d'années cette expression revient sous la plume
de critiques littéraires qui n'ont rien à dire
de nouveau, ou appliquent à la manière des frères
Ripolin, les couches succesives d'une même partition
avec des notes distendues et, finalement
inaudibles... Comme on ne sait plus évoquer la notion
(le concept ?) de style à cause d'exemples écrasants
(Proust, Céline, Barthes,
Foucault, etc.,) on livre ces propos qui n'informent sur
rien.
"On
ne dira jamais assez combien la prétendue " petite
musique ", avec ce qui peut s’y entendre de légèreté,
se trouve en fait arrimée dans le temps historique.
Ni combien elle interroge et dérange." Jean-Claude
Lebrun, l'Hummanité, 5 mars 1999.
Docteur
PETIOT
<< Petiot : où est passé le docteur Satan ?
Détenu cinq mois sur ordre de la Gestapo l’an dernier,
l’étrange médecin est recherché depuis
la découverte d’un charnier dans son hôtel
particulier, rue Lesueur à Paris
Les
Alliés ont débarqué sans se soucier
des impératifs de bouclage imposés aux quotidiens
de la presse collaborationniste parisienne. Hier matin 6 juin
44, le lecteur inquiet qui parcourt «l’Oeuvre»,
le journal de Marcel Déat, leader du national-socialisme à la
française, n’apprend rien sur l’invasion de
l’Europe par les forces ploutocratiques. Il est en revanche
tranquillisé par l’article d’un expert en
stratégie qui l’assure que la chute de Rome n’est
pas un événement décisif. Son attention
est brièvement attirée par un entrefilet sur l’affaire
Petiot. Ce nom lui dit quelque chose. Ah oui, c’est ce
médecin marron et assassin dont on parle depuis quelques
mois et qui est sans doute à la solde de Londres.
Une illusion partagée par le lieutenant Richard L’Héritier
détenu à Fresnes. Cet authentique résistant
est persuadé que le docteur Petiot est un compagnon d’armes.
Il y a un an, il a partagé la même cellule que lui
pendant cinq mois. Il n’a aucun doute: fondateur du réseau
Fly-Tox, le docteur Petiot est un patriote. Le juge Berry, chargé du
dossier, et le commissaire Massu, qui mène l’enquête,
en sont moins sûrs. Ils recherchent sans grande conviction
l’énigmatique docteur qui s’est évaporé depuis
mars. Ils ont d’autres soucis. Ils observent la prudence
de rigueur chez les magistrats et les fonctionnaires d’autorité en
ces temps incertains.
La dernière fois qu’on a vu le docteur Petiot, c’est
dans la soirée du 11 mars 1944. Ce médecin de quartier
apparemment sans histoire est chez lui, 66 rue Caumartin, en
compagnie de sa femme et de son fils. Il est 19 heures. Il attend
dans son salon le moment de passer à table. Bon père,
bon époux, Marcel Petiot est d’une nature casanière,
il sort peu et ne boit jamais. Cette quiétude familiale
est soudain troublée par un coup de téléphone.
Ce sont les pompiers. Ils l’informent qu’une fumée épaisse
et nauséabonde s’échappe de l’hôtel
particulier qu’il a acheté, 21 rue Lesueur, à des
fins connues de lui seul. Très calme, le docteur répond
qu’il arrive. Il prend son vélo et traverse Paris
déjà plongé dans l’obscurité du
black-out. Rue Lesueur, une rue résidentielle et secrète
qui était restée jusque-là à l’abri
de la guerre, il a une mauvaise surprise: son hôtel particulier
est cerné par la police.
Les pompiers ne l’ont pas attendu. Ils ont cassé une
vitre et sont descendus au sous-sol. Ce qu’ils y ont trouvé les
a épouvantés. Un bras mal consumé sort d’un
calorifère. Des cadavres entiers ou en morceaux gisent
sur le sol. Ils sont à demi rongés par de la chaux
vive et en état de putréfaction. Le commissaire
Massu s’affaire, un mouchoir sous le nez. Le seul à garder
son sang-froid est le docteur Petiot. Il range posément
son vélo et aborde un brigadier: «Je suis le frère
du docteur Petiot. Etes-vous un bon Français?» Le
brigadier bredouille que oui. Comme tous ceux qui ont affaire
au bon docteur, il est hypnotisé par cet homme aux sourcils
broussailleux, au regard sombre et perçant, à la
voix prenante. «Nous sommes de la Résistance, poursuit
Petiot. Nous avons éliminé des traîtres,
des collabos et des Boches.» Le brigadier se met presque
au garde-à-vous. Impassible, le docteur se mêle
aux enquêteurs qui rassemblent les débris humains.
Par bravade, il s’approche du commissaire Massu jusqu’à le
frôler. Puis il disparaît dans la nuit trouble de
l’Occupation.
Dans les jours qui suivent, le commissaire Massu reçoit
un dossier de la Gestapo, accompagné de cette injonction: «Arrêtez
le docteur Petiot. C’est un fou.» Le docteur est
visiblement une vieille connaissance de la police allemande.
En mai 1943, deux services de la Gestapo qui se font une guérilla
sans merci, celui de la rue des Saussaies et celui de la rue
de la Pompe, apprennent qu’un certain docteur Eugène
dirige un réseau qui permet à des familles juives
d’émigrer en Argentine. Les gestapistes se mettent
en chasse. C’est la rue de la Pompe, où officie
l’Hauptsturmführer Friedrich Berger, qui gagne. Le
24 mai 1943, le docteur Eugène, alias Marcel Petiot, est
arrêté ainsi que ses rabatteurs. Il est écroué à Fresnes
et interrogé tous les jours par Friedrich Berger. Avec
tous les raffinements possibles. On lui lime les dents à vif,
on lui serre la tête dans un étau, on le pend par
la mâchoire, on le passe à la gégène.
Marcel Petiot supporte toutes ces douceurs avec un stoïcisme
qui déconcerte ses interrogateurs pourtant expérimentés.
Friedrich Berger se doute bien qu’il n’a pas affaire à un
chef de la Résistance. Petiot n’a pas fait disparaître
que des juifs mais aussi des auxiliaires français de la
Gestapo en délicatesse avec leur employeur, dont un certain
Jo le Boxeur. Petiot est donc un passeur vénal. S’il
y a une chose dont la Gestapo a horreur, c’est bien qu’on
se fasse de l’argent sur son dos. Les interrogatoires redoublent
de férocité. En vain. Petiot ne parle pas. A l’époque,
les Allemands ignorent tout de la rue Lesueur et de ce qui s’est
passé dans son sous-sol. Friedrich Berger finit par relâcher
le docteur contre 100 000 francs. Toujours ça de pris.
L’Hauptsturmführer a dû aussi exiger que Petiot
lui rende certains services. Lesquels? On ne le saura jamais.
Le commissaire Massu, pris entre la Gestapo et la libération
de la France qu’il devine toute proche, marche sur des
oeufs. Il enquête, terrorisé par ce qu’il
découvre et par ce qu’il ignore. Il fouille de fond
en comble l’hôtel de la rue Lesueur. Il examine longuement
le local où Petiot enfermait ceux et celles qui croyaient
avoir acheté un billet pour le salut et la liberté.
Chez Maurice Petiot, le frère du docteur, il trouve des
valises pleines de vêtements, de lingerie, de bijoux. Maurice
Petiot, convaincu d’avoir livré par camion de la
chaux vive à Marcel, est inculpé et écroué.
Le juge Berry et le commissaire Massu en savent un peu plus sur
le fugitif. Le docteur Petiot est né à Auxerre
en 1897. Il a été blessé pendant la Grande
Guerre et réformé pour tristesse et neurasthénie.
Il a été reçu à ses études
de médecine avec la mention très bien, malgré une
faiblesse en dissection qui explique peut-être pourquoi
il n’a pas réussi à faire disparaître
les corps de ses victimes. Avant la guerre, il a fait de la politique.
Il a été maire de Villeneuve-sur-Yonne et conseiller
général. Il a été accusé de
corruption, soupçonné d’avoir incendié une
laiterie et d’avoir assassiné une de ses domestiques.
Après avoir ouvert un cabinet à Paris, où il était
adoré de ses malades, il a été surpris à voler
un livre chez Gibert Jeune. Il a même frappé le
vendeur, ce qui l’a conduit à être interné pendant
quelques mois dans une clinique psychiatrique. Broutilles, en
comparaison du charnier de la rue Lesueur, où le médecin
légiste, le docteur Paul, a dénombré 27
cadavres. Et tout cela ne dit pas où a bien pu passer
ce docteur Petiot qu’on commence à appeler le docteur
Satan...
[Epilogue.
Le 31 octobre 1944, Marcel Petiot, devenu entre-temps le capitaine
Valéry, héros de la libération
de Paris, sera démasqué et arrêté.Son
procès établira que nombre de ses victimes furent
des juifs qui tentaient d’échapper aux camps d’extermination.
Condamné à mort le 24 avril 1945, il sera guillotiné le
4 mai suivant.] >> Par
François Caviglioli, le Nouvel Observateur, semaine
du 3 juin 2004.
Pitié et
Tendresse*
A la question d'un journaliste qui lui lance :
- "Vous semblez finalement éprouver de la tendresse pour la plupart
des protagonistes…
- Peut-être une certaine tendresse, mais qui se confond avec la pitié.
LA
PLACE DE L'ETOILE (1968)
 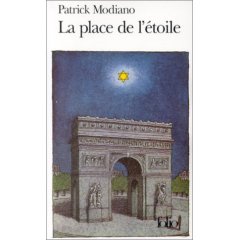
La
place de l'Étoile (1968)
Résumé de l'éditeur
: << En
exergue de cet étonnant récit, une histoire juive : «Au mois de
juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et
lui dit : "Pardon, monsieur, où se trouve la place de l'Étoile
?" Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine.»
Voici, annoncé en quelques lignes, ce qui anime le roman : l'inguérissable
blessure raciale.
Le narrateur, Raphaël Schlemilovitch, est un héros hallucinatoire.
À travers lui, en trajets délirants, mille existences qui pourraient
être les siennes passent et repassent dans une émouvante fantasmagorie.
Mille identités contradictoires le soumettent au mouvement de
la folie verbale où le Juif est tantôt roi, tantôt martyr et où
la tragédie la plus douloureuse se dissimule sous la bouffonnerie.
Ainsi voyons-nous défiler des personnages réels ou fictifs : Maurice
Sachs et Otto Abetz, Lévy-Vendôme et le docteur Louis-Ferdinand
Bardamu, Brasillach et Drieu la Rochelle, Marcel Proust et les
tueurs de la Gestapo française, le capitaine Dreyfus et les amiraux
pétainistes, Freud, Rébecca,
Hitler, Éva Braun et tant d'autres, comparables à des figures de carrousels tournant
follement dans l'espace et le temps. Mais la place de l'Étoile,
le livre refermé, s'inscrit au centre exact de la «capitale de
la douleur».>>
Le
héros Raphaël Schlemilovitch
incarne tous les juifs : « Après avoir été un
juif collabo, comme Joanovici-Sachs, Raphaël Schlemilovitch
joue la comédie du "Retour à la terre" comme
Barrès-Pétain. A quand l'immonde comédie
du juif militariste, comme le capitaine Dreyfus-Stroheim ? Celle
du juif honteux comme Simone Weil-Céline ? Celle du juif
distingué comme Proust-Daniel Halévy-Maurrois ?
Nous voudrions que Raphaël Schlemilovitch se contente d'être
un juif tout court… » (p.114-115).
La
Place de l'Etoile, résumé
<< Au mois de juin 1942 un officier allemand s’avance
vers un jeune homme et lui demande : "Pardon monsieur
où se trouve la place de l’Etoile ?" Le jeune
homme désigne le côté gauche de sa poitrine.
Raphaël Schlemilovitch est juif. Il l’affirme et
le clame à qui veut l’entendre. Mieux, il rédige
des libelles contre les goys, rêve d’enjuiver
le Cantal, et se propose de séduire une marquise normande
pour l’envoyer se prostituer au Brésil. « Oui,
la guerre a été déclaré par ma
faute.[...] Oui, je rêve de ruiner toute la paysannerie
française et d’enjuiver le Cantal. » Une
folie destructrice hante la chevauchée de cet aventurier
désaxé. Peut-être veut-il se faire justicier
pour son peuple ; toutefois se vante-t-il d’avoir été l’amant
d’Eva Braun et d’être "le seul juif
qui ait reçu des mains d’Hitler la Croix pour
le Mérite".
Raphael Schlemilovich revit de maniere desordonnee differents
destins fantasmagoriques, comme dans un kaléidoscope
(d’ailleurs son père est président-directeur
général de la Kaleidoscope Ltd.)
On croise ainsi le docteur Louis-Ferdinand Bardamu et ses diatribes
sur les juif, ainsi qu’un certain Jean Paul de
la Sarthe, defenseur des opprimes, en particulier de Jacob
X, officier juif deserteur de l’armee francaise. Il voit
en Drieu la Rochelle et Brasillach des « cocottes » énamourées
de SS musclés. Il est au service d’un certain
comte Levy Vendome qui se livre a la traite des blanches. Il
passe dans un kibboutz disciplinaire en Israël où on
le torture parce qu’il lit Marcel Proust. Il finit dans
la clinique viennoise du docteur Freud, brûlé par
la violence de l’Histoire.>>
Place de
l'étoile (la) [1968]
, préface de Jean Cau. Nouvelle édition revue et corrigée
en 1985, Collection blanche, Gallimard ; Nouvelle édition
revue et corrigée, Collection Folio (No 698) (1975)
«Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance
vers un jeune homme et lui dit: "Pardon, monsieur, où se
trouve la place de l'Étoile?" Le jeune homme désigne le
côté gauche de sa poitrine.»
La
Place de l'étoile, pamphlet
" C'était
plutôt une sorte de pamphlet. Aujourd'hui, avec la distance
du temps, je ne me reconnais pas dans ce pamphlet. C'est comme
dans un film où vous vous voyez enfant, et où vous ne vous
reconnaissez pas. Donc cela me fait un drôle d'effet. D'habitude,
le premier roman que l'on écrit, comme Radiguet l'a fait, c'est
une histoire d'amour. Mais là, c'était comme prendre les gens à partie.
Pas vraiment un roman. Des allusions à des gens que je connaissais, à des
romans que j'avais lus... " Entretien
avec Laurence Liban, Lire, octobre 2003.
Place de l'étoile (la)
A
son étoile par Alexandre
"21 mai 1968. Dans Paris insurgé, le drapeau rouge
flotte sur le théâtre de l’Odéon et
sur la Sorbonne. Sur l’autre rive de la Seine, un discret
mais néanmoins fameux conclave d’écrivains
s’est réunit sous les ors de l’hôtel
Meurice, rue de Rivoli, pour décerner le prix Roger Nimier.
(institué depuis 1963 et la mort du « hussard bleu
») Grognards et hussards sont de la partie. Le champagne
s’évente, Blondin est encore gérable, Morand
n’est plus qu’un vieux prince, tour à tour
charmant et irascible. La Place de l’étoile est couronné
; son auteur, Patrick Modiano, n’a que 23 ans ; il a stupéfié
le jury du prix Roger Nimier par sa maîtrise d’une
époque qu’il n’a pourtant pas connue : l’Occupation.
Dans Le Figaro Littéraire, Robert Kanters s’emballe
: « Il y a là le drame d’un jeune homme cultivé
et doué avec toutes les contradictions, tous les mensonges
de notre temps et de notre culture dont l’antisémitisme
arrogant ou hypocrite n’est qu’une image particulièrement
horrible. Je crois que non seulement il faut écouter le
cri que pousse La Place de l’Étoile, mais qu’il
faudra lire les prochains livres de M. Modiano. » En exergue
du livre, une historie juive : « Au mois de juin 1942, un
officier allemand s’avance vers un jeune homme et lui dit
: « Pardon, Monsieur, où se trouve la place de l’Etoile
? » Le jeune homme désigne le côté gauche
de sa poitrine. » Le ton est donné. En un périple
halluciné, Modiano escamote la réalité historique
pour mieux servir les vies imaginaires de son personnage : Raphael
Schlemilovitch. Véritable kaléidoscope d’un
juif errant, le roman narre les péripéties extravagantes
de son personnage qui fourmille d’existences contradictoires
: journaliste à Je Suis Partout, juif antisémite
amant d’Eva Braun, « juif officiel » du III
Reich, proxénète spécialisé dans la
traite des Blanches, chante des écrivains du terroir français,
victime de la Gestapo française…S’invitent,
dans ce roman intimement imprégné de la littérature
française des années 30 et 40, les figures de Maurice
Sachs, Brasillach, Rebatet, Céline. (pastiche réussi
dès les premières pages du style de Céline
et des articles de Rebatet) La droite littéraire d’alors
est subjuguée par ce premier roman dans lequel, sans doute,
elle respire un peu la nostalgie de son monde, achevé d’être
piétiné par mai 68. Paul Morand écrira dans
son Journal Inutile : « Ce roman aurait plu à Roger.
Ce sourire dans la souffrance, cette manière de gratter
ses plaies trahissent à n’en pas douter un authentique
créateur. » Modiano, après ce premier succès,
sera couvé par Morand qui le recevra plus d’une fois
à sa table, avenue Charles-Floquet, à l’endroit
même où il levait son verre à la victoire
de l’Allemagne en 1943…Morand et ses 80 ans académissibles
n’avaient pas compris que Modiano symbolisait la prise en
main d’une génération qui allait demander
des comptes à ses aînés sur la période
de Vichy. « Visage humain composé de mille facettes
lumineuses et qui change sans arrêt de forme », le
héros de Modiano traverse avec frénésie le
temps et l’espace, suggérant qu’il est bien
difficile d’avoir une identité juive cohérente.
Insolent et provocateur, souvent drôle, le premier roman
de Modiano est déroutant, grinçant, jouissif. On
a l’habitude de dire qu’avec Modiano, c’est
toujours un peu le même livre. Celui là détone
clairement. Cette Place de l’Etoile est non seulement à
part dans l’œuvre de Modiano mais aussi dans l’histoire
littéraire, et surtout, dans l’histoire littéraire
des premiers romans. Par les mémoires fantasmagoriques
de son personnage, Modiano s’escrime à analyser le
traumatisme psychique, à la fois intime et universel, de
la judaïté. Dans cet envol bigarré, le héros
est tour à tour bourreau, martyr, bouffon, maître,
admirablement servi par une alternance des styles : tragique,
parodique…
Jonglant avec ses souvenirs douloureux, Patrick Modiano a fait
de son jeune héros un alter ego, une figure gémellaire.
Son double de papier exorcise ses démons autant qu’il
les invente. Une citation de René Char conviendrait parfaitement
à ce roman brillant et audacieux : « Vivre c’est
s’obstiner à achever un souvenir. » L’éloge
le mieux exprimé pour ce roman est sans doute prononcé
par Jean Cau (ancien secrétaire de Sartre et prix Goncourt
en 1961 pour La Pitié de Dieu) qui, dans la préface
qu’il fait de ce livre, écrit : « En vérité,
je vous le dis, un sacré livre et une dure épreuve
(…). En vérité, la voix unique d’un
écrivain de vingt ans qui ouvre d’une poussée
les lourdes portes de la littérature. » Alexandre
" http://www.denecessitevertu.fr/2010/07/03/a-son-etoile/
Bibliographie
de La Place de l'Étoile de Anne-Marie Obajtek-Kirkwood
La
Phrase
"(...) chaque
phrase doit être définitive. (...). Souvent je tourne une journée
entière autour d'une même phrase. Je l'écris. Je la raie. Je la
récris."
Entretien
avec J. L. de Rambures, dans Le Monde, Paris, 14 mai 1973, p.
24.
Pièges
"Les romans de Modiano se réduisent à l'épure. Les mots y sont manipulés
avec soin et prudence. Les phrases sont des pièges où s'engluent
des vies fictives. Le romancier s'empare de l'autre comme de son
jumeau, croisé, entrevu, pourchassé sans doute, mais qui ne nous
dévoilera jamais l'épreuve de la mort. Modiano nous fascine, mais
nous fait peur. Il s'en excuse : son écriture se fait limpide
(anodine) afin de cacher ce travail de deuil." Hugo
Marsan, Chien de printemps (Seuil ed, 1993), Le Monde, 20-11-93,
PIVOT
Bernard (1935- )
A la suite de la publication de La Place de l'Etoile, PM reçut
de Bernard Pivot mot d’encouragement et de félicitations
lui prédisant un bel avenir. "Je l’ai gardé. Comme on le ferait d’un talisman."
Article
de l'Encyclopédie Wikipédia
Photographie
(la même)
«
Je suis un peu comme un photographe qui prendrait la même
photo sous différents angles. »
De quelle scène ? Il ne répondra jamais à
cette question, j'en suis persuadé. Ces lignes sont écrites
(le 31 janvier 2004) alors qu'il est vivant, peut prendre connaisssance
de cette affirmation, la contester. Mais non..., Mais non !
Plaisir
d'écrire
<< - Vous dites, à propos d'Un pedigree, que
vous regrettez de n'avoir pu écrire un livre heureux. Vivez-vous
de manière générale l'écriture comme
quelque chose de malheureux, de douloureux ? Y a-t-il pour vous
un plaisir à écrire ?
PM - Non, pas vraiment. C'est un travail douloureux, monotone
surtout. Car c'est très long, alors la difficulté
est de garder l'impulsion. Cela me donne parfois l'envie d'être
peintre : cela va plus vite, quelques gestes... L'écriture
est quelque chose d'un peu pénible pour moi. C'était
terrible quand j'étais plus jeune, c'était très
lent, je mettais au moins un an à écrire ces livres
pourtant pas très longs. Ce qui est pesant aussi, c'est
cette phase de correction, très longue, qui vient après
la phase d'écriture proprement dite. Mais écrire
était ma seule possibilité ; quand j'étais
jeune surtout il n'y avait pas d'autre solution que d'écrire.
Il y avait cette impression d'incertitude, et l'écriture
seule était un peu tangible, pouvait venir condenser des
choses. Entretien
avec Maryline Heck, Magazine Littéraire, n° 490, octobre
2009
Plan
«Je n’ai pas de plan. J’avance en me disant
que je fais fausse route. La rêverie de départ retombe
très vite. C’est ce qui est difficile avec l’écriture.
Or il faut trouver le stimulant pour continuer. Un peu comme les
acteurs qui doivent répéter trois fois une même
scène d’amour. C’est compliqué, oui,
compliqué.»
Rencontre
« Patrick Modiano, chasseur d’ombres par Lisbeth Koutchoumoff,
Le Temps. 13 mars 2010
Plaques
commémoratives.
<< A Paris, une grande partie des stèles commémoratives
de la Seconde Guerre correspondent à la semaine de la Libération.
« Dans cette rue a été mortellement blessé...»
Elles
portent deux drapeaux entrecroisés, une cocarde ou la croix
de Lorraine et sont libellées très simplement: «Ici
est tombé...», «Ici a été fusillé...»,
«Dans cette rue a été mortellement blessé...».
Les plaques apposées sur les murs des immeubles parisiens
honorent la mémoire des acteurs de la guerre. Le bureau
des monuments de la ville de Paris recense 962 plaques commémoratives
de la Seconde Guerre mondiale, dont 45% correspondent à
la semaine de la Libération. Les
principales personnalités de la résistance ont leur
plaque, tels Pierre Brossolette ou Jean Moulin. Parfois dans plusieurs
arrondissements. Mais ces dernières rendent aussi hommage
aux cheminots, agents du métro, professeurs, étudiants,
FFI, FTP, soldats de la 2e DB et policiers et à tous ces
anonymes tombés pendant la Libération, infirmiers,
brancardiers, héros d'un jour ou d'une semaine. La forte
concentration de plaques dans certains arrondissements traduit
la géographie de la guerre dans Paris. Les Ier, VIe, VIIe,
Xe, XIIIe, XIVe, XVe et XVIIIe arrondissements reflètent
les combats de la Libération. Ils seront particulièrement
violents rue de Rivoli et place de la Concorde mais aussi boulevard
d'Italie, avenue des Gobelins, rue de Tolbiac. A
l'origine, elles ont été apposées spontanément
par des témoins de ces événements tragiques.
«Il s'agissait au départ de cartons découpés
que l'on suspendait à l'emplacement où une personne
avait été tuée» (...) Des
inscriptions à l'encre ont aussi été écrites
pendant quelques semaines, à même les murs. A l'angle
de la rue de Rivoli et de la place de la Concorde, une croix ornée
d'un bouquet de fleurs avait été improvisée
à l'endroit précis où était tombé
un résistant des Forces françaises de l'intérieur.
La
démarche, souvent effectuée par la famille de la
personne disparue, par les autorités civiles, des associations
ou des organisations professionnelles, s'officialise. Un décret
pris par le ministère de l'Intérieur du 12 avril
1946 fixe les conditions d'attribution. Les demandes doivent être
motivées, avec des témoignages à l'appui.
Et le propriétaire doit donner son accord. Depuis 1977,
avec le changement de statut de Paris, c'est le maire qui prend
l'arrêté. Le
conseil de Paris protège ces plaques. Régulièrement
remises en état, elles sont fleuries aux frais de la Ville
lors des fêtes commémoratives. Et en cas de démolition
d'immeubles, elles sont réinstallées sur un nouveau
support. «Quelques-unes vont encore être apposées
cette année, notamment celle d'un jeune fusillé,
Joseph Epstein, explique François Tanniou, et une rue Rol-Tanguy
doit être inaugurée en août.» Les
plaques sont, le plus souvent, visibles depuis la rue mais certaines
sont méconnues, comme cette plaque installée dans
le patio d'une institution religieuse du VIIe arrondissement et
dédiée à un abbé, décapité
en Allemagne, qui dirigeait un réseau de résistance.
Certaines comportent plusieurs noms, telle celle dédiée
à la mémoire de 143 jeunes fusillés, près
du métro Balard (XVe). Les personnalités du monde
du spectacle tombées pendant la guerre ont une plaque commune,
située en face du Théâtre des Bouffes parisiennes
pour que les spectateurs d'aujourd'hui n'oublient pas les acteurs
et machinistes ayant appartenu au Comité de libération
des travailleurs du spectacle. (...) >> Marie-Estelle
Pech, Le Figaro 25 août 2004.
Point magnétique
" (...) "fuir le studio pour la rue et la lumière
naturelle, et le désir d'atteindre ce point magnétique où documentaire
et fiction se confondent."
Point fixe (trouver
un)
Jérôme Garcin - «Un jour, écrivez-vous p. 32, {d'Accident
nocturne] j’avais décidé de m’inscrire à la faculté de médecine...»
Vrai?
P. Modiano. – Oui. Je venais d’arrêter mes études de lettres,
j’étais allé rue des Saints-Pères pour me renseigner sur les modalités
d’inscription et j’avais appris qu’il fallait être très calé en
sciences et avoir fait math élém. Ce qui m’attirait dans la médecine,
c’était la précision. Je me disais que ça me forcerait à cesser
de rêver et d’être nébuleux. Il faut trouver un point fixe pour
que la vie cesse d’être un flottement perpétuel. Depuis mon plus
jeune âge, je cherche une discipline pour sortir du marécage.
Ce fut la langue française. Elle décrit très bien, je trouve,
les états crépusculaires. Jérôme
Garcin, Rencontre avec P Modiano, Le Nouvel Observateur, 2 octobre
2003
Pourquoi
Hier ist kein Warum » : Ici, il n'y a pas de pourquoi. Primo
Lévi raconte qu'un gardien SS, dès son arrivée à Auschwitz, lui
enseigna ainsi la loi du camp.
Robert
O. PAXTON, Thèses de l'historien sur l'Occupation allemande.
Dans les années 70, Paxton donna un véritable
coup de fouet à l'historiographie de l'Occupation : La
France de Vichy (Seuil, 1973) et Vichy et
les Juifs (Calmann-Lévy,
1981).
Il
constate le point de rencontre de « deux stratégies d'occupation
convergentes » :
celle des Allemands, qui voulaient faire administrer la France
par les Français par souci d'économie ; celle de
Vichy, qui reposait, d'une part, sur la révolution nationale
qui avait pointé les juifs parmi les responsables désignés
de la défaite et, d'autre part, sur la volonté de « faire
entrer la France dans la Nouvelle Europe contre une amélioration
des conditions de vie des Français ».
Robert
Paxton évoque le « changement important » de
1941-1942, lorsque l'extermination des juifs, y compris en Europe
occidentale, fut décidée. Il campe les accords
Oberg-Bousquet du nom du chef supérieur des SS en France
et du nouveau secrétaire général à la
police française qui, le 2 juillet 1942, scellèrent
la participation de l'administration et de la police française
aux déportations, y compris en zone sud non occupée.
Il rappelle l'obsession vichyste : négocier « davantage
de responsabilités » pour la police et l'administration. « C'est
là l'engrenage fatal », lqui estime que les Allemands
(« 60 000 hommes dédiés
au maintien de l'ordre ») n'auraient pas pu tout faire à eux
seuls. L'historien évoque, bien entendu, les réticences
françaises, lorsque, sous la pression de l'opinion, Laval,
président du conseil, s'oppose, en août 1943, à la
dénaturalisation des juifs demandée par l'Allemagne.
Mais il s'inscrit totalement en faux contre l'idée selon
laquelle, en France, « on aurait proportionnellement sauvé plus
de juifs que dans d'autres pays ». « Le civisme de
beaucoup de Français » excepté, « la
France de Vichy a rendu les juifs plus vulnérables »,
répète-t-il inlassablement, citant les fichiers
français et les lois antijuives qui fixèrent l'exclusion. D'après Jean-Michel DUMAY, Le Monde du 02-11-97
Phrase
sur-réelle
"- On vous définit souvent comme un artiste du vague*,
mais votre phrase, dans ce « café », n'a jamais
été aussi précise, lumineuse. Vous voulez
faire mentir vos exégètes ?
- Quand ils disent que je suis vague, c'est évidemment
bizarre pour moi parce j'ai l'impression que ma phrase est tellement
pauvre que j'ai besoin de m'agripper à la réalité...
Elle en devient... sur-réelle." Entretien
avec Christophe Ono-dit-Biot , 27/09/2007, à l'occasion
de la parution de Dans le café de la jeunesse perdue,-
© Le Point N°1828-
Phrases,
paragraphes, à l'aveuglette*
"Quelle est votre unité première
: la phrase, le paragraphe ?
P.M. La phrase. La première phrase, la plupart du temps.
Mais quand on écrit, on part à l'aveuglette. Pendant
le premier mois, je me sens très souvent découragé,
je me demande si je dois continuer. C'est comme si je conduisais
en plein brouillard, sans rien voir devant moi mais je poursuis
ma route, sans savoir où aller, avec parfois la sensation
ou la crainte de m'être engagé dans une voie sans
issue. Mais ce qui est très bizarre, c'est que, quand j'ai
cette intuition de m'être engagé sur une fausse route,
j'essaie de rattraper la route principale plutôt que de
faire marche arrière. Au lieu d'abandonner, de me dire
: "C'est une fausse piste, il faut que j'arrête, tant
pis", je continue et j'essaie de rattraper la route principale.
Avez-vous connu ce sentiment avec tous vos romans ?
P.M. Oui, tous. Pour certains, il y a peut-être eu une petite
ligne droite... Mais je ne suis pas comme ces écrivains
qui tracent le sillon avec constance et confiance. Il y a toujours
ou presque ce détour et cette sensation, au dernier moment,
d'être comme un trapéziste qui parvient, in extremis,
à rattraper le trapèze qu'on lui a lancé.
Par quel moyen (ou quel miracle) retrouvez-vous le chemin
? Comment rattrapez-vous le trapèze ?
P.M. Par la phrase, justement. Un paragraphe ou une page qui me
semblent catastrophiques le soir peuvent être rétablis
le lendemain matin par une phrase. Ou en supprimant quelque chose.
Mais j'ai, chaque matin, une impression de rattrapage de ce que
j'ai fait la veille. Je n'ai jamais connu cette impression d'écrire
en ligne droite. C'est comme si vous naviguiez en essayant d'éviter
les écueils et que, au dernier moment, vous les contourniez.
Utiliser des blocs de réalité, notamment des noms
propres de gens que j'ai pu croiser, m'aide à effectuer
ce rattrapage. Quelquefois, je cannibalise certains trucs, c'est-à-dire
que je me sers de plusieurs segments qui pourraient chacun être
un roman différent." "Mon Paris
n'est pas un Paris de nostalgie mais un Paris rêvé"
entretien avec François Busnel (Lire), 04/03/2010
Pour que tu ne te perdes pas dans
le quartier
Gallimard,
coll Blanche 2014

Articles
publiés à la parution de l'ouvrage
Entretien
publié sur le site des éditions Gallimard
" Presque rien. Comme une piqûre d’insecte qui
vous semble d’abord très légère.
Du moins c’est ce que vous vous dites à voix basse
pour vous rassurer. Le téléphone avait sonné
vers quatre heures de l’après-midi chez Jean Daragane,
dans la chambre qu’il appelait “le bureau”.
Il s’était assoupi sur le canapé du fond,
à l’abri du soleil. Et ces sonneries qu’il
n’avait plus l’habitude d’entendre depuis longtemps
ne s’interrompaient pas.
Pourquoi cette insistance ?»
-
Toute l’histoire se déclenche à partir
d’une perte, non d’une retrouvaille. Quel rôle
joue la perte par rapport à la mémoire ?
PM - Le roman commence par des sonneries de téléphone.
Le personnage principal - Jean Daragane -, après une longue
hésitation, finit par répondre. Un inconnu lui dit
qu’il a entre ses mains un carnet d’adresses que Daragane
avait perdu. Daragane lui trouve une insistance suspecte et même
un ton de maître-chanteur. La voix de cet inconnu va lui
remettre en mémoire un épisode de son enfance qu’il
croyait avoir oublié et qui aura été déterminant
dans sa vie. D’une manière générale,
la perte avive la mémoire à cause du manque ou du
sentiment d’absence qu’elle provoque. Bien sûr,
la perte d’un être que vous aimiez. Mais quelquefois
la perte d’un objet anodin qui vous était familier
dans le passé : soldat de plomb, porte-bonheur, lettre
que vous aviez reçue, vieux carnet d’adresses…
Cette perte et cette absence vous ouvrent une brèche dans
le temps.
- Plus le narrateur progresse dans son enquête sur son
enfance, moins il comprend… Est-ce une fatalité du
souvenir que d’obscurcir au lieu d’éclairer
?
PM - Jean Daragane en effet semble avoir eu une enfance très
particulière. Mais on pourrait dire aussi que dans tous
les souvenirs d’enfance, il y a une part d’énigme,
créée par le regard de l’enfant lui-même
sur ce qui l’entoure. Au cours de l’« enquête
» que Daragane a poursuivie sur cet épisode de son
enfance, il a observé un autre phénomène
: souvent vos souvenirs sur une période précise
de votre vie ne correspondent pas avec ceux que des «témoins»
ont gardé de vous et de cette même période.
Au point de se demander si la recherche du temps perdu n’est
pas une entreprise vaine, brouillée par l’oubli et
par des souvenirs dont vous finissez par vous demander s’ils
ne sont pas imaginaires.
- Jean Daragane a du mal à composer un récit
cohérent de son propre passé… Serait-ce impossible
d’établir son autobiographie ?
PM - Oui, je crois qu’il est difficile d’être
son propre biographe. L’entreprise autobiographique entraîne
de grandes inexactitudes puisque l’on pèche souvent
par omission, volontairement ou non. Et même si l’on
cherche à être exact et sincère, on est condamné
à une «posture» et un ton «autobiographique»
qui risquent de vous entraver. Je crois que pour en faire une
œuvre littéraire, il faut tout simplement rêver
sa vie – un rêve où la mémoire et l’imagination
se confondent.
-
Entre autres souvenirs remonte celui d’un roman de jeunesse
écrit comme une bouteille à la mer pour retrouver
une femme – un roman pour une unique lectrice, en somme…
PM - Bien sûr, il y a là une certaine ironie. Mais
il m’est souvent arrivé de semer dans mes livres
des noms et des détails - comme des signaux de morse –
à destination de certaines personnes dont les traces s’étaient
perdues. Je savais d’avance qu’elles ne donneraient
pas signe de vie, mais c’est leur silence qui me donnait
envie d’écrire.
-
Ne serait-ce pas Jean Daragane qui fabrique lui-même
du mystère à partir d’événements
bien ordinaires ?
PM -Une phrase m’a beaucoup frappé sans que je me
souvienne de son auteur : « Elle était mystérieuse
comme tout le monde. » Oui, je crois que les regards des
enfants et des écrivains ont le pouvoir de donner du mystère
aux êtres et aux choses qui, en apparence, n’en avaient
pas.
-
Vouloir éclaircir le mystère ne conduit-il pas
à une inévitable déception ?
PM - Il ne faut jamais éclaircir le mystère. De
toute façon, un écrivain ne le pourrait pas. Et
même s’il cherche à l’éclaircir
de manière méticuleuse, il ne fait que le renforcer.
Samuel Beckett disait de Proust, qui ne faisait pratiquement rien
d’autre que d’expliquer ses personnages : «Les
expliquant, il épaissit leur mystère.»
Entretien réalisé avec Patrick Modiano à
l'occasion de la parution de Pour que tu ne te perdes pas dans
le quartier .
© Gallimard 2014
Pour
que tu ne te perdes pas dans le quartier
(A l'Origine de ce roman)
<< -Vous souvenez-vous de la toute première idée
qui a conduit à ce nouveau roman ?
PM -J'ai retrouvé un jour une note que j'avais prise très
jeune, à l'âge de 12 ou 13 ans, dans laquelle je
disais déjà vouloir essayer d'écrire quelque
chose qui soit un mélange du Grand Meaulnes et du roman
noir à la Peter Cheyney. Cela à partir d'un moment
trouble de mon enfance, quelques années plus tôt,
où je vivais dans les environs de Paris, en Seine-et-Oise,
dans une banlieue encore très campagnarde, avec dans les
environs un château en ruine qui évoquait le roman
d'Alain-Fournier. Mes parents étaient absents, les personnes
chez qui j'habitais étaient un peu louches, le climat était
étrange. Dans un livre qui s'appelle Remise de peine, il
y a vingt-cinq ans, j'avais déjà évoqué
ces instants.>> Télérama.
Entretien avec Nathalie Crom, 01/10/2014
Préfaces
rédigées par P M
-
La Guerre des cancres, un lycée au cœur de la Résistance
de Bertrand Matot. Perrin, septembre 2010
Premier arrondissement,
Paris
Lieux, noms,
reconnaissances. Le Palais de Justice ; la Sainte-Chapelle
; la Conciergerie ; Le Louvre ; Le Palais Royal ; les
rues de Valois, du Beaujolais et de Montpensier ; le Conseil
d'État ; le Théâtre Français ; le Conseil Constitutionnel sur
la rue de Montpensier. La Place Vendôme qui accueille le Ministère
de la Justice, l'hôtel du Crédit Foncier, l'ancien hôtel de
l'Etat-Major, l'hôtel Ritz (ancienne demeure du financier Crozat);
les grands joailliers, au centre, la Colonne Vendôme , à la
gloire de l'Empereur, gainée de bas-reliefs en bronze. La Place
des Victoires avec au centre, une statue du Roi-Soleil due au
monégasque Bosio. La Place Dauphine, dédiée au futur Louis
XIII alors Dauphin, reliée au Pont-Neuf. Le Forum des Halles
vaste quadrilatère des anciennes halles Baltard.Rues J.J.-Rousseau,
Saint-Honoré, du Louvre et du Jour. Mairie du Ier arrondissement,
place du Louvre. Rue des Bourdonnais ; grande Poste du Louvre,
rue du Louvre ; Cour des Comptes rue Cambon; hôtel de la Caisse
d'Épargne, rue du Coq-Héron; hôtel de la Banque de France ;
théâtre du Palais-Royal; théâtre du Châtelet ; fontaine
des Innocents transportée sur le Forum des Halles; fontaine
du Trahoir ; rue de l'Arbre-Sec ; fontaine du Palmier ; place
du Châtelet; statue de Jeanne-d'Arc ; place des Pyramides ;
Pont-Neuf ; quai de la Mégisserie/place Dauphine ; Passerelle
des Arts ; Pont du Carrousel, quai du Louvre/quai Malaquais,
; Pont-Royal ; quai des Tuileries/quai Voltaire
; Passerelle de Solferino, quai des Tuileries/quai d'Orsay.
Hôtel Lulli, 47 rue Sainte-Anne ; hôtel de la Poste, rue du
Jour ; hôtel Tannevot 18ème, rue Cambon. Rue Bertin-Poirée
; rue des Bons-Enfants ; rue des Deux-Boules quai de l'Horloge,
rue Jean Lantier, rue des Lavandières-Sainte-Opportune
; rue des Moulins, quai et rue des Orfèvres ; la place
Dauphine; rue de Rivoli ; rue Saint-Germain-l'Auxerrois ; rue
Saint-Honoré, ; l'hôtel Meurice, le restaurant Prunier ; la
Samaritaine ; les Grands Magasins du Louvre, place du Palais-Royal/Rivoli
; les hôtels Saint-James et d'Albany ; l'hôtel Bristol ; les
restaurants du Grand-Véfour et du Mercure Galant , de
Pharamond , du Chien-qui-Fume, du Pied-de-Cochon, de l'Escargot-Montorgueil
; rue Etienne-Marcel ; rue Saint-Denis ;rue Montmartre
; rue Gomboust, de l'ancienne épicerie, 9 rue Pierre-Lescot.
Église Saint-Germain-l'Auxerrois ; Église Saint-Leu-Saint-Gilles
; Église Saint-Eustache contre le Forum des Halles - Église
Saint-Roch ; Église de l'Assomption ; Sainte-Chapelle,
insérée dans le Palais de Justice ; Chapelle de l'Oratoire
; Chapelle des Orfèvres ; Ancien couvent des Feuillants ; Crypte
de Sainte-Agnès ; Ancien cimetière des Saints-Innocents.
Musée du Grand Louvre ; Musée de l'Orangerie ; Musée des Arts
décoratifs ; Musée de la Mode et du textile, 107 rue de Rivoli
; Musée de la Publicité ; Musée du Jeu de Paume ; Centre national
des Arts plastiques ; Pavillon des Arts ; Parc océanographique
Cousteau, Forum des Halles : - Musée de l'Holographie ;
Musée du Barreau de Paris ; Musée de la Presse ; Musée
de l'Optique ; Musée de la Mairie de Paris ; Réunion des
Musées nationaux.
Presque
Une littérature du presque, de l'à-peu-près, du non cerné,
de l'entre aperçu, du flou,non ?
Prisonnier
<< Pendant ces quinze dernières années, je
m’étais senti prisonnier des autres et de moi-même,
et tous mes rêves étaient semblables : dans des rêves
de fuite, des départs en train, que malheureusement je
manquais. Je n’atteignais jamais la gare. Je me perdais
dans les couloirs du métro, et sur le quai de la station,
les rames ne venaient pas. >> D.P.O., p.139.
PRIX
NOBEL DE LITTERATURE 2014
Commentaire
de l'Académie Nobel : "Modiano a été
récompensé pour "l'art de la mémoire
avec lequel il a évoqué les destinées humaines
les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'Occupation".
Patrick
Modiano, Prix Nobel de Littérature 2014
Dans
quelles circonstances il a appris son prix Nobel
" Quand je l'ai appris, j'étais dans la rue. J'étais
un peu surpris, c'était inattendu, alors j'ai continué
à marcher pour être dans l'ambiance. Bien sûr
c'est un peu compliqué. Quand on écrit, on est habitué
à une sorte de solitude. Ma première pensée
: c'était comme si je me dissociais. Comme le dédoublement
de quelqu'un qui s'appelait comme moi. Je savais que j'étais
sur certaines listes de favoris, mais tout cela était un
peu abstrait." Conférence de Presse
du jeudi 9 octobre 2014, dans les locaux de Gallimard, peu après
l'annonce du Prix Nobel de littérature.
Prisonnier
de son registre
"Dans mes lectures, je suis allé toujours
vers des univers qui m’étaient étrangers,
que je ne connaissais pas – les grands romans russes ou
anglais, par exemple, qui se situent à la campagne. Mais
c’est vrai qu’on regrette parfois de n’avoir
pas assez observé les choses. Ou de ne pas avoir écrit
sur elles. Ainsi, adolescent, alors que j’allais de pensionnat
en pensionnat, j’ai regardé de près la vie
se dérouler dans des villes de province, telles qu’elles
n’existent plus aujourd’hui. J’aurais pu écrire
là-dessus. Mais je ne l’ai pas fait. J’aurais
dû pour cela adopter sans doute une forme romanesque plus
classique, disons à la Mauriac. Mais on est un peu prisonnier
de son registre, et de son enfance, de ce qu’on a vu, des
lieux où on a vécu." Télérama.
Entretien avec Nathalie Crom, 1/10/2014
Projet de livre
"j'avais essayé d'écrire un roman qui se passe dans une
ville sud-américaine et je n'y arrivais pas vraiment. Je ne savais
pas très bien si c'était à Mexico ou dans une autre ville. C'était
un couple qui arrivait dans cette ville, le type ne connaissait
pas la ville et puis la fille disparaissait, c'est-à-dire qu'elle
le semait et lui se retrouvait dans une ville totalement étrangère.
J'avais essayé de faire ça et j'avais acheté des plans de villes
sud-américaines, notamment Buenos-Aires ou Mexico, mais je m'étais
aperçu qu'en fait c'était assez compliqué de faire quelque chose
sur un endroit où on n'avait jamais été, alors j'avais abandonné.
Mais ce qui est bizarre, c'est que lui, il ait pensé à la même
chose..." Synopsis
10, entretien avec Judith Louis à propos de l'adaptation de Dimanches
d'Août.
Promenade
"Je n’écris pas plus d’une heure par jour.
Après, la tension se relâche et je préfère
arrêter. Mais je pense à mon roman toute la journée.
Marcher est une manière de réfléchir. Et
il y a beaucoup d’idées qui me viennent au cours
d’une promenade, provoquées par ce que je peux voir
de bizarre." La Tribune de Genève,
entretien avec Pascale Frey, 27-02-10
Proust, juif
!
"Ils ont tous oubliés que je suis juif. Moi pas."
Ces paroles de Marcel Proust sont rapportées par Emmanuel Berl
lorsqu'en 1976, il est interrogé par PM dans ce livre d'entretiens
"Interrogatoire"
(Gallimard, coll Témoins).
PM tient un témoin de première main reçu, comme beaucoup, le soir
dans l'appartement du boulevard Haussmann. Berl évoque la figure
de Marcel Proust, son importance, leur différend sur la conception
de l'amour, les lettres, (dont l'une de 70 pages), reçues dans
les tranchées et perdues.
Province
(la), hasards de la naissance*
"Je crois que l'on écrit en fonction de l'endroit,
du milieu, de l'année de sa naissance. L'écriture
est très déterminée par les hasards de la
naissance. J'ai le regret de ne pas avoir choisi pour terreau
un environnement comme certaines villes de province que j'ai pu
connaître adolescent. Il y avait une atmosphère particulière
à ces petites villes de province, que j'ai connues parce
que je me suis souvent retrouvé interne dans un collège
là-bas. Maintenant, c'est trop tard. Je suis sûr
qu'il aurait pu y avoir un écrivain français du
niveau de Faulkner pour s'emparer de Bordeaux, par exemple. Bon,
il y a eu Mauriac... Mais Mauriac n'a peut-être pas été
assez loin. Même chose pour Lyon : il n'y a pas eu le grand
écrivain faulknérien sur Lyon. Or ces villes le
méritent. Quelquefois j'ai regretté de ne pas être
cet écrivain." "Mon
Paris n'est pas un Paris de nostalgie mais un Paris rêvé"
entretien avec François Busnel (Lire), 04/03/2010
Psychanalyse
1
" La
psychanalyse ressemble parfois à un roman policier : quelque
chose est caché qu’on ne veut pas, ou qu’on
ne peut pas voir, alors on attend de découvrir ce qui va
surgir du processus analytique. C’est assez proche de l’enquête.
J’ai été frappé aussi par certaines
notions comme celle des souvenirs écrans, par lesquels
on peut dissimuler un souvenir trop pénible en lui en substituant
un autre, moins difficile à vivre. Mais il s’agit,
là encore, d’un regard de romancier – la psychanalyse
n’est pas liée pour moi à l’idée
de thérapie. Par ailleurs, même si des écrivains
se sont fait psychanalyser – à commencer par Raymond
Queneau, dont j’ai été très proche
–, il me semble, moi, que celui qui écrit a besoin
que subsiste une certaine opacité. Besoin de ne pas comprendre
tout à fait. Comme s’il était dans une sorte
de demi-sommeil : si on le réveille, ça risque de
s’évanouir." Télérama.
Entretien avec Nathalie Crom, 1/10/2014
Psychanalyse
2 / Ecriture* (dimenssion inconsciene de)
<< - Vous parlez beaucoup de la dimension inconsciente*
de l'écriture...
PM - Oui, c'est un peu comme un rêve éveillé
ou un demi-sommeil... Je m'aperçois qu'il y a des choses
qui reviennent, de façon obsessionnelle. Ça m'angoisse
un peu. Un psychanalyste trouverait sans doute là matière
à interprétation... En ce qui me concerne, je ne
veux pas trop creuser. Ce serait un peu comme si on réveillait
un somnambule, je n'en ai pas très envie.
- La psychanalyse ne vous a jamais tenté ?
PM - Pour moi, ce serait comme une intrusion. Une radiographie
de mon inconscient dont j'aurais peur qu'elle mette tout à
plat. Que ça m'assèche, que ça brise l'équilibre
un peu fragile dans lequel se passe l'écriture pour moi.
Donc, non, je n'ai jamais été tenté par la
cure analytique. Je me demande d'ailleurs si je ne me serais pas
senti plus retors que le psychanalyste. Je ne suis pas non plus
familier de la théorie analytique, même si certaines
notions me fascinent, comme celle de souvenir-écran. Ces
notions peuvent être romanesques, on peut presque s'appuyer
sur elles pour écrire.>>
Entretien avec Maryline Heck, Magazine Littéraire, n°
490, octobre 2009
|