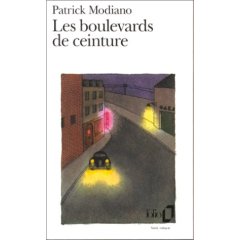Balzac
A la question d'un journaliste : - Quel est le livre - s'il
y en a un - qui reste sur votre table de chevet depuis des années
et qui vous nourrit ?, il répond
- l y a beaucoup de livres, mais, depuis l'adolescence, Balzac
a toujours été présent : « Les illusions
perdues », « La fille aux yeux d'or », «
Madame Firmiani »
Romanesque absolu ? fluidité descriptive ? cosmogonie
littéraire ?... Une oeuvre si loin, si proche...
Balzac
et Modiano Les farce nocturnes : Balzac et Modiano
par Donato Sperduto. Essai paru dans "Lendemains",
2004, n°114/115,pages 226/236.
Baptême
En 1950, il passait des vacances prolongées à
Biarritz chez une amie de la famille avec son frère Rudy
et celle-ci prit la liberté de les faire baptiser à
l’église Saint-Martin. Livret de famille
porte la trace de cet épisode. L’extrait du registre
de baptême qui y est reproduit, c’est le sien, le
nom en moins. Modiano n’en a gardé qu’un
souvenir : la grande auto blanche décapotable de son
parrain garée devant l’église. "Un
baptême de hasard. Qui en avait pris l’initiative
?"
Klaus
Barbie devant les assises du Rhône L'histoire d'un SS
exemplaire,
par Jean-Marc Theolleyre
<< Lorsque Klaus Barbie arrive à Lyon en novembre
1942, il a vingt-neuf ans. Depuis le 20 avril _ date anniversaire
de Hitler, précisera-t-il _ il a le grade de SS Untersturmführer,
c'est-à-dire rang de sous-lieutenant. Une note de ses
supérieurs le présente alors " comme un chef
SS qui va droit au but et qui aime l'action ". Cette même
fiche lui accorde " un don marqué pour le travail
d'information et dans le domaine criminel " et porte déjà
à son crédit " le démantèlement
de nombreuses organisations ennemies ". Autant de raisons
pour considérer que " du point de vue caractère
et opinion c'est une personne sur laquelle il est permis de
compter ". Ces brevets de confiance sont mérités,
fondés sur dix années déjà d'un
engagement sans réserve au service du national-socialisme,
et qui doit lui apparaitre naturel.
Il est né le 25 octobre 1913 à Bad-Godesberg,
non loin de Bonn. Son père et sa mère sont l'un
et l'autre instituteurs. Le premier, combattant de la première
guerre mondiale, mourra des suites d'une blessure au front,
et l'on verra dans ce fait une raison au ressentiment qu'aurait
éprouvé déjà ce fils envers la France
et les Français. Pourtant les années d'enfance
sont banales. Après des études classiques dans
un lycée de Trèves et un diplôme d'"
Abitur " équivalent du baccalauréat, le jeune
Klaus Barbie aurait souhaité faire son droit à
l'université de Bonn ou devenir médecin. C'est
le décès de son père, privant la famille
de ressources suffisantes, qui, assure-t-il, l'oblige à
renoncer. Et le voici à la naissance du IIIe Reich engagé
à l'Arbeitdienst (service du travail), organisation paramilitaire
mêlant étudiants et travailleurs manuels. Il construit
des digues.
Cependant, dès 1933, l'année de ses vingt ans,
il a adhéré aux Jeunesses hitlériennes.
Chef de patrouille, il commande un groupe de cent-vingt garçons
de dix à quatorze ans. Il fréquente un responsable
nazi à la section de Trèves. C'est là qu'il
rencontre un membre du Sicherheitsdienst, le service de sécurité
(SD). Le SD embauche. Il recherche des jeunes gens bacheliers
disposés à travailler dans ses rangs. Il faut
des capacités physiques, une bonne présentation.
Il faut, bien sûr, aussi être de " pure race
", établir cette " filiation aryenne "
qui fait partie du dogme. Klaus Barbie remplit les conditions.
S'il a soutenu qu'il ne voyait là, à l'époque,
qu'une bonne occasion de devenir fonctionnaire avec les garanties
d'une sécurité de l'emploi, il a aussi admis que
l'idée de faire du renseignement, de l'espionnage, séduisait
bien le jeune homme qu'il était.
Le voila donc candidat et candidat agréé. Le 1er
octobre 1935, il prête, avec d'autres à Berlin,
le serment exigé. C'est celui de la SS. Durant deux ans,
il reçoit la formation exigée avant d'être
affecté à la direction régionale du SD
de Düsseldorf. Elle est dirigée alors par un homme
qui fera son chemin, c'est-à-dire Helmut Knochen, que
l'on retrouvera de 1942 à 1944 adjoint à Paris
du général SS Carl Oberg, chef suprême de
la police allemande en France occupée.
En cette même année 1937, Klaus Barbie adhère
au Parti national socialiste ouvrier allemand (NSDAP), le parti
unique de l'Allemagne hitlérienne. Voilà bouclée
la boucle de l'engagement total, inconditionnel. C'est à
la même époque que deux autres futurs responsables
de la SS, Eugen Hagen et Kurt Lischka, adhèrent aussi.
SS
exemplaire
La
carrière suit son cours. Un rapide service militaire
de trois mois en 1938, des fiançailles suivies d'un mariage
le 25 avril 1940 à Düsseldorf, avec pour témoins
deux collègues SS, et voilà le SS Untersturmführer
Klaus Barbie dans la guerre. Son dossier confirme la confiance
qu'il inspire : camarade irréprochable, des performances
dans le service excellentes, un comportement de SS exemplaire,
tant dans le service qu'en dehors. Et en point d'orgue ceci
: " Son opinion relative à la conception du monde
nazi est considérée comme affirmée. "
Plus tard, en 1943, puis en 1944, suivront les distinctions
afférentes : médaille du mérite militaire,
croix d'argent de seconde classe, croix de fer de seconde classe.
La
guerre éclair de 1940 donnera à Klaus Barbie une
première occasion d'action dans l'Europe occupée.
Dès le mois de mai de cette année, il est affecté
à l'Einsatz-Kommando (EK) _ groupe d'intervention de
la police de sécurité, _ d'Amsterdam. Il assure
n'avoir eu là pour mission que de rechercher des renseignements
sur des questions de politique intérieure et extérieure,
en clair sur les partis politiques et les mouvements de résistance.
Il admettra pourtant des " collaborations occasionnelles
" avec la section des affaires juives, dont il n'a pas
gardé de souvenirs précis. Pour le reste, s'il
lui est arrivé de rechercher des renseignements concernant
des juifs, il ne pouvait s'agir que de personnes coupables d'
" actions illégales ". Ainsi s'esquisse sa
défense.
C'est
en novembre 1942, au lendemain du débarquement allié
en Afrique du Nord, que Klaus Barbie, après un passage
à Gex, arrive à Lyon. Dès le 11 novembre
1942 en effet, les troupes allemandes sont entrées dans
la partie de la France qui jusque-là, en application
de la convention d'armistice de 1940, était " zone
libre ". En même temps, sont mis en place les services
de police nazis. C'est une organisation complexe élaborée
au fil des ans.
Avant
l'arrivée de Hitler au pouvoir, elle était subdivisée
en deux grandes branches : l'Ordnungspolizei (ORPO) chargée
du maintien de l'ordre et la Sicherheitspolizei (SIPO) ou police
de sécurité. Dans cette dernière, deux
services : la Kriminal Polizei (Kripo) équivalent de
la police criminelle, et la Staatspolizei (Stapo), appelée
plus fréquemment Geheime Staats Polizei (Gestapo).
En
1933, les nazis ajoutent dans ce système le Sicherheitsitdienst
ou SD, service de sécurité du parti. Le 17 juin
1936, une ordonnance réunit l'ensemble de ces services
pour les placer sous la seule autorité de Himmler, reichsführer
SS et chef suprême de la police. En même temps,
la Sipo-SD, groupant SD, Stapo et Kripo, se voit plus particulièrement
placée sous la direction du général SS
Reinhardt Heydrich. Elle va devenir en 1939 le Reichsicherheitshaupamt
(RSHA) ou direction de la sécurité du Reich. Peu
après, tous les membres de la Gestapo et de la police
criminelle sont obligatoirement inscrits aux SS avec des grades
équivalents au poste qu'ils occupent.
Lutte
sans merci
Comment
se concrétise le système en France après
l'armistice de 1940 ? Les pouvoirs de police en zone occupée
vont être donnés, dans un premier temps, à
l'autorité militaire, qui disposera pour le maintien
de l'ordre de la Feldgendarmerie _ gendarmerie de campagne _
et d'une police secrète de campagne.
En
fait dès juin 1940, le RSHA de Heydrich installera à
Paris un Sonderkommando SS ou " groupe spécial "
à la tête duquel apparait Helmut Knochen. S'il
dépend théoriquement du commandement militaire,
il ne tarde pas à intervenir de plus en plus directement
et à obtenir finalement, avec l'appui de Heydrich à
Berlin et de Otto Abetz, ambassadeur à Paris, son autonomie
et un renforcement de ses effectifs. Sa puissance est consacrée,
le 11 mars 1942, avec la nomination à Paris d'un chef
des SS et de la police en France, Carl Albert Oberg, dit von
Oberg.
Dès
son arrivée, la Sipo-SD (police d'ordre, police de sécurité
et service de renseignements) est renforcée. Knochen
en devient le chef avec le grade de colonel et le titre befehlshaber
der Sipo-SD ou " BDS ". Il a sous ses ordres tous
les kommandeurs du Sipo-SD, ou KDS, installés eux au
siège de chaque préfecture régionale, où
ils dirigent leurs einsatz-kommando respectifs. Ils seront treize
: ceux de Paris, Nancy, Dijon, Orléans, Rouen, Rennes
et Bordeaux dès 1940, auxquels s'ajouteront à
partir de novembre 1942 ceux de Vichy, Limoges, Marseille, Montpellier,
Toulouse et Lyon. Au total, deux mille policiers spécialistes
du renseignement mais ayant tous en commun le même objectif
: une lutte sans merci contre " les ennemis du Reich ".
Barbie
est l'un de ceux-là, rien de moins, rien de plus. Il
vient d'être nommé obersturmführer, lieutenant.
Il va diriger à Lyon la section IV, la plus importante
des six qui composent le service. Si elle est chargée
de la " répression des crimes et délits politiques
", elle comporte cinq sous-sections, dont la IV B dite
" anti-juive ". Dans les milieux de la résistance
et de la clandestinité, elle sera très vite redoutée.
Si Barbie se trouve hiérarchiquement soumis à
l'autorité du commandeur le capitaine Hollert, auquel
succédera le lieutenant-colonel Werner Knab, c'est de
lui que se souviendront toujours ceux qui eurent le malheur
de l'arrestation et l'ont tenu alors pour le véritable
chef de ce qu'on appela " la gestapo de Lyon ".
De
ce que fut son activité durant ces deux années
_ novembre 1942, août 1944 _ tant à Lyon et dans
les environs immédiats que dans les dix départements
que contrôlait son einsatz-kommando, les deux procès
par contumace de 1952 et de 1954 ont présenté
un tableau effrayant. Arrestations, tortures, pillages, exécutions
massives d'otages, déportations ont alors été
énumérés. Il est évident que Klaus
Barbie ne fut pas le seul et unique auteur de ces crimes alors
jugés comme crimes de guerre. Des Allemands, ses collaborateurs
immédiats tel Steingritt, y ont eu leur part. Des Français
aussi, dont Francis André, le chef local du Parti populaire
français (PPF), des miliciens. Ceux-là, arrêtés
en leur temps, condamnés, ont chargé Klaus Barbie,
mais aussi des témoins, des rescapés qui tous
ont insisté sur son zèle et surtout sur sa propension
à la violence, à la torture infligée systématiquement,
qui lui valut le surnom du " boucher de Lyon ". De
ces faits-là il ne peut juridiquement plus être
question. Plus de vingt ans se sont écoulés depuis
les condamnations à mort par contumace qu'ils ont entrainées
contre Klaus Barbie, ce qui fait que les peines sont prescrites.
Des
crimes ignorés
Pour
autant, d'autres faits avaient échappé à
la justice de l'époque. C'est parmi eux qu'il convenait
de retenir, contre un Barbie enfin capturé, ceux qui
pouvaient être qualifiés de crimes contre l'humanité,
c'est-à-dire ceux qui demeurent imprescriptibles et dont
les auteurs doivent répondre en dépit d'une ancienneté
qui ne permet pas l'oubli. En définitive l'ancien SS
se trouve ainsi accusé : 1. De la liquidation du comité
lyonnais de l'Union générale des Israélites
de France (UGIF) après une rafle opérée
le 9 février 1943, 12, rue Sainte-Catherine à
Lyon, suivie de la déportation de quatre-vingt six personnes.
2. De la déportation de 41 enfants et de 5 adultes de
la colonie d'enfants juifs établie à Izieu dans
l'Ain, tous arrêtés le 6 avril 1944. 3. De la déportation
d'environ 650 personnes embarquées le 11 août 1944
dans le dernier convoi qui quitta Lyon à destination
des camps d'extermination. 4. De la mort, précédée
de tortures, du professeur Marcel Gompel ainsi que d'une série
de déportations individuelles en 1943 et 1944. 5. De
la déportation, suivie de la mort, de Georges Lesèvre
et de son fils Jean-Pierre, ainsi que de l'envoi en déportation
de Mme Lise Lesèvre, leur épouse et mère,
qui échappa à la mort.
Pour
être précis, il est reproché à Klaus
Barbie d'avoir commis ces crimes contre l'humanité "en
prenant part à l'exécution d'un plan concerté
pour réaliser la déportation, la réduction
en esclavage et l'extermination de populations civiles ou des
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux,
se rendant complice, dans les faits qui ont préparé
ou facilité leur action, des auteurs des meurtres"
ou, en cas de survie, en déportant lui-même et
en se rendant coupable de séquestration supérieure
à un mois.
Ces
faits, Klaus Barbie les nie, ou pour le moins assure n'en n'avoir
gardé aucun souvenir. Sa défense, comparable en
cela à celle des accusés allemands jugés
dans les années 50, consiste à dire que sa mission
à Lyon était limitée à une activité
de militaire chargé d'infiltrer la Résistance
et travaillant en liaison étroite avec l'armée
de terre allemande qu'il s'agissait uniquement de protéger.
Il n'aurait donc pas eu à se mêler des opérations
contre les juifs, qui dépendaient du seul Eichmann et
de l'Office IV que celui-ci dirigeait à Berlin. Cependant
n'y avait-il pas à l'einzats-kommando de Lyon une sous-section
dite "antijuive" et dépendant de celle-là
même dont il était le chef ? Certes, mais selon
lui, c'était un kommando spécial, disposant d'une
certaine autonomie. Ses membres venaient spécialement
de Paris ou de Berlin et, a-t-il glissé, des ordres arrivaient
aussi de Vichy, qui avait son propre organisme chargé
des questions juives. "Si c'est un juif..."
Ainsi,
la rafle de la rue Sainte-Catherine n'éveille aujourd'hui
en lui aucun souvenir. Il ne s'y trouvait pas. Il ne lui appartenait
pas non plus de donner des ordres pour cela. A la déposition
d'un témoin qui affirme l'avoir vu et entendu dire à
ceux qui interrogeaient et frappaient : " Si c'est un juif,
vous pouvez faire tout ce que vous voulez ", il rétorque
: " Pourriez-vous après quarante ans, reconnaitre
quelqu'un ? Savait-il
du moins ce qu'étaient les camps de concentration nazis
et la " solution finale " préconisée
dès 1941 à la conférence de Wansee près
de Berlin ? Non. De cela il ne savait rien. Il pensait que les
déportés étaient simplement internés
et qu'il fallait arrêter les juifs qui vivaient en Allemagne
comme tous les autres étrangers avec lesquels le IIIe
Reich était en guerre. La réalité, c'est
le procès de Nuremberg qui la lui a révélée.
Un témoin l'a entendu dire publiquement : " Déporté
ou fusillé c'est la même chose. " Il réplique
que l'expression n'est pas de lui, qu'elle a été
attribuée à d'autres SS à l'occasion d'autres
procès.
S'il
y a ses dires, il y a aussi ses écrits. Alors qu'il se
proclame étranger tant à l'affaire de la rue Sainte-Catherine
qu'à celle des enfants juifs d'Izieu, il s'est vu opposer
non seulement des témoins, mais aussi deux documents
signés de lui. Ce sont deux rapports adressés,
l'un le 11 février 1943, surlendemain de la rafle à
l'UGIF, l'autre le 6 avril 1944, jour de l'affaire d'Izieu à
Helmut Knochen à Paris.
L'un
et l'autre décrivent les faits, disent le nombre de personnes
arrêtées, annoncent leur " acheminement ",
et surtout précisent que les opérations ont été
menées de Lyon, ce qui exclurait l'arrivée d'un
kommando extérieur. Klaus Barbie et Me Vergès
ont déjà contesté l'authenticité
de ces documents. Mais Knochen, à qui ils ont été
présentés et qui vit encore en Allemagne, les
a reconnus vrais. Ils ne furent d'ailleurs pas contestés
par la défense au procès de Lischka, Hagen et
Heinrichsohn devant le tribunal de Cologne. Quant au fait qu'ils
aient été établis au recto de cartes de
la Grande-Bretagne, il a pu être rétorqué
et prouvé que ces cartes, devenues sans objet après
le renoncement par Hitler à une invasion de l'Angleterre,
furent utilisées par les Allemands comme papier à
cause de la pénurie. C'est pourquoi l'accusation et les
parties civiles pensent tenir là des éléments
de preuve capables, plus encore que des témoignages émouvants
ou passionnants, de convaincre les jurés.>>
Jean-Marc
Theolleyre , © Le Monde, 5 Mai 1987
Maurice BARRES
Ecrivain français (1862-0923) qui fut le défenseur de valeurs morales nationalistes. Il est cité dans La PLace de l'Etoile.
Emmanuel
BERL
Emmanuel
BERL (Le Vésinet, 1892 — Paris, 1976).
En 1976 Patrick Modiano publie une série d'entretiens avec
Emmanuel Berl pour écouter ce "témoin capital"
qui a observé et commenté les trois premiers quarts
du XXè siècle. Interrogatoire avec Patrick Modiano
suivi de "Il fait beau, allons au cimetière".
« Mon passé m'échappe, dit-il. Tout devient
ou fantôme ou mensonge. » La mémoire est «
pareille à ces vieilles personnes exaspérantes qui
détiennent le secret dont on a besoin (... ) mais qui radotent
».
C'était l'ami de Bergson et de Cocteau, de Drieu La Rochelle
et de Léon Blum. Il était essayiste, historien,
mémorialiste, romancier et philosophe, et son oeuvre a
passionné Nimier, Malraux, Aragon et Camus. De la guerre
de 1914, qui le rendit à jamais pacifiste, à sa
mort, en 1976, " il a tout connu et s'est passionné
pour tout ", écrit Bernard Morlino dans les Tribulations
d'un pacifiste, la biographie qu'il lui a consacrée il
y a quelques années.
" Éminence grise de la politique et des lettres ",
juif, grand bourgeois et homme de gauche, Berl a tout connu de
Bergson à Proust (ils étaient apparentés),
d'Anna de Noailles à Colette, de Daniel Halévy à
Céline, de Drieu à Barbusse, de Saint-John Perse
à Marcel Aymé, d'Édouard Herriot à
Jaurès, Blum et Mitterrand. Dans les Derniers Jours comme
dans Marianne (ce chef-d'œuvre de la presse) ou dans Pavés
de Paris, il fut, " la peur au ventre d'être en retard
sur les événements ", l'homme des combats opiniâtres
et ardents : cause européenne, immigration, égalité
politique et sociale entre femmes et hommes, hostilité
sans faiblesse à l'endroit des nationalismes et des bellicismes.
Emmanuel
BERL (évocation lors d'un entretien avec Philippe Lançon)
«Il nous envoyait, ma femme et moi, acheter
des cigarillos Panthère», se souvient Patrick Modiano.
En 1976, Patrick Modiano publie un livre avec Emmanuel Berl :
Interrogatoire (Témoins/Gallimard). Berl a 83 ans, il va
mourir, il est vif et raconte sa vie. Modiano découvre
avec lui que pour durer, il faut «garder toujours une certaine
curiosité et une certaine innocence.» Un texte de
Berl suit ces entretiens : Il fait beau, allons au cimetière
. «Berl préférerait parler de l'avenir, écrit
Modiano dans la préface. Il n'a pas de chance avec moi,
lui qui est beaucoup plus sensible à l'espérance
qu'à la nostalgie.» Trente ans ont passé.
Pour Libération , l'auteur de Remise de peine a bien voulu
répondre par écrit à quelques questions sur
l'auteur de Sylvia. Patrick Modiano est exécuteur testamentaire
d'Emmanuel Berl. Il publie en octobre, chez Gallimard, Dans le
café de la jeunesse perdue .
- Berl et vous, ça a commencé comment ?
Il avait lu mon premier livre, La place de l'Etoile , et il avait
voulu me connaître parce qu'il avait été très
touché que je cite, dans ce livre, le nom de son cousin
Henri Franck, un jeune poète, mort à 23 ans, qui
avait été l'un des premiers auteurs édités
par Gallimard et pour lequel il avait une immense admiration.
- Par quel livre l'avez-vous découvert ? Dans quelles
circonstances ?
Je l'ai découvert à 17 ans, à la bibliothèque
municipale de Saint-Lô. Deux de titres de lui avaient attiré
mon attention : Mort de la Morale Bourgeoise et Mort de la Pensée
Bourgeoise .
- Pouvez-vous décrire quel homme il était, faire
son portrait ?
Sous un aspect un peu hurluberlu et «savant cosinus»,
il était extrêmement attentif aux autres.
- Un souvenir de lui qui vous reste plus que d'autres ?
Dès que Mireille avait le dos tourné, il nous envoyait,
ma femme et moi, acheter au tabac de la rue de Richelieu une boîte
de petits cigarillos Panthère.
- Un défaut de lui qui vous reste plus que d'autres
?
Je regrette qu'il ne m'ait pas assez parlé de sa seconde
femme Suzanne Muzard qu'il avait connue à 33 ans dans un
bordel et qui était encore vivante quand je voyais Berl.
Elle était née à Aubervilliers dans une famille
d'ouvriers. Elle était en même temps la femme de
Berl et la maîtresse d'André Breton. C'était
une femme exquise et intelligente. Un jour, Berl lui a écrit
: «A Suzanne, sans laquelle je ne me serais jamais débarrassé
de la pensée bourgeoise.»
- Qu'y a-t-il de Proust en lui ?
Je crois qu'il était plus ou moins cousin de Proust. Il
m'avait expliqué qu'à quinze ans, il assistait à
des soirées chez une vieille dame qui devait être
la tante de Proust. Cela s'appelait : les bals blancs d'Adèle
Weil.
- Quels détails vous ont marqué, là où
il vivait ?
Sur le mur, au-dessus de son lit, était accrochée
la seule des nombreuses lettres que lui avait écrites Proust
pendant que Berl était au Front, en 1916 (1). Les autres
lettres s'étaient perdues dans la boue des tranchées.
- On a dit qu'il était élégant. Comment
décririez-vous cette élégance ?
Une élégance très particulière de
ceux qui ont été enfants ou jeunes gens avant la
guerre de 14 dans la grande bourgeoisie et que l'on retrouve chez
Léon Blum.
- Quelles sont pour vous ses qualités d'écrivain
?
La limpidité.
- Un livre ou un texte de lui que vous aimez particulièrement
? Pourquoi ?
Sylvia et Présence des morts, parce qu'il ne raisonne plus
et qu'il est au plus près de lui-même dans ces livres.
- Vous a-t-il fait découvrir ou aimer un autre écrivain
?
J'étais quelquefois étonné qu'il partage
mon admiration pour certains écrivains qui me semblaient
très éloignés de lui. Par exemple, Malcolm
Lowry.
- Quand on vous dit : «C'est celui qui a écrit
les discours de Pétain», que répondez-vous
?
Des membres du gouvernement repliés en catastrophe à
Bordeaux après la Débâcle, lui ont demandé
de corriger deux discours de Pétain, ceux du 23 et 25 juin
que 99 % des Français ont écoutés les larmes
aux yeux, parce que Pétain était encore pour eux
«le vainqueur de Verdun». Mais trois semaines plus
tard, à Vichy, Berl ne se faisait plus aucune illusion
sur le Maréchal Pétain. Et en octobre, il devait
se faire recenser comme «juif».
Il écrit : «Les pouvoirs n'aiment pas l'innocence.
Elle gâte leur triomphe.»
Oui, Berl ne se faisait guère d'illusions sur les hommes
de pouvoir et les hommes politiques. Mais il s'intéressait
à eux. Et c'est ça qui nous séparait. J'avais
lu quelque part une définition des hommes politiques qui
correspondait tout à fait à mon sentiment : «Des
médecins sans clientèles, des avocats sans causes
et des vétérinaires dont les animaux se méfient.»
(1) Dans cette lettre, Proust parle de l'amitié.
Il n'y croyait pas : «Personne n'aimerait autant aimer d'amitié
que moi, et je crois ne saurait mieux le faire. Mais je mentirais.»
Parmi les autres lettres reçues par Berl, il y en avait
une de soixante-quinze pages sur la jalousie. Berl se souvenait
de leur beauté, de leur générosité,
mais disait ne pas regretter spécialement qu'elles aient
disparu : elles ne faisaient, comme tant d'autres, qu'annoncer
«A la recherche du temps perdu». Par LANÇON
Philippe , Libération , 12 juillet 2007
BERLIN
"Cette ville est à l'image même de ce qui a
pu se produire pour des gens de ma génération :
c'était une ville en ruine en 1945, reconstruite, divisée,
politiquement instable. En reconstruisant, ils ont essayé
de bâtir des allées rectilignes sur des marécages,
tout a été bétonné mais en laissant
ici ou là quelques terrains vagues... Cette ville me fascine
parce qu'elle a mon âge, en quelque sorte. Paris me rappelle
mon adolescence, certains quartiers ont été détruits,
mais Paris n'a pas mon âge, loin de là. Berlin, si.
Enfin, c'est l'impression que j'ai et qui est très troublante.
J'ai toujours eu l'impression d'être né à
cause du chaos de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai
toujours eu l'impression qu'écrire consistait à
tenter de mettre de l'ordre dans le chaos. Alors, oui, Berlin
reconstruite à partir de ruines avec ces lignes droites
par-dessus des marécages me parle énormément.
Quand vous avez l'impression d'être né dans des conditions
bizarres, ce qui est mon cas, vous avez tendance à essayer
de trouver des points de repère. Ces allées de Berlin-Est,
rectilignes, pour oublier le passé, c'est la même
chose, me semble-t-il. Longtemps j'ai cru que faire de la littérature
avec ces choses chaotiques était un handicap et j'enviais
ceux qui pouvaient écrire sur la nature, la campagne, comme
les grands romanciers anglais du XIXe siècle. Moi, je suis
prisonnier des hasards du lieu et de l'époque où
je suis né, ce qui a fait de moi un écrivain urbain,
un écrivain des villes, qui regarde les allées rectilignes
et recherche les terrains vagues." "Mon
Paris n'est pas un Paris de nostalgie mais un Paris rêvé"
entretien avec François Busnel (Lire), 04/03/2010
La
vie brève, Journal d’Hélène
Berr, préface
de Patrick Modiano, ed Tallandier
Extraits
de l'oeuvre.
DES
MOTS MANQUENT, Préface
du «Journal» d'Hélène
Berr,
par Patrick Modiano
<< Une jeune fille marche dans le Paris de 1942. Et comme elle éprouvait
dès le printemps de cette année-là une inquiétude
et un pressentiment, elle a commencé d’écrire
un journal en avril. Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis,
mais nous sommes, à chaque page, avec elle, au présent.
Elle qui se sentait parfois si seule dans le Paris de l’Occupation,
nous l’accompagnons jour après jour. Sa voix est
si proche, dans le silence de ce Paris-là…
Le premier jour, mardi 7 avril 1942, l’après-midi,
elle va chercher au 40 de la rue de Villejust, chez la concierge
de Paul Valéry, un livre qu’elle a eu l’audace
de demander au vieux poète de lui dédicacer. Elle
sonne et un fox-terrier se jette sur elle en aboyant. «Est-ce
que monsieur Valéry n’a pas laissé un petit
paquet pour moi?» Sur la page de garde, : Valéry
a écrit «Exemplaire de mademoiselle Hélène
Berr?», et : au-dessous «Au réveil, si douce
la lumière, et si beau ce bleu vivant.»
Pendant tout ce mois d’avril et ce mois de mai, il semble, à la
lecture du «?Journal?» d’Hélène
Berr, que Paris, autour d’elle, soit en harmonie avec la
phrase de Valéry. Hélène fréquente
la Sorbonne où elle prépare un diplôme d’anglais.
Elle accompagne un «garçon aux yeux gris» dont
elle vient de faire la connaissance à la Maison des Lettres,
rue Soufflot, où ils écoutent un quintette de Bach,
un concerto pour clarinette et orchestre de Mozart… Elle
marche avec ce garçon et d’autres camarades à travers
le quartier Latin. «Le boulevard Saint-Michel est inondé de
soleil, plein de monde, écrit-elle. A partir de la rue
Soufflot, jusqu’au boulevard Saint-Germain, je suis en
territoire enchanté.» Parfois elle passe une journée
aux environs de Paris dans une maison de campagne à Aubergenville. «Cette
journée s’est déroulée dans sa perfection,
depuis le lever du soleil plein de fraîcheur et de promesse,
jusqu’à cette soirée si douce et si calme,
si tendre, qui m’a baignée tout à l’heure
lorsque j’ai fermé les volets.»
mot d’une chanson de l’époque – fleur
bleue. Elle est imprégnée par la poésie
et la littérature anglaises et elle serait sans doute
de¬venue un écrivain de la délicatesse de Katherine
Mansfield. On oubliera. On sent, chez cette fille de 20 ans,
le goût du bonheur, l’envie de se laisser glisser
sur la douce surface des choses, un tempérament à la
fois artiste et – pour employer leit presque, à la
lecture des cinquante premières pages de son Journal,
l’époque atroce où elle se trouve. Et pourtant,
un jeudi de ce mois d’avril, après un cours à la
Sorbonne, elle se promène dans le jardin du Luxembourg
avec un camarade. Ils se sont arrêtés au bord du
bassin. Elle est fascinée par les reflets et le clapotis
de l’eau sous le soleil, les voiliers d’enfants et
le ciel bleu – celui qu’évoquait Paul Valéry
dans sa dédicace. «Les Allemands vont gagner la
guerre», lui dit son camarade. «Qu’est-ce que
nous deviendrons si les Allemands gagnent??» «?Bah… rien
ne changera. Il y aura toujours le soleil et l’eau…» «Je
me suis forcée à dire: “Mais ils ne laissent
pas tout le monde jouir de la lumière et de l’eau.” Heureusement,
cette phrase me sauvait, je ne voulais pas être lâche…»
C’est la première fois qu’elle fait allusion
aux temps sombres où elle vit, à l’angoisse
qui est la sienne, mais de manière si naturelle et si
pudique que l’on devine sa solitude au milieu de cette
ville ensoleillée et indifférente. En cette fin
du printemps 1942, elle marche toujours dans Paris, mais le contraste
entre l’ombre et la lumière se fait plus brutal,
l’ombre gagne peu à peu du terrain.
Le mois de juin 1942 est pour elle le début des épreuves.
Ce lundi 8, elle doit, pour la première fois, porter l’étoile
jaune. Elle sent l’incompatibilité entre son goût
du bonheur et de l’harmonie et la noirceur et l’horrible
dissonance du présent. Elle écrit «Il fait
un temps radieux, très frais – un matin comme celui
de Paul Valéry. Le premier jour aussi où je vais
porter l’étoile jaune. Ce sont les deux aspects
de la vie actuelle: la fraîcheur, la beauté, la
jeunesse de la vie, incarnée par cette matinée
limpide – la barbarie et le mal représentés
par cette étoile jaune.» Sèvres-Babylone-quartier
Latin. Cour de la Sorbonne. Bibliothèque… Les mêmes
trajets que d’habitude. Elle guette les réactions
de ses camarades. «J’ai senti leur peine et leur
stupeur à tous.» A la station de métro Ecole
militaire, le contrôleur lui ordonne «?dernière
voiture?», celle où doivent obligatoirement monter
les porteurs d’étoile jaune. Elle nous dit les :
sentiments qu’elle a éprouvés concernant
cette étoile «J’étais décidée à ne
pas la porter. Je considérais cela comme une infamie et
une preuve d’obéissance : je trouve que c’est
une lâcheté de aux lois allemandes… Ce soir,
tout a changé ne pas le faire – vis-à-vis
de ceux qui le feront.» Et le lendemain, dans sa : solitude,
elle imagine que quelqu’un lui pose la question «Pourquoi
portez-vous cette étoile?» Elle répond «C’est
parce que je veux éprouver mon courage.»
Puis, à la date du 24 juin, sans élever le ton,
elle rend compte de l’épreuve qu’elle vient
d’affronter et qui sera déterminante pour elle. «?Je
me force à l’écrire, parce que je veux me
souvenir de tout.?» Il s’agit de l’arrestation
de son père, livré par la police française
des Questions juives à la Gestapo, puis transféré à la
Préfecture de Police avant
d’être interné à Drancy. Motif: son étoile
jaune n’était pas cousue à sa veste. Il s’était
contenté de la fixer à l’aide d’agrafes
et de pressions, afin de pouvoir la mettre plus facilement sur
tous ses costumes. Il semble qu’à la Préfecture
de Police on ne fasse guère de différence entre
les juifs «?français?» et les juifs «?étrangers?».
Raymond Berr, le père d’Hélène, ingénieur
des Mines, ancien directeur des établissements Kuhlmann,
décoré de la croix de guerre et de la Légion
d’honneur à titre militaire et faisant partie des
huit personnes de sa «?race?» à bénéficier
de l’article 8 de la loi du 3 octobre 1940 («Par
décret individuel pris en Conseil d’Etat et dûment
motivé, les juifs qui dans les domaines littéraire,
scientifique et artistique ont rendu des services exceptionnels à l’Etat
français sont relevés des “interdictions”»)
se trouve sur un banc de bois, surveillé par des policiers.
Hélène et sa mère ont obtenu l’autorisation
de le voir. On lui a enlevé sa cravate, ses bretelles
et ses lacets. «L’agent nous expliquait pour nous
rassurer que c’était un ordre car hier un détenu
avait essayé de se pendre.»
Une cassure s’est alors produite dans l’esprit d’Hélène
Berr entre la vie tranquille d’étudiante qu’elle
menait jusque-là et la vision de son père surveillé comme
un cri¬minel dans une officine crasseuse de la Préfecture
de Police. «Un abîme infranchissable», écrit-elle.
Mais le ton du Journal reste le même, sans aucun fléchissement,
aucun pathos. Les phrases toujours aussi brèves nous révèlent
de quelle trempe est cette jeune fille. L’internement de
son père à Drancy lui fait prendre conscience de
tout ce qui obscurcit et empoisonne le Paris de l’été 1942
et demeure pourtant invisible à ceux qui sont absorbés
par leurs soucis quo¬¬tidiens ou ceux qui ont choisi
de fermer les yeux. Hélène, elle, les garde grands
ouverts. Une jeune fille aussi artiste, aussi délicate
aurait pu détourner son regard dans un réflexe
de sauvegarde ou un geste d’épouvante ou même
se réfugier en zone libre. Elle, au contraire, ne se dérobe
pas et, d’un mouvement spontané, elle se sent solidaire
de la souffrance et du malheur. Le 6 juillet 1942, elle se présente
au siège de l’Ugif [Union générale
des Israélites de France] pour être recrutée
comme assistante sociale bénévole aux services
des internés du camp de Drancy et de ceux du Loiret. Chaque
jour, elle sera en contact avec les familles démembrées
par les arrestations et le témoin direct de toute l’horreur
quotidienne, celle du Vel’ d’Hiv, de Drancy et des
départs à l’aube dans les trains de marchandises
: à la gare de Bobigny. L’un des responsables de
l’Ugif lui a dit «Vous n’avez rien à faire
ici! Si j’ai un conseil à vous donner, partez.» Mais
elle reste. Elle a franchi la ligne dans un élan irréversible.
Son courage, sa : droiture, la limpidité de son cœur
m’évoquent le vers de Rimbaud «Par délicatesse/J’ai
perdu ma vie.»
Elle a pressenti le caractère fatal de sa démarche.
Elle : écrit «Nous vivons heure par heure – non
plus semaine par semaine.» : Elle écrit aussi «J’avais
un désir d’expiation, je ne sais pourquoi.» On
pense à la philosophe Simone Weil, et certaines pages
du Journal d’Hélène – ce Journal qu’elle
considère comme une lettre adressée à son
ami Jean, le garçon aux «?yeux gris?» du quartier
Latin, et dont elle ne sait même pas s’il la lira
un jour – évoquent parfois les lettres poignantes
de Simone Weil à Antonio Atarés, à la même époque.
Oui, Simone Weil aurait pu écrire cette phrase : « d’Hélène
Les amitiés qui se sont nouées ici, cette année,
seront empreintes d’une sincérité, d’une
profondeur et d’une espèce de tendresse grave que
personne ne pourra jamais connaître. C’est un pacte
secret, scellé dans la lutte et les épreuves.» Mais à la
différence de Simone Weil, Hélène Berr est
sensible au bonheur, aux matinées ra¬¬dieuses,
aux avenues ensoleillées de Paris où l’on
marche avec celui qu’on aime, et la liste qu’elle
dresse de ses livres de chevet ne comporte aucun philosophe,
mais des poètes et des romanciers.
Son Journal s’interrompt pendant neuf mois. Elle le reprend
définitivement en novembre 1943. Sa belle écriture
déliée, telle qu’elle apparaît dans
le manuscrit, est devenue aiguë, saccadée. Rien de
plus suggestif que ce bloc de silence de neuf mois qui nous fait
comprendre l’extrême gravité : de ce qu’elle
a vu et ressenti. Elle note «?Toutes mes amies du bureau
sont arrêtées.?» : Un leitmotiv revient sous
sa plume «Les autres ne savent pas…»; «L’incompréhension
des autres…»; «Je ne peux pas parler, parce
qu’on ne me croirait pas…»?; «Il y a
trop de choses dont on ne peut pas parler…» Et :
cette brusque confidence «Personne ne saura jamais l’expérience
dévastatrice par laquelle j’ai passé cet été.»
: Et aussi «En ce moment, nous vivons l’histoire.
Ceux qui la réduiront en paroles pourront bien faire les
fiers. Sauront-ils ce qu’une ligne de leur exposé recouvre
de souffrances individuelles?» Après ce long silence,
sa voix est toujours aussi claire mais elle nous parle désormais
de plus loin, de presque aussi loin qu’Etty Hillesum dans
ses «?Lettres de Westerbork?». Elle n’a pas
encore franchi le dernier cercle de l’enfer. Dans cette
ville où elle marche, elle est toujours émue par
des signes amicaux et : la petite porte des Tuileries, les feuilles
sur l’eau, toute la rassurants beauté lumineuse
de Paris… Elle va à la librairie Galignani acheter «?Lord
Jim?» et «?le Voyage sentimental?». Mais de
plus en plus souvent, par de brèves indications qu’elle
donne, on comprend aussi qu’elle est happée dans
les trous noirs de la ville, les zones maudites dont les noms
de rue reviennent dans son Journal. Rue de la Bienfaisance. C’est
là, dans leurs bureaux, que seront arrêtées
les assistantes sociales comme elle, et son amie Françoise
Bernheim. Hélène Berr échappera par hasard à cette
rafle. Rue Claude-Bernard. Un patronage d’enfants et d’adolescents
où les sinistres policiers des Questions juives fouilleront
et pilleront les bagages qu’ils ont confisqués à ceux
qui partaient en déportation. Rue Vauquelin. Un foyer
de jeunes filles qui seront raflées et déportées
juste avant la Libération de Paris. Le centre de la rue
Edouard-Nortier, à Neuilly. Hélène s’y
rend souvent pour s’occuper des enfants, les emmener en
promenade et, quand ils sont souffrants, aux Enfants-Malades
rue de Sèvres, ou à l’hôpital Rothschild
rue de Santerre. Parmi eux, «le petit Doudou Wogryb, au
sourire radieux», la petite Odette, «le petit André Kahn
que je tenais par la main, un de mes petits de Neuilly que j’adore»,
et celui, de 4 ans, dont on ne savait même pas le nom… La
plupart seront déportés le 31 juillet 1944.
J’ai voulu, un après-midi, suivre ces mêmes
rues pour mieux me rendre compte de ce qu’avait pu être
la solitude d’Hélène Berr. La rue Claude-Bernard
et la rue Vauquelin ne sont pas loin du Luxembourg et à la
lisière de ce qu’un poète appelait «?le
continent Contrescarpe?», une sorte d’oasis dans
Paris, et l’on a de la peine à imaginer que le mal
s’infiltrait jusque-là. La rue Edouard-Nortier est
proche du bois de Boulogne. Il y avait sûrement en 1942
des après-midi où la guerre et l’Occupation
semblaient lointaines et irréelles dans ces rues. Sauf
pour une jeune fille du nom d’Hélène Berr,
qui savait qu’elle était au plus profond du malheur
et de la : mais impossible de le dire aux passants aimables et
indifférents. barbarie Alors, elle écrivait un
Journal. Avait-elle le pressentiment que très loin dans
l’avenir, on le lirait?? Ou craignait-elle que sa voix
soit étouffée comme celles de millions de personnes
massacrées sans laisser de traces?? Au seuil de ce livre,
il faut se taire maintenant, écouter la voix d’Hélène
et marcher à ses côtés. Une voix et une présence
qui nous accompagneront toute notre vie.>>
Patrick Modiano
[La
résurrection
d’un manuscrit
Encre bleue sur papier jauni. Pas de ratures. L’écriture
est fine, lisible, élégante. Les feuilles extraites
d’un bloc ont été numérotées
recto verso jusqu’à la page 262. Le tout forme une
petite liasse d’une centaine de feuilles. C’est le
manuscrit du «?Journal?» d’Hélène
Berr conservé au Mémorial de la Shoah, à Paris.
Il retrace l’histoire d’une vie interrompue par la
déportation à 23 ans, le 27 mars 1944. Pas plus
que ses parents, l’étudiante n’est revenue
des camps. Elle meurt à Bergen-Belsen, en avril 1945,
deux semaines avant l’arrivée des troupes anglaises.
A la Libération, la famille Berr recherche l’original.
Mais Jean Morawiecki n’est plus en France. Après
avoir rejoint les Forces françaises libres en Afrique
du Nord et participé au débarquement de Provence,
il a suivi une carrière de diplomate. Elle le retrouve
en Equateur où il est ambassadeur de France. Il est toujours
en possession du Journal d’Hélène qu’il
redonne à la famille. Le douloureux trésor familial
reste néanmoins clandestin jusqu’au début
du XXIe siècle.
Karen Taieb, responsable des archives au Mémorial, se
souvient de la visite de la nièce d’Hélène
Berr, Mariette Job, en 2002 et des mots prononcés par
celle-ci: «J’ai un document à vous montrer.
C’est le Journal de ma tante que j’ai fait dactylographier.
J’aimerais le rendre accessible aux chercheurs.» Le
document accompagné de l’original est d’abord
déposé puis donné au Mémorial, qui
peut le communiquer sur demande. Mais pas question alors de publication.
Karen Taieb remarque que le Journal apporte aussi un témoignage
sur l’Ugif, l’Union générale des Israélites
de France, créée en 1941 par le gouvernement de
Vichy. Elle en parle à l’historien Michel Laffitte
qui travaille sur ce sujet pour sa thèse. En 2003, il
présente son livre en citant le Journal d’Hélène
Berr. Mariette Job fait partie de l’assistance. Elle constate
que le public est fasciné par la tragédie de cette
jeune femme. L’intérêt augmente encore lorsque
le Journal est présenté en 2005 dans l’exposition
permanente du Mémorial. «Des vingt destins présentés,
souligne Karen Taieb, c’est celui qui nous a valu le plus
de réactions. De plus, le Journal est un document très
demandé en salle de lecture depuis la conférence
de Michel Laffitte.»
Ce cumul d’intérêt pour le texte a fini par
faire infléchir les dernières réticences
de la famille. Et le livre fantôme révèle
aujourd’hui toute sa force.
Laurent Lemire ] © Le nouvel Observateur.
Le
grand bouleversement de Patrick Modiano, propos recueillis
avec François
Dufay
Très ému par le récit d'Hélène
Berr, l'écrivain en a écrit la préface.
Il raconte cette découverte.
«
Quand j'ai écrit "Dora Bruder", cette recherche
difficile d'une jeune juive morte en déportation, j'étais
obsédé par ces gens qui ont été emportés
par l'Histoire sans laisser de traces, sans avoir pu s'exprimer.
Il en va tout autrement d'Hélène Berr, née
dans les beaux quartiers, qui nous a légué ce journal
bouleversant, à la fois très littéraire
et saisi sur le vif. Dès que je l'ai lu, j'ai tenu à le
préfacer, en tâchant simplement de ne pas être
trop historique, doctrinal ou péremptoire, en suivant
plutôt le fil de son récit.
Ce
qui m'a frappé en effet, c'est son sens quasi météorologique
des atmosphères, cette dissonance entre les après-midi
de soleil où elle marche dans un Paris radieux et les événements
atroces, effrayants, qu'elle vit. Elle se raccroche à tout
ce qui donne l'illusion de la normalité, les études à la
Sorbonne, le Luxembourg, les sorties à la campagne, et
en même temps elle a le pressentiment de ce qui va arriver.
Chaque fois qu'elle vit un moment tragique, comme ce premier
jour où elle porte l'étoile jaune, ou la visite à son
père en état d'arrestation à la Préfecture
de police, il s'opère en elle une sorte de dédoublement.
Dans la salle de la Préfecture, son père plaisante,
il y a un agent de police un peu embêté d'avoir
dû ôter sa ceinture et ses lacets à ce monsieur...
La scène est encore plus horrible de se dérouler
dans une sorte de bonhomie.
C'est
ce jour-là, je crois, qu'elle a compris que son
milieu social favorisé ne la protégerait pas. Non,
je dis une bêtise : c'est depuis le jour, bien sûr,
où elle a porté l'étoile jaune. Hélène
est obsédée par cette espèce d'absurdité :
la persécution tombe sur elle, qui ne s'est jamais sentie
différente, qui refuse de considérer les juifs
comme un "groupe humain séparé".
Je
suis aussi frappé par ses silences, le fait qu'il
n'y ait presque pas d'échanges sur la situation avec ses
parents. Du moins ne les rapporte-t-elle pas dans son journal.
Elle était très seule. Sur ses traces, j'ai refait
moi-même certains de ses trajets dans Paris, vers les maisons
d'enfants juifs où elle travaillait, à Neuilly
ou au pied de la Contrescarpe, dans ces quartiers tranquilles,
silencieux, qui devaient l'être encore plus sous l'Occupation,
afin de comprendre ce qu'a pu être sa solitude... » © Le
Point du 20-12-2007

Journal
d’Hélène Berr, par
François QUINTON
<<
Hélène
Berr, jeune étudiante d’anglais,
issue de la grande bourgeoisie juive de Paris, mélomane,
a 21 ans lorsqu’elle prend la plume, en avril 1942, pour
tenir son journal. Publié pour la première fois
par les éditions Tallandier, ce formidable témoignage
constitue à la fois une source de première main
pour les historiens et une œuvre littéraire remarquable.
Le journal s’ouvre, le 7 avril 1942, sur le récit
de sa visite à Paul Valéry. Elle vient chercher
un livre qu’elle lui a audacieusement demandé de
dédicacer. Sur la page de garde, l’écrivain
a écrit : "Au réveil, si douce la lumière,
et si beau ce bleu vivant." Cette phrase, Hélène
Berr aurait pu en être l’auteur, tant elle semble
communier avec Paris dont elle parcourt les rues avec un émerveillement
sincère. N’est-elle pas, "à partir de
la rue Soufflot, et jusqu’à Saint-Germain, (…)
en territoire enchanté" ? Et la voici qui décrit,
insouciante, "la fascination qu’exerçaient
[sur elle] l’étincellement de l’eau sous le
soleil, le clapotis léger et les rides pleines de joie,
la courbe gracieuse des petits voiliers sous le vent, et par-dessus
tout, le grand ciel bleu frissonnant." Nous sommes le 15
avril. À un ami qui pense que les Allemands gagneront
la guerre et que rien ne changera, elle réplique : "Mais
ils ne laissent pas tout le monde jouir de la lumière
et de l’eau !" C’est la première évocation,
assez discrète, de la guerre par la jeune Hélène.
Quelques jours plus tard, elle rencontre, à la Sorbonne,
un "garçon aux yeux gris" qui l’invite à venir écouter
de la musique. C’est Jean Morawiecki, avec qui elle nouera
peu à peu une relation complice et amoureuse. Le temps
passant, celui-ci chasse de l'esprit de la jeune fille, et de
son journal, Gérard, qui, au fil de ses lettres, la presse
de répondre à ses avances. Jean quittera la France
pour rejoindre les Forces françaises libres en Afrique
du Nord, et ce sera dès lors à lui qu’elle
dédira son journal .
En juin 1942, la terrible réalité antisémite
la rattrape. Le 8, elle se décide à porter l’étoile
jaune. Quelques jours avant, pourtant, elle refusa de la porter,
considérant cela "comme une infamie et une preuve
d’obéissance aux lois allemandes" . Mais elle
change finalement d’avis : "je trouve que c’est
une lâcheté de ne pas le faire, vis-à-vis
de ceux qui le feront." La voici donc dans la rue, marquée. Épreuve
des gens qui détournent la rue, des enfants qui la désignent
du doigt à leurs parents, du contrôleur de métro
qui remarque son stigmate et lui indique la dernière voiture,
de ses camarades de la Sorbonne dont elle sent "leur peine
et leur stupeur à tous"… Mais aussi, parfois,
des sourires. Et puis cette remarque, le 16 : "Il y a des
moments où j’entrevois des possibilités tragiques.
Mais le reste du temps, je suis inconsciente." L’arrestation
de son père, le 23 juin, marque une rupture : désormais,
elle écrit "car elle veu[t] [se] souvenir de tout".
Raymond Berr, ingénieur des Mines, vice-président
directeur général de Kuhlmann, décoré de
la croix de guerre et de la légion d’honneur, est
arrêté par la police et interné à Drancy
(il sera libéré en septembre, contre caution).
Pourquoi ? Parce que son étoile était mal cousue
; sa femme l’avait en effet installée à l’aide
d’agrafes et de pressions afin de pouvoir la mettre sur
tous les costumes… Hélène Berr a alors ces
phrases : "Nous vivons heure par heure, non plus semaine
par semaine", puis, en juillet : "Quelque chose se
prépare, quelque chose qui sera une tragédie, la
tragédie peut-être."
Alors, elle rappelle qu’elle "note les faits, hâtivement,
pour ne pas les oublier, car il ne faut pas oublier". Nous
sommes le lendemain de la rafle du Vélodrome d’Hiver,
dont elle rapporte ce qu’elle en entend, y compris ce qu’elle
ignore être des rumeurs . Et puis, d’un coup, elle
passe à autre chose : "Nous avons fait de la musique
comme d’habitude", avant d’y revenir : "Nous
sommes sur une corde raide qui se tend à chaque heure." Souvent
dans son journal se mêlent ainsi récits de drames
et scènes de la vie quotidienne (déambulations
dans le Quartier latin, écoute et pratique de musique
classique,…), nous rappelant combien les victimes appartenaient à la
société, en un mot : vivaient.
Juillet 1942. C’est également à cette période
qu’Hélène Berr entre à l’Union
générale israélite de France (UGIF ) en
tant qu’assistante sociale bénévole auprès
des familles déchirées et se dévoue auprès
d’enfants dont les parents ne reviendront jamais… Une
querelle l’oppose d’ailleurs à un des cadres
de l’UGIF : lui prônant le ghetto, parlant de la
nation juive, elle soutenant qu’elle "n’appartien[t]
pas à la race juive", puisque "le judaïsme
est une religion et pas une race". Conflit ô combien
révélateur de la "ligne de clivage" identifiée
par François et Renée Bédarida entre les
Juifs assimilés, privilégiant l’intégration à la
nation, et les autres, davantage attachés à l’idée
de communauté.
Réflexions sur la judéité, donc, mais aussi
sur le mal et l’incompréhension de la population à laquelle
elle se heurte. C’est donc un devoir pour elle d’écrire, "car
il faut que les autres sachent. (…) Car comment guérira-t-on
l’humanité autrement qu’en lui dévoilant
d’abord toute sa pourriture, comment purifiera-t-on le
monde autrement qu’en lui faisant comprendre l’étendue
du mal qu’il commet ?" Le 9 novembre 1943, elle évoque
l’arrestation par les gendarmes d’un… bébé de
2 ans : "Qu’on en soit arrivé à concevoir
le devoir comme une chose indépendante de la conscience,
indépendante de la justice, de la bonté, de la
charité, c’est là la preuve de l’inanité de
notre prétendue civilisation."
L’incompréhension des autres la hante. Le 19 octobre
1943, elle se réveille angoissée par ce problème.
Elle dresse le triste et froid constat qu’un interlocuteur
ne comprendra que si "vous lui donnez des preuves (…)
dont vous êtes le centre", ce qui la révolte
profondément puisque "ce qui compte, c’est
la torture des autres, c’est la question de principe, ce
sont les milliers de cas individuels qui composent cette question".
Doit-elle alors se résoudre à partager le monde
en deux parties : d’un côté ceux qui ne peuvent
pas comprendre (même s’ils savent), et ceux qui le
peuvent ? Mais cela signifierait "renoncer à une
partie de l’humanité, renoncer à croire que
tout homme est perfectible"…
L’étau se resserre. "Maintenant, je suis dans
le désert", lâche-t-elle le 27 octobre 1943.
Où peuvent bien aller ces wagons de déportés
? Pour quoi faire ? Les interrogations sur les déportations
se font plus vives à partir de novembre 1943 : "On
a parlé aussi des gaz asphyxiants par lesquels on aurait
passé les convois à la frontière polonaise.
Il doit y avoir une origine vraie à ces bruits." ; "Pourquoi
ces déportations ? Cela ne rime à rien. Faire travailler
ceux-là ? Ils mourront en route." ; "(…)
maintenant ce sont les familles que l’on déporte
: où pensent-ils en venir ?" ; et puis cette réalité qui
s’impose : "Il n’y a sans doute pas à réfléchir,
car les Allemands ne cherchent même pas de raison ou d’utilité.
Ils ont un but : exterminer."
Le 1er février 1944, Raymond Berr prend la décision
de quitter leur appartement, situé au 4ème étage
d’un immeuble cossu, au pied de la tour Eiffel. Ils sont
accueillis par différentes personnes. Mais le 7 mars,
ils rentrent dormir chez eux. Ils sont arrêtés le
lendemain, au petit matin, puis déportés. Ses parents
meurent à Auschwitz, elle à Bergen-Belsen, quelques
jours avant la libération du camp.
Lorsque Jacques, le frère d’Hélène,
apprend sa mort, il adresse à Jean le manuscrit, d’ailleurs étonnamment
clair, presque sans ratures, que lui avait remis l’ancienne
cuisinière de la famille. Une version dactylographiée
est conservée par la famille, à laquelle Jean remet,
dans les années 1990, l’original qui est ensuite
donné au Mémorial de la Shoah avant que ne soit
prise la décision de le publier. Saluons cette initiative
qui met à la portée de tous ce texte remarquable à tous égards,
et rejoignons Patrick Modiano qui, dans sa très belle
préface, cite ce vers de Rimbaud que lui évoque
la droiture et le courage d’Hélène Berr : "Par
délicatesse / J’ai perdu ma vie">>
Le
journal d'Hélène Berr : au cœur des ténèbres,
par Chantal Guy, La Presse Canada.
<< C'est Patrick Modiano, auteur de la préface de
ce document d'outre-tombe et pourtant si vivant, qui a raison: «Il
faut se taire maintenant, écouter la voix d'Hélène
et marcher à ses côtés.» Mais avant
que de nous taire, il nous faut vous convaincre d'une chose:
lire le journal d'Hélène Berr, témoignage
exceptionnel de la vie à Paris pendant l'Occupation, inconnu
du public pendant plus de 60 ans.
Une jeune juive française, qui se considère bien
plus française que juive, nous raconte ce qu'est la vie
sous Vichy, qui lui rappellera cruellement sa «différence».
Au début de la vingtaine, elle écrit son journal
intime, dans lequel elle consigne des choses bien de son âge;
ses amours, ses études, ses aspirations, ses méditations.
Dès le premier jour, on sait à qui on a affaire.
Une jeune fille loin de la neurasthénie, ouverte à toutes
les beautés de ce monde. En recevant un livre dédicacé de
Paul Valéry, elle écrit, le 7 avril 1942: «Et
la joie m'a inondée, une joie qui venait confirmer ma
confiance, qui s'harmonisait avec le joyeux soleil et le ciel
bleu tout lavé au-dessus des nuages ouatés. Je
suis rentrée à pied, avec un petit sentiment de
triomphe à la pensée de ce que les parents diraient,
et l'impression qu'au fond l'extraordinaire était le réel.»
Ce réel va changer. Brutalement. De façon extraordinaire,
mais en basculant du côté du cauchemar. Et jamais,
jusqu'à la fin (du moins de ce journal), Hélène
Berr ne détournera son regard face à l'horreur
qui la cerne de toutes parts, horreur qui la mènera à Auschwitz,
avec ses parents, où elle mourra à Bergen-Belsen
en avril 1945, peu de temps avant la libération, en ayant
survécu plus d'un an à sa captivité. Et
voilà le tragique incommensurable de ce destin, quand
on découvre qu'elle écrivait le 15 février
1944, juste avant son arrestation, et ce qui donne une bonne
idée de l'étoffe dont elle était faite, à mesure
que l'inéluctable lui apparaissait: «Quelle impression éprouverai-je
lorsque je sentirai que je suis «bouclée pour de
bon», et que toute une partie de ma vie est close à jamais,
qui sait, peut-être toute ma vie quoique j'aie la volonté de
vivre même là-bas.» Là-bas, ce sont
les camps, dont on entendait des histoires hallucinantes, que
personne n'osait croire, et qui pourtant étaient... réelles.
Qu'elle n'ait pas survécu, elle qui ne voulait rien oublier
de cette infamie, qui estimait que cela devait se savoir, c'est
une injustice terrible, mais, pour nous consoler (ou nous affliger
davantage), il y a au moins ce journal, qui est resté comme
un douloureux secret de famille pendant une soixantaine d'années
avant d'être publié chez Tallandier.
«Beaucoup de gens se rendront-ils compte de ce que cela
aura été que d'avoir 20 ans dans cette effroyable
tourmente, l'âge ou l'on est prêt à accueillir
la beauté de la vie, ou l'on est prêt à donner
sa confiance aux hommes?»
Non, nous ne saurons jamais ce que c'était, mais Hélène
Berr nous en donne une bonne idée. Cela commence avec
le port de l'étoile jaune, qu'elle refuse au début,
par orgueil, et qu'elle accepte ensuite, par solidarité envers
ceux qui la portent.
L'arrestation de son père, déporté à Drancy,
qu'ils réussissent à ramener. On se demande pourquoi
la famille Berr ne fuit pas, au fur et à mesure des ordonnances
allemandes qui réduisent comme peau de chagrin les droits
des juifs, «étrangers» en premier, «français» ensuite.
Le fossé se creuse non pas entre Hélène
et l'occupant, mais entre Hélène et ses compatriotes,
qui continuent de mener leur vie comme si de rien n'était.
Ainsi, un soir, sur le pont Mirabeau, une connaissance lui demande
si cela ne lui manque pas trop de ne pouvoir sortir le soir.
Elle se dit «Mon dieu! Il croit que nous en sommes qu'à ce
stade-là! Il y a bien longtemps que je l'ai laissé derrière
moi. Je n'ai même jamais pensé à m'y arrêter,
peut-être parce que je n'ai jamais été mondaine,
mais surtout parce que je savais qu'il y avait des choses plus
affreuses.»
Plus que les insultes dont Hélène est victime,
elle et ses proches, c'est justement de cette ignorance des autres,
ceux qui sont de l'autre côté de sa réalité,
dont elle souffre. Et qui creuse un abîme infini entre
eux et elle, trop consciente, terriblement consciente de ce qui
est en train de se passer. « Chaque heure de la journée
se répète la douloureuse expérience qui
consiste à s'apercevoir que les autres ne savent pas,
qu'il n'imaginent même pas les souffrances d'autres hommes,
et le mal que certains infligent à d'autres. Et toujours
j'essaie de faire ce pénible effort de raconter. Parce
que c'est un devoir, c'est peut-être le seul que je puisse
remplir. Il y a des hommes qui savent et qui se ferment les yeux,
ceux-là, je n'arriverai pas à les convaincre, parce
qu'ils sont durs et égoïstes, et je n'ai pas d'autorité.
Mais les autres, ceux qui ne savent pas, et qui ont peut-être
assez de coeur pour comprendre, ceux-là, je dois agir
sur eux.»
Elle était jeune, elle était belle, elle était
amoureuse, elle étudiait la littérature anglaise.
Une vie fauchée comme des millions d'autres à la
même époque. «On a parlé aussi des
gaz asphyxiants par lesquels on aurait passé les convois à la
frontière polonaise. Il doit y avoir une origine vraie à ce
bruit. Et penser que chaque personne nouvelle qui est arrêtée,
hier, aujourd'hui, à cette heure même, est sans
doute destinée à subir ce sort terrible. Penser
que ce n'est pas fini, que cela continue tout le temps avec une
régularité diabolique. Penser que si je suis arrêtée
ce soir (ce que j'envisage depuis longtemps), je serai dans huit
jours en Haute-Silésie, peut-être morte, que toute
ma vie s'éteindra brusquement, avec tout l'infini que
je sens en moi.»
Le
15 février 1944, l'ultime entrée du journal
se termine sur une citation de Conrad: Horror! Horror! Horror!
Hélène Berr entre dans la dernière étape
de son calvaire. Et nous, lecteurs, resterons longtemps hantés
par cette voix dans les ténèbres.>> © Cyberpresse,
Canada, 10 fev 2008
Une
voix dans la nuit, par Mohammed Aïssaoui
<<
Hélène Berr, cette jeune Parisienne juive a tenu
son journal, entre avril 1942 et février 1944. Elle est
amoureuse, elle aime la vie, mais rien de «l'effroyable
tourmente» ne lui échappe. Un témoignage
d'une force rare.
Les textes qui décrivent le quotidien pendant les heures
noires sont rares. C'est pour cela que le document qu'a laissé Hélène
Berr (1921-1945) devrait être porté à la
connaissance de tous.
À
sa lecture, on pense, bien sûr, au Journal d'Anne Frank
; on pense encore au livre Les Voix sous la cendre (Calmann-Lévy)
qui rassemblait cinq manuscrits cachés par des Sonderkommandos
pour décrire ce qui se passait dans les chambres à gaz
d'Auschwitz. On pense enfin à Dora Bruder, le récit
de Patrick Modiano, d'ailleurs préfacier du livre d'Hélène
Berr.
Hélène Berr est née à Paris, dans
une famille de la bourgeoisie juive son père est le vice-président-directeur
général des usines Kuhlmann, grande entreprise
de la chimie française. Elle a vingt et un ans au moment
où elle entame son récit, ce mardi 7 avril 1942.
Elle prépare l'agrégation d'anglais et est amoureuse
de Jean. Une existence ordinaire et insouciante. D'ailleurs,
les premières pages évoquent beaucoup le soleil
qui brille, le ciel bleu ou la pluie qui cessera sûrement.
Elle parle de ses lectures, de musique, des garçons, de
la famille, de ses longues marches dans Paris, de ses joies et
de ses peines. On oublierait presque la période. Mais
il y a quelque chose d'insoutenable à lire ces phrases
joliment tournées on connaît la fin : deux ans plus
tard, en mars 1944, elle sera déportée à Auschwitz
avec ses parents, et elle mourra à Bergen-Belsen en avril
1945. Sans doute cette impression provient-elle du décalage
déconcertant entre ce qu'elle raconte et ce qu'elle vit,
et ce que nous savons aujourd'hui. L'espoir ne la quitte jamais,
ni l'idée de bonheur. Elle n'en veut à personne,
pardonne à ceux qui lui font des remarques blessantes.
Mais au fond, Hélène sait tout, et elle veut laisser
un témoignage. Le 10 octobre 1943, au moment où elle
reprend son journal après une année d'interruption,
elle souligne, elle le répétera souvent : « Il
faudrait donc que j'écrive pour pouvoir plus tard montrer
aux hommes ce qu'a été cette époque. Je
sais que beaucoup auront des leçons plus grandes à donner,
et des faits plus terribles à dévoiler. Je pense à tous
les déportés, à tous ceux qui gisent en
prison.?»
Il y a des pages terribles dans ce livre, la tension y est permanente
sous une plume légère. Impossible de tout raconter,
juste ces moments clés, qui illustrent bien l'ensemble.
Comme ce samedi 11 avril 1942 où son père reçoit « un
avis de spoliation » (ce que les autorités allemandes
appelaient « l'aryanisation économique » qui
consistait en la confiscation des biens immobiliers et des sociétés
appartenant aux Juifs). Elle se dit simplement : « Mais
ils ne laissent pas tout le monde jouir de la lumière
et de l'eau ! »
«
Maman est venue m'annoncer la nouvelle de l'étoile jaune...»
Et puis ce jour où elle doit porter l'étoile jaune,
le lundi 1er juin : Hélène en parle presque avec
détachement : «Maman est venue m'annoncer la nouvelle
de l'étoile jaune, je l'ai refoulée en disant “?Je
discuterai de cela après.” Mais je savais que quelque
chose de désagréable était at the back of
my mind (me préoccupait confusément).» Elle
affirmera elle-même ne pas s'être rendu compte de
ce qui se tramait, et dit se trouver dans « une belle confusion ».
Mais qui peut vraiment se rendre compte ? Assurément pas
une jeune femme préoccupée par ses examens universitaires.
Le soir du jeudi 28 octobre, elle commence ainsi son carnet : «Je
viens de passer un après-midi merveilleux.» Mais,
un peu plus loin, la lucidité reprend le dessus : «J'ai
pensé dans le métro aujourd'hui : beaucoup de gens
se rendront-ils compte de ce que cela aura été que
d'avoir vingt ans dans cette effroyable tourmente, l'âge
où l'on est prête à accueillir la beauté de
la vie, où l'on est prêt à donner sa confiance
aux hommes ?»
Dans la préface, Patrick Modiano rappelle que, à Paris
en 1942, il y avait sûrement « des après-midi
où la guerre et l'Occupation semblaient lointaines et
irréelles dans ces rues. Sauf pour une jeune fille du
nom d'Hélène Berr, qui savait qu'elle était
au plus profond du malheur et de la barbarie : mais impossible
de le dire aux passants aimables et indifférents ».
L'auteur de La Place de l'étoile ajoute : « Au seuil
de ce livre, il faut se taire maintenant, écouter la voix
d'Hélène et marcher à ses côtés.
Une voix et une présence qui nous accompagneront toute
notre vie.» >> © Le FIGARO du 03/01/2008.
La
vie brève par Nathalie Levisalles
<< Sur la photo, Hélène Berr se tient devant Jean
Morawiecki dans une prairie ou un jardin. Debout au milieu d’herbes
hautes, ils ont l’air à la fois heureux et distraits.
Dans son journal, Hélène écrit : «Je
suis allée avec J.M. cueillir des fruits dans le verger
là-haut. Lorsque j’y repense, j’ai l’impression
d’un enchantement. […] Le ciel bleu et le soleil
qui faisait étinceler les gouttes de rosée et la
joie qui m’inondait. Ce matin-là, j’étais
complètement heureuse.» On est le 15 août
1942. Deux ans et demi plus tard, Hélène mourra à Bergen-Belsen,
quelques jours avant la libération du camp par les Américains.
Jean Morawiecki est toujours vivant, il a 86 ans aujourd’hui.
En 1945, le journal d’Hélène lui a été remis,
comme elle l’avait demandé. Soixante-deux ans plus
tard, il est publié, comme elle l’avait souhaité.
Ce sera l’événement éditorial du début
de l’année 2008. Une évidence depuis la foire
du livre de Francfort en octobre.
Regards. Ce journal intime tenu entre 1942 et 1944 par une jeune
fille de la bourgeoisie juive dans Paris occupé par les
Allemands est d’abord un document exceptionnel. L’historien
Michel Laffitte, qui en cite de longs passages dans son livre
Juif dans la France allemande (1), raconte comment, en le découvrant,
il a été «saisi» par la richesse du
témoignage «alors qu’on pensait que tout avait été dit
sur les Juifs pendant l’Occupation». Il est aussi
exceptionnel par sa qualité littéraire. Hélène
a 21 ans quand elle en écrit les premières pages,
23 ans les dernières. Entre-temps, un écrivain
est né.
Dans ce journal, la jeune fille pose un regard ébloui
sur la beauté du monde (le jardin, l’été,
son amour naissant pour Jean), en même temps qu’un
regard horrifié, mais qui ne cède pas, devant le
danger qui se rapproche. Elle parle d’«un resserrement
de la beauté au cœur de la laideur».
Hélène Berr est née en 1921, à Paris,
dans une famille «de vieille souche française»,
comme le dit Mariette Job, sa nièce, dans sa très
sobre préface. Hélène a deux sœurs
et un frère. Son père, Raymond Berr, chimiste réputé,
est vice-PDG de l’entreprise Kuhlmann.
Quand son journal débute, le 7 avril 1942, Hélène
raconte une vie normale, privilégiée d’une
certaine manière. Son violon (c’est une excellente
musicienne), son premier petit ami, Gérard (il s’agit
du juriste Gérard Lyon-Caen, qui a pu lire le journal
avant sa mort il y a quelques années), ses amis de la
Sorbonne (à cause des lois de Vichy, elle ne peut passer
l’agrégation mais prépare une thèse
sur Keats), ses journées dans la maison de campagne d’Aubergenville
(Yvelines), sa rencontre avec Jean, en avril 1942. Six mois plus
tard, lorsqu’elle le voit pour la dernière fois
- il part rejoindre les Forces françaises libres -, ils
sont fiancés.
Et puis il y a son autre vie. Hélène travaille à la
fois pour l’Entraide temporaire (une organisation clandestine
qui tente de sauver des enfants juifs) et pour l’Ugif (voir
page IV). Assistante sociale bénévole, elle parle
des enfants qu’elle emmène à la campagne
ou jouer chez elle, Doudou, Odette, des enfants parfois tout
petits qui ont été arrachés à leurs
parents deux jours ou deux mois plus tôt, comme ceux-ci, «ramenés à Drancy
pour être probablement déportés. Ils jouent
dans la cour, répugnants, couverts de plaies et de poux.
Pauvres petits». Ou le petit Bernard, dont la mère
et la sœur ont été déportées,
et qui dit «cette phrase qui semblait si vieille dans sa
bouche de bébé : "Je suis sûr qu’elles
ne reviendront pas vivantes" ; il a l’air d’un
ange».
Quand Hélène parle du port de l’étoile
jaune, des réactions des passants, du jardin de Notre-Dame
dont elle est chassée, du Faubourg Saint-Denis presque
vide après les rafles, on a l’impression de comprendre
pour la première fois l’horreur et l’absurdité de
la vie quotidienne des Juifs dans Paris occupé.
Elle raconte à la fois ce qu’elle voit de la persécution
des Juifs et ce qu’elle entend dire, elle rassemble des
informations éparses, comprend la réalité de
la menace. «On a parlé aussi des gaz asphyxiants
par lesquels on aurait passé les convois à la frontière
polonaise. Il doit y avoir une origine vraie à ces bruits.»
C’est déchirant de lire ces pages où elle
exprime cette prescience de la catastrophe, cette conscience
d’être à la veille de la fin d’un monde,
mais aussi cette volonté de laisser un témoignage
de sa pensée vivante à Jean. «Je sais pourquoi
j’écris ce journal, je sais que je veux qu’on
le donne à Jean si je ne suis pas là lorsqu’il
reviendra. Je ne veux pas disparaître sans qu’il
sache tout ce que j’ai pensé pendant son absence,
ou du moins une partie. Car je "pense" sans arrêt.
C’est même une des découvertes que j’ai
faites, que cette "conscience" perpétuelle où je
suis.»
Mais ce qui rend ce texte exceptionnel, c’est que, au fur
et à mesure que le piège se referme sur elle, Hélène
exprime à la fois le sentiment d’être prise
dans une tragédie collective et un oubli d’elle-même
bien au-delà du courage. Il y a parfois, dans sa façon
de s’identifier à la souffrance des autres, dans
ce désir de la prendre sur elle, un côté presque
christique. A un moment, citant l’Evangile selon saint
Matthieu, elle dit : les paroles du Christ sont semblables aux «règles
de conscience auxquelles j’essaie d’obéir
d’instinct». On a le sentiment que cette ouverture,
cette porosité à la souffrance des autres, est
aussi liée à l’état d’hypersensibilité que
contient l’amour naissant. Et c’est sans doute ce
qui passe de cet état dans son écriture qui nous
la rend si proche, si vibrante, qui touche au plus profond de
nous.
La dernière entrée du journal est datée
du 15 février 1944. Alors que des nouvelles atroces lui
parviennent de partout, les derniers mots qu’elle écrit
sont une citation d’Au cœur des ténèbres
de Conrad : «Horror ! Horror ! Horror !»
Copies.Pourquoi ce journal, contrairement à celui d’Anne
Frank, n’a pas été publié immédiatement
après la guerre ? Et comment cela s’est-il fait
? C’est le résultat d’une chaîne dont
les maillons sont Michel Laffitte, bien sûr, mais aussi
Karen Taieb, l’archiviste du Mémorial de la Shoah,
et surtout Andrée Bardiau, la cuisinière de la
famille Berr, Jean Morawiecki, le fiancé d’Hélène,
et Mariette Job, la plus jeune des neveux et nièces d’Hélène,
qui s’est retrouvée «passeuse», comme
elle le dit elle-même de ce journal.
Quand Hélène est arrêtée, le 8 mars
1944 au matin, elle est seule avec ses parents et Andrée
Bardiau. La famille Berr est transférée à Drancy
puis déportée à Auschwitz. Après
leur départ, Andrée Bardiau récupère
le journal d’Hélène (avec son violon), elle
le remettra à son frère Jacques à la fin
de la guerre. Jacques et ses sœurs (Denise et Yvonne) en
font une copie, dactylographiée par un employé de
Kuhlmann. L’original est remis à Jean Morawiecki
lorsqu’il rentre à Paris. Depuis, pendant toutes
ces années, des copies ont circulé, elles ont été lues
par la famille, par un petit cercle de proches (2). Serge Klarsfeld
et Simone Veil en ont eu connaissance. Mais la famille (certains
de ses membres en tout cas) n’était pas prête à le
voir devenir un texte public : trop douloureux, trop intime.
En 1992, Mariette contacte Jean, elle sait qu’il a été conseiller
d’ambassade et lui envoie une lettre par l’intermédiaire
du ministère des Affaires étrangères. Jean
répond immédiatement. Entre-temps, il s’est
marié, en 1950, et a eu une fille. En 1992, sa femme vient
de mourir.
C’est le début d’une amitié entre Jean
et la nièce de sa fiancée disparue. En 1994, Jean
donne officiellement le journal à Mariette Job. En 2002,
elle se rend au Mémorial de la Shoah, elle y rencontre
Karen Taieb à qui elle remet une copie puis l’original
du journal, des feuilles de papier quadrillé, couvertes
d’une écriture fine et régulière,
au crayon et à l’encre, avec étonnamment
peu de ratures.
Karen Taieb raconte qu’elle est «tombée amoureuse
du texte». Elle n’est pas la seule. L’exposition
permanente du Mémorial comprend 20 vitrines qui racontent
20 destins. La plus regardée est celle qui contient le
journal et la photo d’Hélène. Un jour où Mariette
Job passe au Mémorial, elle tombe sur un groupe de jeunes
filles qui déchiffrent le manuscrit, pendant que d’autres,
assises, attendent leur tour. Une responsable du Mémorial
lui confirme que, tout au long de l’année, ce sont
des milliers de visiteurs qui s’arrêtent devant la
vitrine d’Hélène. Mais ça ne suffit
pas à décider la famille Berr. Il faudra encore
une autre étape.
Ciné-Rire. A l’occasion de la parution du livre
de Michel Laffitte, Karen Taieb organise, le 20 février,
une soirée présentée par Mariette Job et
l’historienne Annette Wieviorka. La comédienne Béatrice
Houplain lit des extraits du journal d’Hélène,
plusieurs membres de la famille Berr sont dans la salle. C’est
en voyant l’intérêt et l’émotion
du public, explique Mariette Job, qu’elle a «trouvé le
courage et l’énergie de refaire le tour de la famille».
Avec succès cette fois. A partir de là, tout ira
très vite. Des contacts sont pris avec deux ou trois éditeurs,
c’est finalement Tallandier qui comprend le mieux l’importance
de ce texte et le publie avec une préface de Patrick Modiano.
Pourquoi Modiano ? D’abord parce que l’écrivain
avait lu le livre de Michel Laffitte, notamment un passage où il
explique que les Allemands, dans leur grand désir d’établir
une société juive séparée («Les
retrancher de la nation française»), veulent créer
des bibliothèques et des hôpitaux juifs, un cinéma
aussi. Ils ont déjà choisi la salle qu’ils
veulent convertir, Ciné-Rire, rue Caumartin, et ont demandé à un
certain Albert Modiano d’en être le directeur. Est-ce
le père de Patrick ? Il y avait à l’époque
deux Albert Modiano à Paris. Rien n’est donc sûr
mais, en attendant, Patrick Modiano et Michel Laffitte se sont
rencontrés plusieurs fois, et c’est Laffitte qui
a suggéré à l’éditeur de demander
une préface à Modiano. Dans ces onze pages, il
raconte comment il a mis ses pas dans les pas d’Hélène
du côté du Luxembourg. Il écrit aussi : «Plus
d’un demi-siècle s’est écoulé depuis,
mais nous sommes, à chaque page, avec elle, au présent.
Elle qui se sentait parfois si seule dans le Paris de l’Occupation,
nous l’accompagnons jour après jour. Sa voix est
si proche, dans le silence de ce Paris-là.» >>© Libération,
jeudi 20 décembre 2007
(1)
Préfacé par Annette Wieviorka,
Tallandier, 2006.
(2) Notamment Jean Samuel, qui a croisé Raymond Berr à Auschwitz
et a rencontré ses petites-filles après guerre,
comme il le dit dans Il m’appelait Pikolo. Un compagnon
de Primo Levi raconte, qui vient de sortir chez Robert Laffont.
Le
long supplice d'Hélène Berr
par Thomas Wieder
<< Soixante ans ont passé, les rescapés continuent
de témoigner et les morts n'ont pas encore dit leur dernier
mot. Chaque année, de nouvelles publications donnent à entendre
des voix que l'on croyait à jamais évanouies. Des
témoignages écrits au coeur du désastre,
exhumés souvent par hasard des années plus tard,
comme le furent récemment les archives du ghetto de Varsovie,
les manuscrits des Sonderkommandos d'Auschwitz, ou encore ces
centaines de pages noircies par des enfants juifs réunies
récemment dans une belle anthologie (1).
Le texte que publient les éditions Tallandier fait partie
de ces témoignages qui survécurent miraculeusement à leur
auteur. Hélène Berr est morte du typhus à Bergen-Belsen
en avril 1945, à la veille de la libération du
camp par les Anglais. Elle venait d'avoir 24 ans. Un an plus
tôt, quelques jours avant son arrestation, elle avait confié son
journal intime à la cuisinière de ses parents.
Dédié à son fiancé, aujourd'hui conservé au
Mémorial de la Shoah, il s'agit là d'un document
exceptionnel sur la vie au jour le jour d'une étudiante
juive dans le Paris de l'Occupation.
Hélène Berr n'est pas Anne Frank. Son journal
n'est pas celui d'une recluse. Quand elle en entreprend la rédaction,
en avril 1942, ses journées ressemblent encore à celles
de n'importe quelle jeune fille de bonne famille : cours d'anglais à la
Sorbonne, promenades dans le Quartier latin, escapades à la
campagne et après-midi entre amis, passés à jouer
du violon, boire du chocolat chaud et fumer des cigarettes égyptiennes...
Courtisée par les garçons, choyée par ses
parents, brillamment reçue à ses examens, Hélène
a tout pour être heureuse. Seulement voilà : elle
est juive, et ne tardera pas à comprendre ce que cela
signifie.
Plus
que l'avis de spoliation que reçoit son père
en avril 1942, auquel elle ne consacre qu'une demi-phrase, c'est
l'obligation de porter l'étoile jaune, deux mois plus
tard, qui constitue pour la jeune femme le premier vrai traumatisme
de l'Occupation : "S'ils savaient quelle crucifixion c'est
pour moi. J'ai souffert, là, dans cette cour ensoleillée
de la Sorbonne, au milieu de tous mes camarades. Il me semblait
brusquement que je n'étais plus moi-même (...),
que j'étais devenue étrangère, comme si
j'étais en plein dans un cauchemar (...). C'était
comme si j'avais eu une marque au fer rouge sur le front."
"La
vie continue à être étrangement
sordide et étrangement belle", écrit Hélène
Berr en juin 1942. L'équilibre sera toutefois de courte
durée. Au fil des semaines, le beau cédera peu à peu
la place au sordide. "Je suis devenue très grave",
constate-t-elle un an plus tard. Il faut dire que chaque jour,
désormais, apporte son lot de mauvaises nouvelles. Non
seulement les proches sont arrêtés les uns après
les autres, mais les rumeurs sur les traitements qui leur sont
infligés sont de plus en plus alarmantes. "On a parlé aussi
des gaz asphyxiants par lesquels on aurait passé les convois à la
frontière polonaise. Il doit y avoir une origine vraie à ces
bruits", rapporte ainsi la jeune femme en novembre 1943.
Désespérée,
parfois résignée,
toujours révoltée, l'étudiante n'ignore
plus, désormais, le sort qui lui est réservé. "Je
ne pouvais plus jouer de musique parce que brusquement je pressentais
d'une manière aiguë le malheur qui pourrait nous
arriver", confesse-t-elle quelques semaines avant que la
police, au petit matin du 7 mars 1944, ne vienne l'arrêter,
avec ses parents, direction Drancy, puis Auschwitz.
"Beaucoup
de gens se rendront-ils compte de ce que cela aura été que
d'avoir 20 ans dans cette effroyable tourmente, l'âge où l'on
est prêt à accueillir
la beauté de la vie, où l'on est tout prêt à donner
sa confiance aux hommes ?", se demandait un jour Hélène
Berr. On l'aura compris : son journal, comparable, par sa profondeur
d'analyse, sa qualité littéraire et sa sombre lucidité, à celui
de la Hollandaise Etty Hillesum (2), sa presque contemporaine,
qui mourut comme elle en déportation, apporte à cette
question l'une des réponses les plus poignantes qui nous
aient été données à lire.>> © Le
Monde du 18.01.08
--------------------------------------------------------------------------------
JOURNAL d'Hélène Berr. Préface de Patrick
Modiano. Tallandier, 300 p., 20 €.
(1) Archives clandestines du ghetto de Varsovie, 2 vol., Fayard-BDIC,
2007 ; Des voix sous la cendre, Calmann-Lévy, 2005 ; L'Enfant
et le Génocide, Robert Laffont, "Bouquins",
2007.
(2) Une vie bouleversée. Journal (1941-1943),
Seuil, 1985.
Hélène
Berr. Journal. par Bernard Gensane
Sur la couverture, un très beau visage. Des yeux intenses et doux qui
vont voir l’horreur de Bergen-Belsen avant de se fermer. Une expression
de profonde paix intérieure, de volonté, mais aussi de résignation.
Le
manuscrit de ce Journal a été retrouvé par
la nièce d’Hélène Berr. À l’initiative
de Jean Morawiecki, le fiancé d’Hélène,
ce document a été remis au mémorial de la
Shoah à Paris. Patrick Modiano, qui a écrit une superbe
préface à ce texte, s’est dit « frappé par
le sens quasi météorologique des atmosphères,
cette dissonance entre les après-midi de soleil où elle
marche dans un Paris radieux et les événements atroces,
effrayants, qu’elle vit. » Modiano s’est dit également
surpris « par ses silences, le fait qu’il n’y
ait presque pas d’échanges sur la situation avec ses
parents. » Ce silence, Joseph Losey l’avait puissamment
rendu au début de Monsieur Klein : un couple de Juifs subissent
séparément une inspection anthropométrique
dans un service de la police française et sont incapables
d’échanger un seul mot une fois l’examen humiliant
terminé.
Le
livre s’ouvre sur une visite d’Hélène
Berr chez Paul Valéry, ou plutôt chez la concierge
du maître. Valéry a accepté de dédicacer
son dernier ouvrage à la jeune étudiante qui a le
droit d’aller le récupérer dans la loge. Sans
le savoir, ou en le sachant, le poète nous livre la subtile
et rayonnante Hélène : « Exemplaire de Mademoiselle
Hélène Berr. Au réveil, si douce est la lumière
et si beau ce bleu vivant ».
Avec
les Berr, nous sommes en présence d’une bourgeoisie
très établie (le père est le directeur-adjoint
de Kuhlman), des Juifs sans judaïsme, totalement laïcs,
sachant à peine où se trouve Israël. Quant à Hélène,
c’est un être solaire de vingt-et-un ans à qui
il reste deux ans à vivre , « inondée » de
joie, sous le soleil bleu lavé et les nuages ouatés,
légère à l’idée du lien matériel
qui l’unit désormais au créateur de Monsieur
Teste.
Comme
l’a fort bien exprimé Modiano, la vie d’Hélène
va désormais osciller entre l’ombre et la lumière,
entre le port de l’étoile jaune et le déchiffrage
d’une sonate de Beethoven, entre un formidable désir
d’embrasser le monde qui, parfois, frôle le déni
de la réalité, et la certitude que tout cela finira,
comme son Journal, dans « Horror, horror, horror ».
Il
y a, pour le moment, les vexations et l’exploitation en face
desquelles on se fait tout petit, on biaise : le père d’Hélène
reçoit un avis de spoliation ; la mère le lui cache.
Il faut faire comme si cela n’existait pas pour pouvoir jouir
du « parfum subtil des buis en fleurs, du bourdonnement des
abeilles, de l’apparition soudaine d’un papillon au
vol hésitant et un peu ivre. » Ces touches fulgurantes
me font penser à la nouvelle de Virginia Woolf “ The
Death of the Moth ” : « The same energy which inspired
the rooks, the ploughmen, the horses, and even, it seemed, the
lean bare-backed downs, sent the moth fluttering from side to side
of his square o fthe window-pane. […] One was indeed, conscious
of a queer feeling of pity for him. » Comment mieux passer,
en un clin d’œil, de la nature dans sa folle énergie à la
commisération face au destin d’une petite phalène
innocente…
Privée
d’agrégation pour cause de lois raciales, Hélène
Berr sera une étudiante exceptionnelle et fréquentera
des noms, pour nous anglicistes, très familiers : son professeur
Louis Cazamian, le maître des études anglaises du
XXe siècle, Robert Escarpit, qu’elle aura connu étudiant,
Sylvère Monod, « très gentil », et sa
future femme Anne Digeon, « charmante ». Monod fut
l’un des grands noms des études anglaises de la deuxième
moitié du XXe siècle. Très affecté par
la perte de sa femme, puis par la mort de sa fille, il s’est éteint
en août 2006. Par lui, j’ai l’impression, fausse
bien sûr, qu’Hélène Berr est à portée
de ma main, à deux maillons de la chaîne des lecteurs
de Shelley.
Pour
l’instant, Hélène lit le très délicat
poète Hugo von Hofmannstahl (elle prend des cours d’allemand)
et fait du violon chez les Lyon-Caen. Elle apprend que le frère
de son ami Roger Nordmann vient d’être fusillé,
mais à la bibliothèque d’anglais, elle cherche
une traduction de Coriolan avant de se plonger, « avec un étudiant à qui
[elle n’a] jamais parlé » dans Beowulf, ce long
poème épique du haut Moyen-Âge, le texte fondateur
de la littérature anglaise. Je me demande si cet étudiant
ne pourrait pas être mon maître et ami André Crépin,
l’un des deux ou trois meilleurs spécialistes au monde
de Beowulf.
Et
puis arrive le moment fatidique du port de l’étoile
jaune, ce petit bout de toile qui signe la barbarie à l’état
pur. Sa mère annonce à Hélène la nouvelle
du décret. Celle-ci s’installe d’abord dans
le déni : « je discuterai cela après. » Ce
matin-là, en effet, les oiseaux pépient, « un
matin comme celui de Paul Valéry ». Mais, bien vite,
Hélène réalise qu’elle ne croyait pas
que « ce serait si dur ». Elle s’arme de courage,
garde la tête haute dans la rue, regarde les gens bien en
face, si bien que certains détournent les yeux. Le plus
difficile, c’est de rencontrer d’autres gens qui l’ont,
dit-elle. Deux gosses l’ont montrée du doigt : « Hein
? t’as vu ? Juif. » Le marquage au fer ne s’arrêtera
plus. Le 7 juin 1942, à la demande des autorités
allemandes, le Préfet de Paris oblige les Juifs de ne voyager
dans le métro qu’en seconde classe et dans la dernière
voiture de la rame. Pour éviter tout scandale, le préfet,
toute honte bue, ne communique pas l’information au grand
public.
Hélène
joue le Quatrième Quatuor de Beethoven tout un après-midi.
Elle est éreintée, mais jouit de « la beauté au
cœur de la laideur ». Le père d’Hélène
est emmené à Drancy où, sous le beau soleil,
survivent plusieurs milliers de malheureux dans la pestilence et
l’humiliation. Hélène essaie de faire comme
si : « Je tâche de faire toutes les petites choses
que Papa faisait pour qu’elles n’éveillent pas
trop de souvenirs par leur absence : ouvrir les volets de Maman
le matin, fermer le soir, ouvrir le gaz le matin. »
Après
l’étoile jaune, Pitchipoï, ce lieu mythique dont
les Juifs veulent se persuader qu’il sera le but de leur
déportation alors qu’ils savent que tout se terminera
dans l’enfer des camps d’extermination. Lorsque, ensemble,
ils pensent à l’impensable, à l’innommable,
les Beer mêlent le rire à l’angoisse, font des
plaisanteries qui les empêchent de réaliser le grave
du problème. Et puis il y a surtout cette question sans
réponse : pourquoi sommes-nous persécutés
? Hélène tente d’opposer la raison, un raisonnement à la
barbarie déchaînée : elle ne se sent pas juive,
elle est à mille lieues de la tradition du ghetto, elle
est nourrie de l’esprit de la Révolution Française
qui a défendu les Juifs en tant qu’individus, mais
pour qui la “ race juive ” n’existait pas.
Petit à petit,
l’ombre cache la lumière. Il n’est plus possible à Hélène
d’éprouver des instants de bonheur « unmixed » (dit-elle
dans cet anglais qu’elle maîtrise parfaitement), c’est-à-dire
purs, des instants de rêve. Une amie lui annonce la naissance
de son bébé. Elle ne peut plus se représenter
le fait que de la vie puisse encore apparaître sur terre.
Dans
ce Journal qui est son âme et sa mémoire, qu’il
faudra « sauvegarder » à tout prix, Hélène
continue à égrener l’horreur. Les gendarmes,
qui obéissent aux ordres, arrêtent un bébé de
deux ans pour l’interner. On sort d’un hôpital
un tuberculeux au dernier degré, une jeune femme à deux
doigts d’accoucher, deux malades qui avaient encore des drains
dans le ventre. Une vieille femme impotente est convoquée
avec son infirmière à la Kommandantur. Elle est accueillie
par ces mots : « Vous, l’infirmière, asseyez-vous – la
juive restez debout ! ». Crétinisme d’une civilisation
où la conscience a décroché des sentiments,
de l’humain. Crétinisme de soldats allemands qui tiennent
la porte dans le métro à une Juive qui porte l’étoile.
Crétinisme de barbares incapables, désormais, d’établir
un lieu entre une cause et ses effets.
Dans
un très beau texte de 1931, “ Une pendaison ”,
un épisode auquel il assista et dont il fut l’un des
agents, George Orwell réfléchit soudain à l’exécution
d’une sentence de mort, à ce qui se passe dans l’esprit
et dans la physiologie d’un homme qui va mourir : « Lorsque
je vis le prisonnier faire cet écart pour éviter
la flaque, je vis le mystère, l’injustice indicible
[the unspeakable wrongness] qu’il y a à faucher une
vie en pleine sève. […] Lui et nous, nous formions
un groupe d’hommes qui marchaient ensemble, voyaient entendaient,
sentaient, comprenaient le même monde ; et d’ici deux
minutes, d’un coup net, l’un de nous allait disparaître – un
esprit de moins, un univers de moins. » Hélène
Berr se situe au niveau d’Orwell quand elle explique que
le barbare broie sa victime parce qu’ildécide de ne
pas voir l’humain en elle : « Et des morts, qu’est-ce
que c’est ? C’est mettre fin à des vies pleines
de promesses, de sève à des vies intérieures
aussi bourdonnantes et intenses que la mienne par exemple. Et cela
froidement. C’est tuer une âme en même temps
qu’un corps, alors que les assassins ne voient qu’un
corps ».
On
sait depuis, entre autres, Claude Lévi-Strauss, qu’il
n’y a pas de races, ce que ressent Hélène Berr
dans ses fibres : « je ne me sens pas différente des
autres hommes, jamais je n’arriverai à me considérer
comme faisant partie d’un groupe humain séparé […].
Je souffre de voir le mal s’abattre sur l’humanité ;
mais comme je ne sens pas que je fais partie d’aucun groupe
racial religieux, humain (car cela implique toujours de l’orgueil)
je n’ai pour me soutenir que mes débats et mes réactions,
ma conscience personnelle. » Petit à petit, Hélène
et les siens s’enfoncent mentalement dans la mort. Mourir
pour être hors d’atteinte des Allemands, mourir pour
ne plus pleurer les morts. Cette flamme magnifique, cette beauté « symbole
de la force radieuse » selon sa nièce Mariette Job
ne disparaîtront pas. © La Grand soir,
28 mars 2008
Horror,
horror, horror
Tongue
nor Heart
Cannot
conceive nor name thee !
Horreur,
horreur, horreur
Ni
la langue ni le cœur
Ne
peuvent te concevoir ni te nommer !
Hélène
Berr, l'autre Anne Frank par François
Dufay
C'est
l'événement de la rentrée. Le 3 janvier
paraît aux éditions Tallandier le journal bouleversant
d'une jeune Parisienne juive, Hélène Berr, morte à Bergen-Belsen,
en avril 1945.
C'est
une jeune morte, revenue nous hanter du plus loin de l'oubli.
Née à Paris en 1921, morte en déportation
en 1945, Hélène Berr n'était jusqu'ici qu'un
nom parmi des dizaines de milliers d'autres, gravé sur
la pierre d'un mémorial. De sa vie abrégée
il ne restait que quelques photos montrant une étudiante
au regard ardent, un violon sur lequel elle jouait des sonates
de Mozart, et un pauvre canif, qui l'aida quelque temps à survivre
dans l'enfer d'Auschwitz.
Et
voici qu'en ce début d'année resurgit le journal
intime qu'a tenu cette jeune Parisienne entre 1942 et 1944. Ce
document exceptionnel, conservé par la famille d'Hélène
Berr et déposé depuis 2002 au Mémorial de
la Shoah, est publié par les éditions Tallandier,
avec une préface de Patrick Modiano ( voir page 89 ) .
Née dans une famille juive de vieille souche française
, Hélène Berr préparait l'agrégation
d'anglais. Dans son journal truffé de citations de Shakespeare
ou de Lewis Carroll, la guerre n'est d'abord qu'un mauvais rêve,
qu'elle parvient à oublier le temps d'une « journée
parfaite » à cueillir des framboises, dans la maison
de campagne familiale. Face à l'horreur des temps, l'étudiante
en Sorbonne se raccroche aux après-midi de soleil, aux
poésies de Shelley, aux journées passées
en bibliothèque à flirter avec les garçons.
Le port de l'étoile jaune, imposé en juin 1942,
est une première cassure. Hélène a tout
noté : son désarroi, les gestes de solidarité des
Parisiens dans le métro, le zèle du contrôleur
qui la refoule dans le wagon de queue, réservé aux
juifs. Puis vient l'arrestation de son père, qu'on arrive,
moyennant une rançon, à tirer de Drancy.
Interdite
d'agrégation par les lois raciales, Hélène
devient assistante sociale bénévole à l'Union
générale des israélites de France (Ugif),
organisme communautaire servant d'interface avec l'occupant.
Tragique malentendu : certains croient qu'elle recherche l'immunité-toute
relative-que procure cette fonction, alors que, lucide, elle
se refuse à fuir. Elle qui se sent si seule depuis le
départ de Jean, son fiancé engagé dans la
France libre, se dévoue aux orphelins juifs, qu'elle promène
dans les rues de Paris, petite troupe pathétique promise à l'abattoir.
Elle oeuvre aussi à leur sauvetage, mais doit taire cette
activité clandestine, même dans son journal.
Au
fil des rafles, des déportations et des rumeurs-wagons
plombés, usage de gaz asphyxiants en Pologne-, l'angoisse
devient suffocante. L'incompréhension, voire l'insensibilité,
des non-juifs la tourmente. Son seul réconfort est de
savoir que, confié à une fidèle employée
de maison, son journal lui survivra : « Je sais pourquoi
j'écris ce journal, je sais que je veux qu'on le donne à Jean
si je ne suis pas là lorsqu'il reviendra. Je ne veux pas
disparaître sans qu'il sache tout ce que j'ai pensé pendant
son absence. » Arrêtée avec son père
et sa mère le 8 mars 1944, déportée le jour
de ses 23 ans à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen,
Hélène Berr y est morte en avril 1945, peu de temps
après Anne Frank, du typhus ou battue à mort, selon
les témoignages. A la date du 15 février 1944,
son journal intime s'était interrompu sur cette citation
empruntée à Shakespeare, « Horror, horror,
horror » . 20/12/2007 - - © Le Point - N°1840
Biais
(un homme de)
" Patrick Modiano reste un homme de biais. Un chercheur de
traces doté de l'esprit de fragment. Tout ce qui est frontal
lui demeure étranger, l'inachevé est sa musique
intérieure." Pierre Assouline, Lire, octobre 2003
("Accident Nocturne")
La Biographie Modiano, par
Gérard de Cortanze.
Bon-à-tirer,
n°81, 1er avril 2008.
Bibliographie, Histoire
de la Shoah* jusqu'en
2004.
Bibliographie,Patrick
Modiano
oeuvres,
essais, articles
Dernières
ressources
Poétique
de la trace pour une représentation spectrale de l’Histoire
dans "Le Chercheur de traces" d’Imre Kertész,
"Rue des boutiques obscures" de Patrick Modiano et "Sheol"
de Marcello Fois par Grabiele Napoli
Biographie
<< Patrick Modiano est né le 30 juillet 1945 à
Paris d'un père juif originaire d'Alexandrie et d'une mère
belge débarquée à Paris en 1942 pour tenter
sa chance comme comédienne. Deux parents qui se sont rencontrés
dans le Paris occupé et ont vécu dans une semi-clandestinité.
Le jeune Patrick vivra toute son enfance dans une atmosphère
où flottera toujours comme une "odeur vénéneuse
de l'Occupation", liée à certaines relations
troubles de son père et aux récits entendus. Ballotté
de collège en pension, entre un père absent et une
mère en tournée, très tôt livré
à lui-même, Patrick Modiano gardera de son enfance
aventureuse une nostalgie première, que reflètent
presque tous ses romans, et brutalement interrompue par la mort
tragique en 1957 de son frère cadet, Rudy, à qui
il dédiera tous ses premiers livres.>> Antoine de
Gaudemar et Paule Zajdermann, Un siècle d'écrivain.
<< (...) études a I'école du Montcel à
Jouy-en-Josas (Seine- et-Oise),au collège Saint-Joseph
de Thônes (Haute-Savoie) au lycée Henri-lV (Paris)
; titulaire du baccalauréat, il n'entreprend pas d'études
supérieures ; à partir de 1967 il n'exerce d'autre
activité professionnelle que celle de romancier.>>
Dictionnaire des auteurs Yannick Pelletier, (Laffont).
Biographie
2 «Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pedigree»
Je suis né le 30 juillet 1945, à Boulogne-Billancourt,
11 allée Marguerite, d'un juif et d'une Flamande qui s'étaient
connus à Paris sous l'Occupation. J'écris juif,
en ignorant ce que le mot signifiait vraiment pour mon père
et parce qu'il était mentionné, à l'époque,
sur les cartes d'identité. Les périodes de haute
turbulence provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si bien
que je ne me suis jamais senti un fils légitime et encore
moins un héritier.
Ma mère est née en 1918 à Anvers. Elle a
passé son enfance dans un faubourg de cette ville, entre
Kiel et Hoboken. Son père était ouvrier puis aide-géomètre.
Son grand-père maternel, Louis Bogaerts, docker. Il avait
posé pour la statue du docker faite par Constantin Meunier
et que l'on voit devant l'hôtel de ville d'Anvers. J'ai
gardé son loonboek de l'année 1913, où il
notait tous les navires qu'il déchargeait: le «Michigan»,
l'«Elisabethville», le «Santa Anna»...
Il est mort au travail, vers 65 ans, en faisant une chute.
[...] Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pedigree.
Ma mère et mon père ne se rattachent à aucun
milieu bien défini. Si ballottés, si incertains
que je dois bien m'efforcer de trouver quelques empreintes et
quelques balises dans ce sable mouvant comme on s'efforce de remplir
avec des lettres à moitié effacées une fiche
d'état civil ou un questionnaire administratif.
Mon père est né en 1912 à Paris, square Pétrelle,
à la lisière du 9e et du 10e arrondissement. Son
père à lui était originaire de Salonique
et appartenait à une famille juive de Toscane établie
dans l'Empire ottoman. [...]
La débâcle de juin 1940 le surprend dans la caserne
d'Angoulême. Il n'est pas entraîné avec la
masse des prisonniers, les Allemands n'arrivant à Angoulême
qu'après la signature de l'armistice. Il se réfugie
aux Sables-d'Olonne, où il reste jusqu'en septembre. Il
y retrouve son ami Henri Lagroua et deux amies à eux, une
certaine Suzanne et Gysèle Hollerich, qui est danseuse
au Tabarin.
De retour à Paris, il ne se fait pas recenser comme juif.
Il habite avec son frère Ralph, chez l'amie de celui-ci,
une Mauricienne qui a un passeport anglais. L'appartement est
au 5 rue des Saussaies, à côté de la Gestapo.
La Mauricienne est obligée de se présenter chaque
semaine au commissariat, à cause de son passeport anglais.
Elle sera internée plusieurs mois à Besançon
et à Vittel comme «Anglaise». Mon père
a une amie, Hela H., une juive allemande qui a été,
à Berlin, la fiancée de Billy Wilder. Ils se font
rafler un soir de février 1942, dans un restaurant de la
rue de Marignan, lors d'un contrôle d'identité, contrôles
très fréquents ce mois-là, à cause
de l'ordonnance qui vient d'être promulguée et qui
interdit aux juifs de se trouver dans la rue et les lieux publics
après 8 heures du soir. Mon père et son amie n'ont
aucun papier sur eux. Ils sont embarqués dans un panier
à salade par des inspecteurs qui les conduisent pour «vérification»,
rue Greffulhe, devant un certain commissaire Schweblin. Mon père
doit décliner son identité. Il est séparé
de son amie par des policiers et réussit à s'échapper
au moment où on allait le transférer au dépôt,
profitant d'une minuterie éteinte. Hela H. sera libérée
du dépôt le lendemain, sans doute à la suite
d'une intervention d'un ami de mon père. Qui? Je me le
suis souvent demandé. Après sa fuite, mon père
se cache sous l'escalier d'un immeuble de la rue des Mathurins,
en essayant de ne pas attirer l'attention du concierge. Il y passe
la nuit à cause du couvre-feu. Le matin, il rentre 5 rue
des Saussaies. Puis il se réfugie avec la Mauricienne et
son frère Ralph dans un hôtel, l'Alcyon de Breteuil,
dont la patronne est la mère d'un de leurs amis. Plus tard,
il habite avec Hela H. dans un meublé square Villaret-de-Joyeuse
et Aux Marronniers, rue de Chazelles.
[...] A mesure que je dresse cette nomenclature et que je fais
l'appel dans une caserne vide, j'ai la tête qui tourne et
le souffle de plus en plus court. Drôles de gens. Drôle
d'époque entre chien et loup. Et mes parents se rencontrent
à cette époque-là parmi ces gens qui leur
ressemblent. Deux papillons égarés et inconscients
au milieu d'une ville sans regard. Die Stadt ohne Blick. Mais
je n'y peux rien, c'est le terreau - ou le fumier - d'où
je suis issu. Les bribes que j'ai rassemblées de leur vie,
je les tiens pour la plupart de ma mère. Beaucoup de détails
lui ont échappé concernant mon père, le monde
trouble de la clandestinité et du marché noir où
il évoluait par la force des choses. Elle a ignoré
presque tout. Et il a emporté ses secrets avec lui. Ils
font connaissance, un soir d'octobre 1942, chez Toddie Werner,
dite «Mme Sahuque», 28 rue Scheffer, 16e arrondissement.
Mon père utilise une carte d'identité au nom de
son ami Henri Lagroua. Dans mon enfance, à la porte vitrée
du concierge, le nom «Henri Lagroua» était
resté depuis l'Occupation sur la liste des locataires du
15 quai de Conti, en face de «quatrième étage».
J'avais demandé au concierge qui était cet «Henri
Lagroua». Il m'avait répondu: ton père. Cette
double identité m'avait frappé. Bien plus tard j'ai
su qu'il avait utilisé pendant cette période d'autres
noms qui évoquaient son visage dans le souvenir de certaines
personnes quelque temps encore après
la guerre. Mais les noms finissent par se détacher des
pauvres mortels qui les portaient et ils scintillent dans notre
imagination comme des étoiles lointaines. Ma mère
présente mon père à Jean de B. et à
ses amis. Ils lui trouvent un «air bizarre de Sud-Américain»
et conseillent gentiment à ma mère de «se
méfier». Elle le répète à mon
père, qui, en blaguant, lui dit que la prochaine fois il
aura l'air encore «plus bizarre» et qu'«il leur
fera encore plus peur».
Il n'est pas sud-américain mais, sans existence légale,
vit du marché noir. Ma mère venait le chercher dans
l'une de ces officines auxquelles on accède par de nombreux
ascenseurs le long des arcades du Lido. Il s'y trouvait toujours
en compagnie de plusieurs personnes dont j'ignore les noms. Il
est surtout en contact avec un «bureau d'achats»,
53 avenue Hoche, où opèrent deux frères arméniens
qu'il a connus avant la guerre: Alexandre et Ivan S. Il leur livre,
parmi d'autres marchandises, des camions entiers de roulements
à billes périmés qui proviennent de vieux
stocks de la société SKF et resteront, en tas, inutilisables,
à rouiller dans les docks de Saint-Ouen.
[...] Je me souviens qu'une seule fois mon père avait évoqué
cette période, un soir que nous étions tous les
deux aux Champs-Elysées. Il m'avait désigné
le bout de la rue de Marignan, là où on l'avait
embarqué en février 1942. Et il m'avait parlé
d'une seconde arrestation, l'hiver 1943, après avoir été
dénoncé par «quelqu'un». Il avait été
emmené au dépôt, d'où «quelqu'un»
l'avait fait libérer. Ce soir-là, j'avais senti
qu'il aurait voulu me confier quelque chose mais les mots ne venaient
pas. Il m'avait dit simplement que le panier à salade faisait
le tour des commissariats avant de rejoindre le dépôt.
A l'un des
arrêts
était montée une jeune fille qui s'était
assise en face de lui et dont j'ai essayé beaucoup plus
tard, vainement, de retrouver la trace, sans savoir si c'était
le soir de 1942 ou de 1943.
Au printemps 1944, mon père reçoit des coups de
téléphone anonymes, quai de Conti. Une voix l'appelle
par son véritable nom. Un après-midi, en son absence,
deux inspecteurs français sonnent à la porte et
demandent «monsieur Modiano». Ma mère leur
déclare qu'elle n'est qu'une jeune Belge qui travaille
à la Continental, une compagnie allemande. Elle sous-loue
une chambre de cet appartement à un certain Henri Lagroua
et elle ne peut pas les renseigner. Ils lui disent qu'ils reviendront.
Mon père, pour les éviter, déserte le quai
de Conti. Je suppose que ce n'était plus les membres de
la police des Questions juives de Schweblin mais les hommes de
la Section d'Enquête et de Contrôle - comme pour Sacha
Gordine. Ou ceux du commissaire Permilleux, de la Préfecture.
Par la suite, j'ai voulu mettre des visages sur les noms de ces
gens-là, mais ils restaient toujours tapis dans l'ombre,
avec leur odeur de cuir pourri.
Mes parents décident de quitter Paris au plus vite. Christos
Bellos, le Grec que ma mère a connu chez B., a une amie
qui vit dans une propriété près de Chinon.
Tous trois se réfugient chez elle. Ma mère emporte
ses habits de sports d'hiver, au cas où ils fuiraient encore
plus loin. Ils resteront cachés dans cette maison de Touraine
jusqu'à la Libération et retourneront à Paris
à vélo, dans le flot des troupes américaines.
Début septembre 1944, à Paris, mon père ne
veut pas rentrer tout de suite quai de Conti, craignant que la
police ne lui demande à nouveau des comptes mais cette
fois-ci à cause de ses activités de hors-la-loi
dans le marché noir. Mes parents habitent un hôtel,
au coin de l'avenue de Breteuil et de l'avenue Duquesne, cet Alcyon
de Breteuil où mon père était déjà
venu se réfugier en 1942. Il envoie ma mère en éclaireur
quai de Conti pour connaître la tournure que prennent les
choses. Elle est convoquée par la police et subit un long
interrogatoire. Elle est étrangère, ils voudraient
qu'elle leur dise la raison exacte de son arrivée à
Paris en 1942 sous la protection des Allemands. Elle leur explique
qu'elle est fiancée à un juif avec qui elle vit
depuis deux ans. Les policiers qui l'interrogent étaient
sans doute les collègues de ceux qui voulaient arrêter
mon père sous son vrai nom quelques mois plus tôt.
Ou les mêmes. Ils doivent le rechercher maintenant sous
ses noms d'emprunt, sans parvenir à l'identifier.
Ils relâchent ma mère. Le soir, à l'hôtel,
sous leurs fenêtres, le long du terre-plein de l'avenue
de Breteuil, des femmes se promènent avec les soldats américains
et l'une d'elles essaie de faire comprendre à un Américain
combien de mois on les a attendus. Elle compte sur ses doigts:
«One, two...» Mais l'Américain ne comprend
pas et l'imite, en comptant sur ses doigts à lui: «One,
two, three, four...» Et cela n'en finit pas. Au bout de
quelques semaines, mon père quitte l'Alcyon de Breteuil.
De retour quai de Conti, il apprend que sa Ford, qu'il avait cachée
dans un garage de Neuilly, a été réquisitionnée
par la Milice en juin et que c'est dans cette Ford à la
carrosserie trouée de balles et conservée pour les
besoins de l'enquête par les policiers que Georges Mandel
avait été assassiné. © Gallimard, 2005
Bidault
(Georges)
"A Paris, nulle rue, nulle place ne porte son nom. Son visage,
pourtant, est familier de ceux qui ont vu les images du général
de Gaulle remontant les Champs-Élysées. L'homme
qui, à ses côtés, semble écarter la
foule, c'est lui: Georges Bidault, l'homme qui joua un rôle
essentiel dans la Résistance et la Libération de
la capitale et qui, en raison d'un engagement ultérieur
et radical en faveur de l'Algérie française, fut
victime d'une «entreprise visant à l'expulser de
l'Histoire», comme le déplore Bernard Billaud, conseiller
maître à la Cour des comptes qui œuvre activement
à sa réhabilitation.
Noble figure en effet que celle de Georges Bidault, éditorialiste
lucide de L'Aube qui alerta en 1938 sur la capitulation des démocraties
face à Hitler, à Munich. Complice de Jean Moulin
dès avril 1942, c'est lui qui rédigea le manifeste
du Conseil national de la Résistance, adopté le
27 mai 1943 lors de la célèbre réunion du
48, rue du Four. Son élection à la tête du
CNR par douze voix sur seize, après l'arrestation de Moulin,
souligne son ascendant sur les chefs de la Résistance.
Le 19 août 1944, c'est encore lui qui donne l'ordre de mobilisation
générale dans la capitale et qui accueille cinq
jours plus tard celui «grâce à qui fut préservé
l'honneur comme fut préservé l'avenir». Premier
chef du gouvernement provisoire, fondateur du MRP, premier parti
de France en 1946, il eut ensuite une belle carrière ministérielle
sous la IVe République (président du Conseil, ministre
des Affaires étrangères, de la Défense) et
prépara le terrain pour un règlement du conflit
indochinois.© Le Figaro."
Guillaume Tabard "Bidault à
côté de De Gaulle", 25 août 2004
Bien-être
<< Je rêvais aussi en sortant de chez moi,
je montais au volant d’une très grosse voiture américaine
qui glissait le long des rues désertes en direction du
Bois sans que j’entende le bruit du moteur, et j’éprouvais
une sensation de légèreté et de bien être.>>
D.P.O., p. 139
Bizarre
/Compliqué* Deux mots répétés
à longueur d'entretiens : «C'était bizarre.»
Ou bien : « Il y avait un homme bizarre.» Bizarre,
c'est son mot. Énigmatique, Trouble, Mystérieux,
reviennent aussi fréquemment. Il a beaucoup de souvenirs
de gens bizarres. On sent bien que ce sont ceux-là qui
l'intéressent. Il dit aussi : « C'est compliqué
», lorsqu'il cherche à expliquer ce qu'il semble
ressentir en lui-même.
Bonheur,
mélancolie* (1945)
Jérôme Garcin – Plusieurs fois dans ce livre
[Accident nocturne] vous dites avoir le goût du bonheur
et ordonné votre vie, depuis trente ans, à la manière
d’un jardin à la française. Cela surprend
parce qu’on vous voit davantage du côté de
la mélancolie et des forêts impénétrables...
P. Modiano. – Vous savez, j’ai toujours eu le sentiment
que ma nature profonde était la faculté au bonheur,
mais qu’elle avait été détournée
tout au long de ma vie par des circonstances extérieures.
C’est le hasard qui m’a fait naître en 1945,
qui m’a donné des origines troubles et qui m’a
privé d’un entourage familial. Je ne peux pas me
sentir responsable des idées noires, de l’angoisse,
d’une certaine forme de morbidité qui m’ont
été imposées. Je n’ai jamais choisi
le matériau de mes livres. J’ai dû écrire
non pas avec ce que je suis, c’est-à-dire quelqu’un
de banal et heureux, mais avec ce que le destin a fait de moi.
Comme je le dis à un moment dans ce livre, «à
la profondeur du tourment, je préfère la légèreté
du bonheur». Mais je me console en me disant que tout est
programmé et que si ça n’avait pas été
moi, un autre aurait eu l’impression d’être
un clandestin. Moi, si j’étais né à
la campagne, j’aurais été un écrivain
paysagiste. Cela m’aurait suffi.
Jérôme Garçin – En somme, la phrase
de Jacqueline Beausergent, à la fin d’«Accident
nocturne» – «la vie est beaucoup plus simple
que tu ne le crois», p. 147 –, résonne comme
une morale...
P. Modiano. – Oui, c’est absurde de se faire tant
de mal quand la vie est si bien. Mais, lorsque j’écris,
je ne me maîtrise pas. Et plus je me promets de fuir le
marécage, plus j’y retourne. De même, je n’arrive
pas à utiliser la troisième personne du singulier,
je suis prisonnier du je que j’utilise dans mes romans depuis
toujours.
Jérôme Garcin, Rencontre avec P Modiano,
Le Nouvel Observateur, 2 octobre 2003
Bon
voyage de Jean-Paul Rappeneau (2003),
PM co-scénariste du film
" En juin 1940, à l'hôtel Splendid de Bordeaux sont réunis
ministres, journalistes, grands bourgeois, demi-mondaines et espions de tous
bords. Là, un jeune homme devra choisir entre une célèbre
actrice et une étudiante passionnée, entre les politiques et les
voyous, entre l'insouciance et l'âge adulte."
LES BOULEVARDS DE CEINTURE (19972)
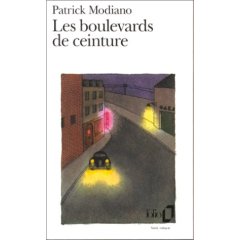
Les
Boulevard de ceinture (1972)
Résumé de l'éditeur
<< Le narrateur part à la recherche de son père.
Le voici dans un village, en bordure de la forêt de Fontainebleau,
du temps de l'occupation, au milieu d'individus troubles. Qui
est ce père ? Trafiquant ? Juif traqué ? Pourquoi
se trouve-t-il parmi ces gens ? Jusqu'au bout le narrateur poursuivra
ce père fantomatique. Avec tendresse.>>
Les
Boulevards de ceinture, premières pages.
Les
Boulevard de ceinture Analyse
du texte. (d'après Mathias Azan)
Bow-windows.
Dans
la plupart des romans de PM les pièces principales sont agrémentées
de Bow-windows, c'est à dire des fenêtres en saillie sur le mur
d'une maison.
Robert
Brasillach
Robert Brasillach fut condamné à mort pour "
intelligence avec l'ennemi " le 19 janvier 1945 et fusillé
au fort de Montrouge le 6 février. On lui reprochait principalement
ses articles de Je suis partout, hebdomadaire dont il fut le rédacteur
en chef, de 1937 à 1939, puis de 1941 à 1943. Deux
dates marquent, selon Alain Decaux, l'entrée en politique
de Robert Brasillach : la manifestation du 6 février 1934,
qui le conduit à se rapprocher de Maurras, dont il adopte
la philosophie, en particulier le nationalisme et l'antisémitisme
; le début de sa collaboration à Je suis partout,
en 1937, aux côtés de Rebatet, Gaxotte, Laubreaux,
qui va le transformer en " une sorte de jouteur politique
" appelé à donner la réplique aux intellectuels
de gauche de Vendredi ou de Marianne.
Le parcours de ce normalien devenu critique littéraire
de L'Action française, puis rédacteur en chef de
Je suis partout est exemplaire dans le genre : prisonnier de guerre
en 1940, il est libéré en avril 1941 sur l'intervention
d'Abetz. Le pamphlétaire devient un des hommes les plus
en vue de la collaboration. Il s'en prend violemment aux juifs,
aux caciques du Front populaire (avec une haine recuite contre
Georges Mandel et Jean Zay, qui seront assassinés). Il
vomit la République, «vieille putain agonisante,
garce vérolée, fleurant le patchouli et la perte
blanche».
Durant son procès Brasillach tient la dragée haute
à l'accusation : « Je ne puis rien regretter de ce
qui a été moi-même. » Son avocat se
trompe de plaidoirie, brillant quand il eût fallu convaincre.
Quant à la pétition rédigée pour réclamer
la grâce de Brasillach, à l'initiative de Jean Anouilh,
Marcel Aymé et François Mauriac, on sait que le
général de Gaulle décida de ne pas y céder.
Il s'en justifia, de façon elliptique quoique transparente,
dans ses Mémoires de guerre, à propos des écrivains
condamnés à mort : « S'ils n'avaient pas servi
directement et passionnément l'ennemi, je commuais leur
peine, par principe. Dans un cas contraire - le seul -, je ne
me sentis pas le droit de gracier. Car, dans les lettres, comme
en tout, le talent est un titre de responsabilité. »
D'après Laurent Douzou, le Monde du 02-11-2001.
Le
cas Brasillach par Andrès Laurens
Robert Brasillach, écrivain et journaliste, considéré
comme l'un des meilleurs critiques de sa génération,
polémiste de l'extrême droite fasciste, a été
fusillé le 6 février 1945, après avoir été
condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi
pendant la seconde guerre mondiale, alors que le territoire français
était occupé par les troupes de l'Allemagne hitlérienne.
Il avait trente-cinq ans. S'il n'avait pas été exécuté,
s'il ne s'était pas présenté devant ses juges
_ ce qu'il a fait pour protéger les siens, _ s'il avait
su " se faire oublier l'espace d'une demi-année, écrivait
François Mauriac en 1967, peut-être aujourd'hui ses
amis lui offriraient-ils une belle épée d'académicien
". C'est dire combien cette exécution fut, sur le
moment et aujourd'hui encore, déplorée par beaucoup,
notamment par certains de ceux qui ne partageaient pas les idées
de Brasillach et les combattaient. A l'inverse d'autres, qui n'éprouvent
aucune haine pour l'homme, estiment qu'il a subi, compte tenu
de ses engagements et des circonstances historiques, la condamnation
qu'il encourait. Même si la sanction n'a pas été
égale pour tous ceux qui en étaient passibles, parfois
plus que lui.
Deux livres reviennent sur le cas Brasillach, sujet qui fut, longtemps
après, difficile à traiter dans la sérénité,
tant les cicatrices étaient restées douloureuses.
Depuis, les historiens ont fait un travail considérable
pour la compréhension de cette époque et de ses
acteurs, parmi lesquels se détache le curieux visage de
Robert Brasillach : il revient donc, dans la vitrine des libraires,
en couverture des deux livres qui lui sont consacrés. Comme
le temps passe, est-on tenté de dire, par référence
au titre d'un de ses romans les plus connus ! Pierre Pellissier
ne cherche pas à rouvrir le procès ou à relancer
la controverse. Ce qui l'intéresse, c'est la fulgurance
de ce destin tragique traversant une époque troublée.
Dans une approche toute de mesure et de subtilité, il parvient
à rendre compte de la trajectoire nette de " Brasillach...
le maudit " dans l'opacité de son temps.
Le titre de la biographie souligne la plus forte contradiction
du personnage, qui en connaissait bien d'autres. Il avait tout
pour échapper à la malédiction : esprit brillant,
fécondité littéraire, curiosité dévorante,
amour de la vie. Il paraissait voué à une longue
carrière d'écrivain, comme d'autres qui, avant ou
après lui, ont considéré que seule la jeunesse
valait la peine d'être vécue. Au lieu de cela, il
s'est enfermé dans la logique d'un engagement idéologique
qui l'a perdu, où, comme le suggère Pierre Pellissier,
il s'est pris dans une succession de pièges qui le condamnaient
à terme.
L'engagement dans le fascisme pourrait surprendre de la part d'un
intellectuel qui s'est, à ce point, abreuvé aux
sources de l'humanisme classique. Il n'est pas le seul dans ce
cas, et l'extrême droite maurrassienne, par où il
avait commencé, ne l'a pas retenu d'aller si loin. Au reste,
on sait bien que la culture la plus riche ne protège pas
des pulsions les plus profondes et qu'au contraire loin d'en être
tempérées celles-ci se nourrissent souvent de celle-là.
Pierre Pellissier note, tout en s'interdisant de chercher systématiquement
les clefs de l'écrivain dans son oeuvre, que, dans Présence
de Virgile, Brasillach peignait aux couleurs de son temps le poète
latin : " Pour sauver ce pays et cet ordre, il savait que
la force était nécessaire. Mais il ne craignait
pas d'en appeler à la force, il l'aimait comme il est naturel
à son âge. Par regret d'être lui-même
trop faible de corps, trop rêveur encore d'esprit pour agir,
il aimait les grands vainqueurs qui violent toutes les lois jusqu'au
moment où ils en donnent aux autres. "
Notre biographe retient que ce jeune homme, qui se croyait anarchiste,
est choqué par le désordre et l'" absence de
direction " qu'il trouve en arrivant à l'Ecole normale
supérieure. Ses inclinations et ses amitiés (Maurice
Bardèche, Thierry Maulnier) l'attirent vers l'Action française,
Maurras, Bainville, Massis, avant qu'il ne s'engage personnellement
dans un fascisme pur et dur pour, écrit Pierre Pellissier,
" échapper à ses propres contradictions ".
Le voici donc à la recherche d'un " antisémitisme
de raison " (!), de la même façon qu'il tentera
de définir après la défaite, derrière
Philippe Pétain, " un collaborationnisme de raison
".
La raison, en vérité, on se demande où elle
pourrait trouver sa place dans la fureur qui le pousse à
la polémique la plus ordurière, ou qui lui fait
réclamer la mort pour les hommes politiques de la Troisième
qu'il rend responsables de la défaite. Ses articles dans
l'hebdomadaire Je suis partout, dont il a été le
rédacteur en chef, en témoignent. Pierre Pellissier
montre bien comment le " romantique fasciste " est devenu,
peu à peu, prisonnier de son rêve, celui d'une Europe
fasciste, en communion avec une Allemagne à laquelle il
s'attache d'amour, au fur et à mesure que, précisément,
le rêve s'écroule. Cependant, Brasillach reste conscient
de ses responsabilités en songeant à tous ceux qui,
pour l'avoir lu et cru, se sont engagés dans la Légion
des volontaires français aux côtés des troupes
nazies. " Je veux être jugé, peut-être
fusillé, mais ils ne pourront pas dire : le salaud s'en
est tiré ", dira-t-il avant de se constituer prisonnier,
au lieu de continuer à se cacher ou de fuir, comme il en
avait la possibilité et comme bien d'autres l'ont fait.
" Il s'était choisi un rôle, il s'y tiendra
", écrit Pierre Pellissier. Brasillach ne s'en est
donc pas tiré, malgré les démarches faites
en sa faveur par des écrivains prestigieux, malgré
l'intervention de François Mauriac auprès du général
de Gaulle qui, finalement, dans des conditions controversées,
refusa la grâce. " Son procès fut une parodie
? C'est l'évidence. D'autres que lui furent bien plus coupables
et ne furent pas point condamnés. Chacun le sait. Il reste
que la mort restitue toute sa dignité à un combat.
Au nom de quoi pourrait-il y avoir un privilège pour la
protection de l'écrivain et un droit au peloton pour d'autres
? ", écrit Alain Griotteray, peu suspect de sympathie
pour la gauche, en préfaçant le travail d'un jeune
historien, Pascal Louvrier, intitulé Brasillach, l'illusion
fasciste.
Dans cet ouvrage, tiré d'une étude universitaire,
l'auteur, ému par l'écrivain, intrigué par
le polémiste engagé, cherche à comprendre
l'opposition aussi nette, aussi tranchée, entre les deux
facettes de la même personnalité. A cette fin il
décrit, en s'abritant derrière le principe d'impersonnalité,
qui n'exclut pas une attention empreinte de sympathie pour certains
traits du personnage, le climat intellectuel des années
30, cette époque charnière qui produisit tant d'intellectuels
non conformistes par réaction à l'ordre bourgeois.
Il raconte comment Brasillach, " passéiste convaincu
", nostalgique de la jeunesse avant de l'avoir tout à
fait vécue, s'est plongé dans le siècle.
Sonanticonformisme à lui s'est incarné dans un "
fascisme impressionniste " qui est devenu peu à peu
systématique, jusqu'à la désillusion finale.
Jusqu'à l'absurde, puisque cet écrivain, si charnellement
attaché à sa patrie, a péri, exécuté
comme traitre, en criant : vive la France.
Robert Brasillach garde une part de son mystère mais son
histoire vaut d'être contée et connue pour rappeler
que les mots sont des armes ; que le talent, loin d'enrober d'innocence
ceux qui les manient, les rend plus responsables ; que l'autorité
intellectuelle ne saurait s'exercer en toute impunité.
Le Monde, 5 novembre 1989
Fallait-il
faire mourir Brasillach ? Le dossier d'Alain Decaux par Thomas
Ferenczi
Rédacteur en chef de Je suis partout et partisan de la
collaboration avec l'Allemagne sous l'Occupation, l'écrivain
a été fusillé à la Libération.
Le général de Gaulle a refusé sa grâce.
Près d'un demi-siècle plus tard, Alain Decaux rouvre
le dossier.
eE
procès Barbie attire de nouveau l'attention sur la période
de l'Occupation. Les souvenirs, les récits, les questions
reviennent. Est-ce une raison pour rouvrir le procès Brasillach
? Une biographie récente s'y emploie, d'une manière
peu convaincante, sous prétexte de " comprendre "
l'homme (1). Alain Decaux s'y risque à son tour. Il ne
convainc pas davantage, mais reconnait, au moins, que son admiration
pour l'écrivain trouble son jugement.
Robert
Brasillach fut condamné à mort pour " intelligence
avec l'ennemi " le 19 janvier 1945 et fusillé au fort
de Montrouge le 6 février. On lui reprochait principalement
ses articles de Je suis partout, hebdomadaire dont il fut le rédacteur
en chef, de 1937 à 1939, puis de 1941 à 1943. Alain
Decaux, qui avait alors près de vingt ans, dit qu'il a
été " révolté " par cette
exécution. Et il demande, aujourd'hui, plus de quarante
ans après : " Fallait-il faire mourir Robert Brasillach
? "
A
cette question, il refuse de donner une réponse catégorique,
mais ne cache pas sa propre préférence. " Tout
se résume à ceci, conclut-il au terme du "
dossier " qu'il consacre à Robert Brasillach : un
écrivain, parce qu'il est écrivain et parce qu'il
a du talent, a-t-il droit à un traitement de faveur ? Doit-on
oublier sa responsabilité ? Chacun se décide selon
sa conscience. " Pour sa part, _ peut-être parce que,
dit-il, il avait lui-même déjà choisi, à
l'époque, de devenir un écrivain _ il déclare,
en conscience : " Personnellement je n'ai pas supporté
la mort de Robert Brasillach. "
Cette
émotion, d'autres qu'Alain Decaux l'ont à coup sûr
ressentie en apprenant l'exécution de Robert Brasillach.
Car l'ancien rédacteur en chef de Je suis partout, admirateur
du fascisme italien et partisan de la collaboration avec l'Allemagne,
était avant tout, pour une grande partie de la jeunesse,
un romancier célèbre, auteur, entre autres, de Comme
le temps passe et des Sept Couleurs, qui soulevèrent l'enthousiasme
d'une génération ; un critique respecté,
depuis ses débuts à l'Action française, à
l'âge de vingt-deux ans ; " un doux amateur de poésie
", comme le dira plus tard Claude Roy, qui fut alors son
ami ; un passionné de théâtre (il fréquentait
les Pitoeff, qu'il adorait) et de cinéma (il s'en fit l'historien,
avec Maurice Bardèche).
En
revanche, son engagement politique passait au second plan. Et
de fait, dans les années 30, il donnait résolument
la priorité à la littérature sur le militantisme.
Alain Decaux rappelle que, avec sa " bande d'amis "
du lycée Louis-le-Grand, puis de l'Ecole normale supérieure,
il n'affiche " aucune option politique " et que, s'il
entre à l'Action française, dont l'idéologie
imprègne alors " le climat du quartier Latin ",
c'est pour y tenir une chronique purement littéraire.
Deux
dates marquent, selon Alain Decaux, l'entrée en politique
de Robert Brasillach : la manifestation du 6 février 1934,
qui le conduit à se rapprocher de Maurras, dont il adopte
la philosophie, en particulier le nationalisme et l'antisémitisme
; le début de sa collaboration à Je suis partout,
en 1937, aux côtés de Rebatet, Gaxotte, Laubreaux,
qui va le transformer en " une sorte de jouteur politique
" appelé à donner la réplique aux intellectuels
de gauche de Vendredi ou de Marianne.
Le
voilà dès lors associé, comme le souligne
Alain Decaux, à " la droite la plus extrême
". Il sera, bien sûr, du côté de Franco
pendant la guerre d'Espagne, puis de Mussolini en Italie. Il ne
protestera pas contre l'invasion de la Tchécoslovaquie
par Hitler en 1939 et se fera, après la défaite,
le défenseur de la politique de collaboration avec l'Allemagne.
Mieux même : il proposera de substituer l'" alliance
" à la collaboration. " Ça, c'était
aller très loin ", s'écrie Alain Decaux.
Persuadé
de la victoire de l'Allemagne, Robert Brasillach accepte donc
de pactiser avec l'ennemi, afin de garder à la France,
explique Alain Decaux, " quelques atouts ". Il précisera
dans le mémorandum écrit en vue de son procès
: " Cette collaboration a été la politique
de l'existence même et de la durée de la patrie.
Même en admettant que l'Allemagne devait être vaincue,
il a été bon, l'histoire le dira, qu'un mince rideau
de collaborationnistes fasse écran entre l'occupant et
l'occupé... Les collaborationnistes, et je ne parle que
des sincères, pas du tout de ceux qui jouaient double jeu,
ont permis aux autres de vivre d'abord, de s'organiser et même,
après tout, de résister. "
Argument
devenu classique à la Libération, mais qui ne saurait
en tout état de cause faire accepter l'approbation donnée
par Robert Brasillach aux actes de l'occupant allemand (otages
fusillés, résistants déportés, juifs
persécutés, etc.), ni ses réactions d'indignation
à l'annonce du débarquement allié comme,
quatre ans auparavant, à celle de l'appel du 18 juin, ni
surtout les incitations au meurtre lancées dans certains
de ses articles. Robert Brasillach sera donc condamné à
la peine capitale et, malgré l'appel de plusieurs dizaines
d'intellectuels en sa faveur, le général de Gaulle
refusera de le gracier.
Verdict
injuste ? A ceux qui, pour une raison ou pour une autre, soutiennent
encore cette thèse, on peut opposer au moins quelques éléments
de réflexion : 1) Le privilège de l'écrivain,
invoqué plus ou moins nettement par Alain Decaux, ne saurait
être tenu pour valable : si Robert Brasillach était
coupable de ce dont on l'accusait, sa qualité d'homme de
lettres ne devait en aucune façon le protéger. 2)
Etait-il coupable ? De collaboration avec l'occupant, sans aucun
doute, même si sa responsabilité ne fut pas celle
d'un dirigeant politique. Son procès a-t-il été
bâclé, comme le dit Alain Decaux, et les choses se
seraient-elles passées autrement s'il avait attendu que
s'apaisent les passions de l'épuration ? Rappelons que
ses collègues de Je suis partout, Lucien Rebatet et Alain
Laubreaux, partis pour l'Allemagne à la libération
de Paris, ont été condamnés à mort
à leur retour en France, avant d'être graciés
par Vincent Auriol. 3) Fallait-il exécuter la sentence
? On peut se sentir aujourd'hui plus proche des signataires de
l'appel à la clémence, ne serait-ce que par refus
de la peine de mort, que du général de Gaulle, dont
on ignore encore exactement pourquoi, après avoir semblé
favorable à la grâce, il l'a finalement refusée.
N'oublions pas cependant que si, avant Robert Brasillach, Henri
Béraud avait été gracié, deux autres
écrivains, Georges Suarès et Paul Chack, avaient
été fusillés. Robert Brasillach a subi, lui
aussi, jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes,
les rigueurs de la justice. © Le Monde 7 juin
1987
Le
singulier destin de Robert Brasillach par Laurent Douzou
Le romancier et journaliste de « Je suis partout »
fut jugé pour intelligence avec l'ennemi et exécuté
en février 1945. A partir du procès, Alice Kaplan
mène l'enquête sur un collaborationniste plein de
haine, dont les écrits étaient - et demeurent -
accablants.
Le livre qu'Alice Kaplan, professeur de littérature à
Duke University, a consacré au procès de Robert
Brasillach, accède au format de poche deux ans après
sa première parution dans une traduction dont le titre
français reflète bien, par son ambivalence, la question
que pose ce destin singulier. Il est heureux que cette enquête
menée avec maestria, qui conjugue connaissance des enjeux
historiographiques et souci de cerner les trajectoires des protagonistes
d'un procès qui les réunit six heures de leur vie
le 19 janvier 1945, soit ainsi mise à la portée
d'un vaste lectorat.
L'auteur n'a pas voulu écrire une biographie mais reconstituer
le procès de Brasillach pour comprendre la logique profonde
et la procédure judiciaire qui conduisirent un écrivain
fasciste à la mort, il y a soixante ans. Jugé par
la cour de justice de la Seine en vertu de l'article 75 du code
pénal pour intelligence avec l'ennemi, Brasillach fut condamné
à mort. Le général de Gaulle ayant refusé
sa grâce, il fut exécuté le 6 février
1945.
Au procès, son avocat, Jacques Isorni, peignit l'accusé
sous les traits d'un partisan de Vichy et de Pétain, d'un
poète, non d'un propagandiste aligné sur les thèses
nazies. Il frayait ainsi la voie à ceux qui ont tenté
depuis de réhabiliter sa mémoire dans le sillage
de Maurice Bardèche, éditeur des oeuvres complètes
de son beau-frère. En scrutant avec une attention particulière
les textes de l'écrivain, Alice Kaplan montre comment ils
furent émondés après sa mort, afin que le
sens puisse en être infléchi. C'est que les écrits
de Brasillach étaient - et demeurent - accablants.
Comment son nom est-il devenu celui du prototype
du collaborateur ? Né en 1909 à Perpignan, ce fils
d'un officier tué en 1914 au Maroc eut une enfance bourgeoise
à Sens, où son beau-père était médecin.
Admis à l'Ecole normale supérieure en 1928, il se
fit journaliste et écrivain. Responsable de la page littéraire
de L'Action française, il se radicalisa et rejoignit Je
suis partout, dont il fut rédacteur en chef à partir
de 1937. Il y exhala un antisémitisme tenace. Si le romancier
Brasillach faisait montre d'une « sentimentalité
mièvre », le journaliste trempait sa plume dans l'acide.
Prisonnier de guerre en 1940, libéré en 1941 sur
demande de l'ambassade allemande à Paris en tant qu'intellectuel
français susceptible d'aider la cause nazie, Brasillach
devint un collaborationniste plein de haine. Il fit de Reynaud,
de Blum et de Mandel ses cibles privilégiées. Dans
un article de février 1942, « La conjuration antifasciste
au service du Juif », il assimilait la République
à une « vieille putain agonisante, garce vérolée,
fleurant le patchouli et la perte blanche ». Deux mois après
la rafle du Vél'd'Hiv', il proclamait la nécessité
de « se séparer des Juifs en bloc et de ne pas garder
les petits ». Ayant rompu avec Je suis partout en août
1943, il n'en continua pas moins dans la même veine. En
février 1944, il écrivait dans Révolution
nationale : « J'ai contracté, me semble-t-il, une
liaison avec le génie allemand, je ne l'oublierai jamais.
Qu'on le veuille ou non, nous aurons cohabité ensemble.
Les Français de quelque réflexion, durant ces années,
auront plus ou moins couché avec l'Allemagne, non sans
querelles, et le souvenir leur en restera doux. »
Arrêté fin août 1944 à Paris, Brasillach
passa cinq mois en prison, ayant « l'impression, écrivit-il
à son avocat, de préparer l'oral d'un concours ».
L'oral se passa mal. Non que Brasillach ait cédé
face à l'accusation : « Je ne puis rien regretter
de ce qui a été moi-même. » Mais le
procureur général Marcel Reboul enfonça habilement
le coin, citant les écrits de l'accusé, y compris
ceux qui vouaient les juifs aux gémonies. Jacques Isorni
fut brillant là où il eût fallu convaincre
et émouvoir. Les jurés - un imprimeur, un ingénieur,
un employé, un technicien - le condamnèrent.
En dépit des efforts d'Alice Kaplan, partie sur leurs traces
avec de maigres indices, ces quatre-là conserveront leur
mystère. L'enquête est passionnante, même si
les tombeurs de « la star de la collaboration littéraire
» restent finalement des ombres. Il en va autrement des
signataires de la pétition pour la grâce de Brasillach,
initiative de Jean Anouilh, Marcel Aymé et François
Mauriac. Claudel, Cocteau, Colette, Paulhan, Valéry la
signèrent. Camus signa aussi, s'en expliquant ainsi à
Marcel Aymé : « J'ai toujours eu horreur de la condamnation
à mort et j'ai jugé qu'en tant qu'individu du moins
je ne pouvais y participer, même par abstention. C'est tout.
Et c'est un scrupule dont je suppose qu'il ferait bien rire les
amis de Brasillach... Ma signature va se trouver parmi les vôtres,
tandis que celle de Brasillach n'a jamais joué en faveur
de Politzer ou Jacques Decour. » © Le
Monde 17 octobre 2003
L'exécution
de Robert Brasillach par Jean-Marc Theolleyre
Il y a cinquante ans, l'écrivain, symbole de la collaboration
avec les nazis, était exécuté au fort de
Montrouge
LE
6 février 1945, Le Monde, daté du 7, publiait l'information
suivante : « Robert Brasillach a été fusillé
ce matin. Le condamné a été réveillé
vers 7 h 30 dans sa cellule de la prison de Fresnes par M. François,
substitut qui représentait le procureur de la République.
Le magistrat était accompagné de M. Reboul, commissaire
du gouvernement qui requit la peine capitale, de M. Raoult, juge
d'instruction accompagné de son greffier M. Linker, de
M Jacques Isorni, défenseur de Brasillach, et du docteur
Paul, médecin légiste. » Robert Brasillach
a appris avec sang-froid que sa grâce était rejetée
puis, après s'être confessé, il s'est acheminé
vers la voiture cellulaire. Avant d'y prendre place, il a déclaré
à son avocat : « C'est aujourd'hui le 6 février,
un anniversaire. Vous penserez à moi et aux autres »
[Référence à la manifestation de l'extrême
droite contre le Palais-Bourbon le 6 février 1934 qui se
solda par une vingtaine de morts]. » Parvenu au fort de
Montrouge où l'exécution devait avoir lieu, il demanda
à s'entretenir brièvement avec M. Reboul, commissaire
du gouvernement. « Vous avez fait votre devoir, dit-il,
moi j'ai agi pour ma patrie. Dieu nous jugera. » »
Enfin, conduit au poteau d'exécution, il repoussa le bandeau
qu'on lui tendait et, avant que la salve n'éclatât,
il cria : « Courage : Vive la France ! » Il était
exactement 9 h 30. Le corps de Robert Brasillach a été
inhumé au cimetière de Thiais. »
Ainsi
s'achevait tragiquement la vie d'un homme de trente-six ans, écrivain
et journaliste, riche de tous les talents, nourri comme son maître
Charles Maurras de tous les miels du classicisme et emporté,
comme lui, par une passion politique qui, dans les années
30 et plus encore dans celles de l'Occupation, devait faire de
lui un inconditionnel du national-socialisme. Robert Brasillach
ne fut pas le seul « intellectuel » ou homme de plume
à payer de sa vie des écrits dans lesquels la justice
de la Libération pouvait voir juridiquement des actes d'intelligence
avec l'ennemi. C'est cependant autour de son seul nom qu'un demi-siècle
après tournent toujours les discussions et se rallument
les polémiques sur au moins l'un des aspects de l'épuration.
Celle-ci fit d'emblée la part belle aux journalistes «
collaborateurs ». Ce fut le cas bien sûr pour Robert
Brasillach, dont le seul nom se confondait avec les férocités
de l'hebdomadaire Je suis partout, dont il avait été
le rédacteur en chef de 1941 à 1943. Ce le fut aussi
pour Henri Béraud, le pamphlétaire de Gringoire,
pour Jean Luchaire, rédacteur en chef du Matin puis des
Nouveaux Temps, pour Jean Herold-Paquis, la « voix »
du Radio-Paris « allemand », pour Georges Suarez,
directeur d'Aujourd'hui, pour Charles Maurras et Maurice Pujo,
piliers d'une Action française maréchaliste et antisémite,
et pour bien d'autres de moindre renommée.
Ces
procès se succédèrent dans l'hiver 1944-1945
et se prolongèrent, pour certains, jusqu'au début
de 1947. Tous furent d'ailleurs assez rapidement instruits et
rapidement jugés. On jugeait le poids des mots et avec
lui le poids du talent de ceux qui les maniaient comme on manie
une arme. Les mots sont-ils innocents ? En décembre 1944,
en janvier 1945 et jusqu'en mai, la guerre contre l'Allemagne
nazie n'est pas terminée. Les souvenirs sont encore là,
immédiats, des rigueurs de l'occupation, des exécutions
d'otages, des rafles, des arrestations, des tortures. Comme sont
là ceux des écrits qui approuvèrent ces actes
quand ils ne les avaient pas appelés ouvertement. La passion
ne pouvait pas être absente de cette justice, au point pourquoi
le nier ? qu'elle ne soit plus la justice. C'est le temps où
Emmanuel d'Astier de la Vigerie, au nom du Mouvement de libération
nationale (MLN), réclame des têtes. C'est celui où
Jacques Duclos exprime les exigences du Parti communiste : «
Il faut juger avec une haine sacrée. »
Contrairement
à un Louis-Ferdinand Céline, à un Abel Bonnard,
Robert Brasillach n'a pas cherché dans la fuite à
Sigmaringen un hypothétique salut. S'il s'est caché
à Paris durant quelques semaines, il s'est livré
le 14 septembre, dès qu'il sut que des membres de sa famille
avaient été arrêtés à sa place.
Lorsque
son procès s'ouvre devant la cour de justice de la Seine
le 19 janvier 1945, à 13 heures, le général
de Gaulle vient de gracier Henri Béraud, condamné
à mort par cette même juridiction, le 29 décembre
1944. De son côté, Charles Maurras va s'entendre
reconnaître des circonstances atténuantes par la
cour de justice du Rhône, le 27 janvier 1945. Dans la grande
salle de la cour d'assises, au palais de justice de Paris, Robert
Brasillach est seul à occuper ce box où ne paraîtront
qu'en novembre 1946 les autres « grandes plumes »
de Je suis partout, Pierre-Antoine Cousteau, Claude Jeantet et
Lucien Rebatet, qui tous trois se retrouveront un jour libres.
Il a pour avocat Jacques Isorni. Le président est M. Vidal,
conseiller à la cour d'appel de Paris. Il est entouré
de quatre jurés. Ceux-ci, conformément à
l'ordonnance du 28 novembre 1944 qui a institué les cours
de justice, ont été choisis sur une liste établie
par des commissions comprenant un magistrat et deux délégués
des comités départementaux de Libération.
De
l'homme, les débats apprendront peu de chose. Il est né
en 1909 à Perpignan. Il a été un brillant
sujet de l'Ecole normale supérieure. Séduit par
Charles Maurras, il se voit confier par le vieux leader monarchiste
le feuilleton littéraire de L'Action française.
Les juges se soucient peu de littérature. Moins encore
de la publication en 1931 d'une Présence de Virgile, d'un
Corneille en 1938. Ce que l'on attend, c'est le politique, celui
qui, dès 1934, arrive à Je suis partout, ce rédacteur
en chef de vingt-cinq ans qui bientôt va célébrer
de son lyrisme les grand'messes nazies de Nuremberg ; celui qui,
comme son journal, rejeta en 1938 toute idée de guerre
pour « l'invivable Tchécoslovaquie », comme,
dans L'OEuvre, Marcel Déat refusera de « mourir pour
Dantzig ».
Contre
Béraud, il n'y avait que des pamphlets exprimant une haine
viscérale, maladive, de l'Angleterre. Contre Brasillach,
il y a des articles beaucoup plus redoutables. Depuis dix ans,
l'auteur des Sept couleurs prône un nationalisme qui le
subjugue. Fait prisonnier en 1940, il a été libéré
à la demande du gouvernement de Vichy. Il a repris sa place
à Je suis partout dès avril 1941. Les nazis sont
là. Il s'affiche avec eux. Dès septembre 1941, il
demande sans fioritures la mort des « traîtres »
Reynaud, Mandel, Blum : « Il a pu y avoir, quelque condamnable
qu'il ait été, beaucoup de chaleur humaine autour
de Jaurès. Que voulez-vous qu'il y ait autour de Reynaud
ou de Blum ? Qui a jamais eu envie de mourir pour Reynaud ou pour
Blum ? On les laissera crever sans sourciller, qu'on se se rassure.
Mais c'est urgent. »
L'ACCUSATION
n'a que l'embarras du choix. Le commissaire du gouvernement cite
les plaidoyers pour la Légion des volontaires français,
la LVF, sur le front de l'Est, les appels à la jeunesse
pour qu'elle s'engage dans cette formation. Il relève l'opprobre
jetée contre la Résistance, les maquis. Il lit,
en date du 25 septembre 1942 : « L'archevêque de Toulouse
proteste contre les mesures prises envers les juifs apatrides
en zone occupée et accuse le gouvernement du maréchal
de suivre des inspirations étrangères. Il parle
de brutalités et de séparations que nous sommes
tout prêts à ne pas approuver car il faut se séparer
des juifs en bloc et ne pas garder les petits. » Le 11 avril
de la même année, la profession de foi était
réitérée : « La collaboration ? C'est
trop peu dire que nous voulons d'elle et le mot, si beau qu'il
soit, puisqu'il signifie le travail en commun, est peut-être
trop usé avant d'avoir servi faute d'avoir été
bien défini. Ce que nous voulons, autant que cela dépend
de nous, ce n'est pas la collaboration, c'est l'Alliance. »
Comment
se défendre ? Brasillach dit : « On prend des phrases,
les plus violentes, celles que rien n'explique parce qu'on a supprimé
tout ce qui pourrait les expliquer. » Sur le fond, il ne
se renie pas. Oui, il a été partisan de la collaboration,
même d'une alliance avec les nazis. Oui, il a cru que ce
« nouvel ordre européen » mis en place par
le III Reich était la voie de l'avenir. Oui, il a réclamé
la tête des députés communistes détenus
par Vichy comme il a appelé de ses voeux des sanctions
impitoyables contre les responsables de la défaite. Finalement,
il fait tenir sa défense dans ce raccourci : « Partisan,
oui, je l'ai été. Etre partisan, c'est aller à
l'excès, à l'injustice en des temps inhabituels.
Quand la France est divisée en temps de guerre civile,
des Français prennent parti pour un camp ou pour un autre.
Alors, naturellement, ils se traitent de traîtres, de rebelles.
Seule l'Histoire juge qui a raison. »
S'il
se défend, il sait aussi attaquer, griffer, non pas certes
avec la véhémence et la fureur que montrera son
maître Charles Maurras à son propre procès,
lancé dans une défense de rupture, mais tout de
même. Comment nierait-il avoir participé à
tant de manifestations à la louange du national-socialisme
? On l'y a suffisamment vu et entendu. Mais lui-même se
plaît à dire qu'il y a vu des confrères comme
Georges Duhamel ou Jean Giraudoux, que la justice laisse en paix.
Va-t-on retenir à charge sa qualité d'administrateur
de la librairie Rive gauche, fief de toutes les publications de
la collaboration ? Il rétorque que cette librairie exposait
aussi des livres de Louis Aragon et d'Elsa Triolet.
Il
se défend mais il est assez lucide pour être sans
illusion. Alors, il a cette adresse à ses juges : «
Sans doute la cour pourrait se demander si je regrette ce que
j'ai écrit. Si je répondais que je le regrette,
vous penseriez tous que je cherche à sauver ma peau et
vous me mépriseriez à bon droit. Je vous dirai donc
que j'ai pu me tromper quant à certains faits ou quant
à certaines personnes. Mais je n'ai rien à regretter
de l'intention qui m'a fait agir. Je ne puis rien regretter de
ce que j'ai été moi-même. »
A
18 heures, cinq heures après l'ouverture du débat,
l'arrêt était rendu. La cour de justice de la Seine
suivait sans états d'âme les réquisitions
de M. Reboul, commissaire du gouvernement. Robert Brasillach était
condamné à mort. Du maigre public cantonné
au fond de la salle,une voix lança : « C'est une
honte ! » Brasillach se tourna vers ce public d'où
était parti le cri pour répliquer : « Non
: c'est un honneur. »
Il
accepta de signer un pourvoi en cassation vite rejeté.
Restait le recours en grâce. C'est à Charles de Gaulle,
président du Gouvernement provisoire de la République
française, qu'il revenait de l'examiner et d'exercer ce
pouvoir régalien duquel dépendait, en cette occurrence,
une mort bientôt consommée ou la poursuite d'une
vie. Le chef du gouvernement provisoire avait nous l'avons vu
grâcié, le 4 janvier 1945, Henri Béraud pour
lequel s'étaient mobilisés des écrivains,
des journalistes. Mais nous l'avons vu aussi, il y avait entre
le cas de Béraud et celui de Brasillach bien des différences,
pour ne pas écrire qu'ils étaient sans commune mesure.
Henri
Béraud n'avait jamais fait partie des intellectuels ou
hommes de plume revenus volontairement en zone occupée
après l'armistice de 1940. S'il affichait depuis longtemps,
bien avant la guerre, une haine inextinguible envers l'Angleterre
(Faut-il réduire l'Angleterre en esclavage ?, avait-il
intitulé un de ses brûlots), celle qu'il nourrissait
à l'endroit des Allemands n'était pas moindre. Mais
pour ses juges, il n'y avait sans doute pas que le dossier proprement
dit, réunissant non sans mal des écrits dans lesquels
on pouvait difficilement voir des intelligences avec l'ennemi.
Béraud, c'était pour bien des résistants
hommes de gauche le pamphlétaire acharné à
la perte de Roger Salengro, ministre de l'intérieur du
Front populaire. Et celui-ci devait se donner la mort, désespéré
de n'avoir pu convaincre ses adversaires qu'il n'avait été
durant la guerre de 1914-1918 ni le déserteur ni le lâche
dépeint par l'extrême droite. Ces brutalités
sans mesures ni regrets remontaient à moins de dix ans
de 1945.
FRANÇOIS
MAURIAC s'en mêla. Dans Le Figaro du 4 janvier 1945, il
écrivait à propos de la condamnation de Béraud
: « Au vrai, tout Paris sait bien que ce jugement est inique.
Qu'on déshonore et qu'on exécute comme traître
un écrivain français qui n'a pas trahi et qu'on
le dénonce comme ami des Allemands alors que jamais il
n'y eut entre eux le moindre contact et qu'il les haïssait
ouvertement, c'est une injustice contre laquelle aucune puissance
au monde ne me défendra de protester. »
En
faveur de Robert Brasillach, l'argumentation ne pouvait être
la même. Cinq jours après la condamnation du 19 janvier
1945, Mauriac, à qui ses appels à la clémence
de ce temps-là vaudraient le surnom de « saint François
des Assises », signait, dans Le Figaro du 24 janvier, un
texte où l'on pouvait lire : « Pour son honneur,
le pays de Pascal et de Voltaire ne croit pas à certaines
fatalités : l'épuration à Paris, presque
toute concentrée sur les écrivains, est une de ces
fatalités qu'il finira bien par conjurer. A quoi sert de
le nier ? Nous sommes réduits au silence lorsqu'on nous
rappelle que les clercs doivent payer de leur tête le moindre
mot que la passion politique leur inspire et qu'au talent se mesure
le crime. Mais vous avez beau dire : ce qu'il y a de meilleur
en France ne se console pas de la destruction d'une tête
pensante, aussi mal qu'elle ait pensé. »
Charles
de Gaulle ne portait pas encore à François Mauriac
cette amitié dont il saura plus tard si bien parler. Bien
des signes pourtant laissent penser qu'il ne lui aurait pas déplu
d'accorder à Brasillach la clémence consentie à
Béraud. De surcroît, le fait que Maurras ait échappé
à la peine de mort, ce qui le dispensait d'avoir à
se prononcer sur ce cas, nourrissait l'espoir dans le camp des
partisans de la pitié. Cependant le chef du gouvernement
provisoire « laissa, selon la terrible formule, la justice
suivre son cours ». Ses raisons, faute d'être connues,
sont supposées. Les uns y voient la nécessité
de donner un gage aux communistes, qui ne sont pas quantité
négligeable et renâclent, après la fuite de
Céline, le suicide de Drieu La Rochelle, la grâce
de Béraud. Les autres, plus nombreux, fort de confidences
diverses, tiennent pour assuré que le général
aurait vu dans le dossier Brasillach une photographie de l'écrivain
en uniforme allemand. Personne pourtant ne fit ce grief au procès.
Une photographie existe, bien des fois reproduite ; elle montre,
sur un quai de la gare de l'Est, Drieu La Rochelle, Brasillach
et Abel Bonnard revenant d'un voyage en Allemagne. Tous trois
sont en civil, aux côtés d'un officier allemand.
On a pensé à une confusion entre Brasillach et Doriot,
ce dernier, leader du PPF, ayant porté l'uniforme nazi.
Par
la suite, le général se montra réticent,
agacé, lorsqu'on lui parla de Brasillach. Dans sa biographie
de Charles de Gaulle, Jean Lacouture rapporte ce mot jeté
à Claude Mauriac à ce sujet : « Brasillach
? Eh quoi : Il a été fusillé... comme un
soldat. » © Le Monde 5 février
1995
La
collaboration dans tous ses états ( Robert Brasillach et
Otto Abetz*), par Laurent Douzou
<< Deux ouvrages à caractère biographique
reviennent sur la France de l'Occupation par le biais d'acteurs
importants du versant le plus noir de son histoire, le diplomate
allemand Otto Abetz et l'écrivain français Robert
Brasillach. Le premier, oeuvre d'une historienne autrichienne,
prend pour centre de gravité les années sombres,
quand Abetz était à son zénith. Le second,
qu'on doit à une universitaire américaine, place
le curseur sur le début de l'année 1945, quand sonne
l'heure des comptes pour Brasillach. Ces regards, à la
fois savants et extérieurs, utiles pour dépasser
nos débats franco-français, attestent aussi qu'a
vécu la biographie classique, qui déroulait sans
accroc le fil d'une vie dont tous les moments étaient équivalents.
Né en 1903, Otto Abetz milite tôt dans les mouvements
de jeunesse allemands. En 1930, il contacte à Paris Jean
Luchaire, briandiste convaincu, animateur de Notre temps, où
écrivent Pierre Brossolette et Jean Prévost. Des
rencontres entre jeunes des deux pays s'ensuivent. En 1934, Abetz
quitte son emploi de professeur de dessin à Karlsruhe pour
un poste d'expert en questions françaises au bureau Ribbentrop.
Tout en s'alignant sur la doctrine nazie, il cultive ses relations
dans les cercles intellectuels parisiens. Fin 1935, le Comité
France-Allemagne voit le jour. La séduction dont use Abetz
touche ses limites en juin 1939 quand, perçu comme l'agent
d'influence qu'il est, on le déclare persona non grata
en France.
Nommé ambassadeur d'Allemagne en août 1940, il revient
à Paris par la grande porte. Il veut rallier l'opinion
française à la collaboration et manipuler en souplesse
le gouvernement de Vichy, où Laval joue la carte allemande.
L'ambassadeur tisse patiemment sa toile, y prenant syndicalistes,
patrons, acteurs politiques et culturels. Le renvoi de Laval,
le 13 décembre 1940, porte un coup à cette stratégie
collaboratrice au plus haut niveau sans qu'Abetz relâche
son jeu politico-culturel. Il touche à tout, apportant
son concours à la Légion des volontaires français,
demandant, de son propre chef, que les juifs des camps de la zone
nord soient déportés vers l'Est.
Fin janvier 1942, ses bons et loyaux services lui valent d'être
promu au rang SS de Brigadeführer, général
de division. Ecouté des plus hautes instances nazies, il
passe le plus clair de son temps à Berlin entre janvier
et avril 1942. Ces longues escapades au coeur du dispositif de
décision du IIIe Reich attestent le rang et l'influence
du personnage. Elles sont aussi le signe d'une position qui se
fragilise. Abetz voit, en effet, son étoile pâlir
à Berlin. Cette éclipse tient au fait qu'il a manoeuvré
pour le retour de Laval sans en avoir informé Ribbentrop.
Ce dernier ne l'oubliera pas. Il a beau resserrer la collaboration
avec Laval et aggraver la persécution antisémite
en poussant à l'introduction de l'étoile jaune en
zone occupée, son discrédit s'accentue.
Convoqué et retenu à Berlin à la fin de 1942,
il ne regagne Paris qu'un an plus tard pour négocier dans
une phase de tension extrême avec Vichy. Cette ultime tractation,
par laquelle il obtient que Pétain et Laval restent en
place, est son chant du cygne. Confiné après août
1944 dans la surveillance du gouvernement fantoche de Sigmaringen,
il n'est plus qu'un ambassadeur in partibus pratiquant une caricature
de collaboration. En décembre 1944, il est destitué
non sans que Hitler lui décerne peu après une haute
distinction. Arrêté en octobre 1945, il est jugé
en juillet 1949 à Paris. Il a voulu, plaide-t-il, «
limiter les dégâts dans la mesure du possible ».
Son avocat ne convainc pas en arguant « qu'il n'était
qu'un petit personnage dans la dépendance étroite
de chefs puissants et féroces ». Condamné
à vingt ans de prison, il rédige des Mémoires
où perce une nostalgie irrépressible pour le régime
nazi. D'actifs réseaux font campagne pour sa libération.
En avril 1954, c'est chose faite. Jusqu'à sa mort accidentelle,
en 1958, il tentera de réhabiliter son image.
De fait, ce dignitaire du IIIe Reich, qui excella à porter
les couleurs nazies en affectant de s'en distancier, conserve
dans la mémoire collective les traits d'un diplomate distingué,
marié à une Française, qui se serait efforcé
d'atténuer les violences hitlériennes. L'ouvrage
de Barbara Lambauer tord le cou à cette bluette en livrant
toutes les pièces d'un dossier fort lourd. Elle prend ainsi
le contre-pied d'Eberhard Jäckel, qui, dans La France dans
l'Europe de Hitler, paru en 1968, avait campé Abetz en
francophile et exécutant de second ordre. Elle y a eu d'autant
plus de mérite qu'Abetz ayant été, par sa
fonction, mêlé à toutes les facettes de la
collaboration, le chantier était immense. Avec une fougue
contenue et une expertise indiscutable, Barbara Lambauer ruine
des représentations qui passaient du baume sur les plaies
des mémoires allemande et française.
Avec pour toile de fond la même période et un même
souci d'éclairer un destin individuel, l'ouvrage qu'Alice
Kaplan, professeur de littérature à Duke University,
consacre à Brasillach emprunte à une veine composite
et plus intuitive. L'auteur rappelle, à grands traits et
avec talent, le parcours de ce normalien devenu critique littéraire
de L'Action française, puis rédacteur en chef de
Je suis partout. Prisonnier de guerre en 1940, il est libéré
en avril 1941 sur l'intervention d'Abetz. Le pamphlétaire
devient un des hommes les plus en vue de la collaboration. Il
s'en prend violemment aux juifs, aux caciques du Front populaire
(avec une haine recuite contre Georges Mandel et Jean Zay, qui
seront assassinés). Il vomit la République, «vieille
putain agonisante, garce vérolée, fleurant le patchouli
et la perte blanche». Mais le noeud du projet d'Alice Kaplan
est de reconstituer le procès de Brasillach clos par une
condamnation à mort exécutée le 6 février
1945. Elle s'intéresse donc à ses protagonistes,
disséquant positions et itinéraires individuels
du procureur général et de l'avocat de Brasillach,
sondant les jurés. Pour évoquer ces seconds rôles
négligés, l'auteur use de techniques à mi-chemin
des approches historique et romanesque. Partie sur leurs traces
avec de maigres indices, elle furète dans les archives
privées et publiques, sollicite les souvenirs de leurs
proches et sillonne leurs quartiers éventrés un
peu à la façon du Modiano de Dora Bruder, du Rouaud
des Champs d'honneur. De l'imprimeur d'Aubervilliers, de l'ingénieur
de Saint-Maur, de l'employé de Villetaneuse, du technicien
militant communiste, on saura finalement peu de choses. Reste
le procès lui-même. Brasillach y tient la dragée
haute à l'accusation : « Je ne puis rien regretter
de ce qui a été moi-même. » Son avocat
se trompe de plaidoirie, brillant quand il eût fallu convaincre.
Quant à la pétition rédigée pour réclamer
la grâce de Brasillach, à l'initiative de Jean Anouilh,
Marcel Aymé et François Mauriac, on sait que le
général de Gaulle décida de ne pas y céder.
Il s'en justifia, de façon elliptique quoique transparente,
dans ses Mémoires de guerre, à propos des écrivains
condamnés à mort : « S'ils n'avaient pas servi
directement et passionnément l'ennemi, je commuais leur
peine, par principe. Dans un cas contraire - le seul -, je ne
me sentis pas le droit de gracier. Car, dans les lettres, comme
en tout, le talent est un titre de responsabilité. »
Alice Kaplan, qui ne cèle rien des monstrueuses pages noircies
sous l'Occupation par le polémiste, le juge coupable. Elle
déplore cependant qu'en le fusillant on l'ait érigé
en mythique martyr innocent. Un mythe ? Précisément
non. Une figure exclusivement célébrée par
sa famille d'extrême droite, ce qui est bien le moins. Il
est des mots qui tuent toute potentialité de mythe, aussi
sûrement que les balles d'un peloton d'exécution,
tels ceux que Brasillach écrivit au lendemain des grandes
rafles de l'été 1942 quand il proclama la nécessité
de « se séparer des juifs en bloc et de ne pas garder
de petits ».
Laurent Douzou © Le Monde du 2 Novembre 2001
Brouillard
<< Le temps a enveloppé toutes ces choses d’une
buée aux couleurs changeantes : tantôt vert pâle,
tantôt bleu légèrement rosé. Une buée
? Non, un voile impossible à déchirer qui étouffe
les bruits et au travers duquel je vois Yvonne et Meinthe mais
je ne les entends plus. Je crains que leurs silhouettes ne finissent
par s’estomper et pour les conserver encore un peu de réalité...
>> Villa triste page 167
Brouillages
<< Il crut trouver la réponse : tout ce que l’on
vit au jour le jour est les incertitudes du présent. [...]
Mais de loin, avec la distance des années, les incertitudes
et les appréhensions que vous viviez au présent
se sont effacées, comme les brouillages qui empêchaient
d’entendre à la radio une musique cristalline.>>
L’Horizon, p.52.
Bruit
de fond
"Comment vivez-vous le fait d'être devenu un écrivain
de "référence", une "gloire nationale"
?
Oh, quand on a commencé à publier très jeune
comme moi, au bout d'un certain nombre d'années, on devient
comme un bruit de fond, comme un meuble... L'écriture est
un métier où on est complètement déconnecté,
toujours seul. Ce n'est pas un travail collectif comme celui des
metteurs en scène de théâtre, par exemple,
sans cesse entourés par des gens qui vantent leur génie,
sauf, bien sûr, à donner des conférences au
PEN Club ou à pratiquer des séances de signatures..."
Entretien
avec Marianne Payot, Delphine Peras, "Je suis devenu comme
un bruit de fond", l’Express, 04/03/2010
Le
bruit et le silence* , réponse à une question
de Jean-Paul Enthoven
- Où en êtes-vous, personnellement,
avec le bruit et le silence ?
P. M. : C'est toujours le silence qui a le dernier mot
© le point 03/10/03 - N°1620
|